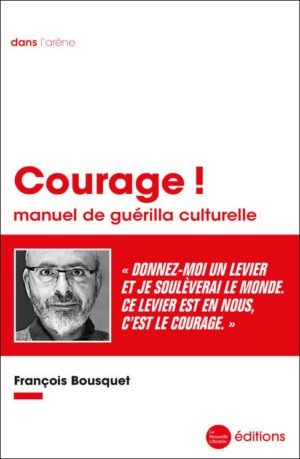On ne sait jamais, lorsqu’on parle de Vienne, si l’on doit commencer par Le Beau Danube bleu, les poèmes d’Hugo von Hofmannsthal, le château de Schönbrunn ou bien l’école freudienne. C’est que Vienne n’est pas monolithique, ne serait-ce que par sa fantaisie architecturale, à mi-chemin de Versailles et de Louis II de Bavière, auréolée d’une pléthore d’artistes et de penseurs, et sur laquelle plane le fantôme de Sissi. L’une des grandes capitales européennes de la culture, plus que Berlin, presque autant que Paris. S’il y a un auteur parmi toute cette constellation viennoise qui en rappelle le passé glorieux et la chute brutale, les contrastes et les harmoniques sophistiqués, c’est bien Stefan Zweig.
Né en 1881 dans une famille d’industriels et de banquiers juifs, au cœur d’un Empire qui semblait posé là pour toujours et dans une ville qui brillait encore de tous ses feux, étalant le faste éblouissant de la Double Monarchie, le destin de Stefan Zweig se confond avec celui de cette Mitteleuropa, ébranlée une première fois en 1914, avant de sombrer définitivement dans les années trente. Écrivain cosmopolite, européen de conviction, aristocrate de manières, mondialement connu, Zweig est bien le Viennois par excellence, le dernier enfant d’une ville prodigue en génies.
Vermeil et merveille de Vienne
On pourrait presque dire en paraphrasant Talleyrand : Qui n’a pas vécu dans cette Vienne d’avant 1914 n’a pas connu le plaisir de vivre. La « Gemütlichkeit », l’intimité apaisante, l’harmonie dans un monde réconfortant. Ce que Zweig appelle « l’âge d’or de la sécurité » et qu’il a fait revivre une dernière fois dans ses mémoires, Le Monde d’hier, achevés juste avant sa mort volontaire, en 1942, dans un exercice de résurrection littéraire parfaitement maîtrisé, entremêlant nostalgie pour ce monde défunt et effroi devant les temps présents.
C’est ce qui ressort pareillement de sa correspondance. À la lire, on se croirait revenu au XVIIIe siècle, l’âge d’or de l’art épistolaire, quand tout un continent échangeait des idées sous la forme de lettres et d’épîtres. Zweig est du reste un homme des Lumières, mais plongé, par un malencontreux hasard de naissance, dans une sorte de nuit historique. Rien ne le prédisposait, ni son éducation, ni son milieu social, encore moins la ville qui l’a vu naître, à affronter ce déchaînement de l’histoire.
Cette Vienne engloutie aura été tout à la fois un asile accueillant pour les Juifs, qui en ont fait leur centre culturel, et l’un des foyers de l’antisémitisme. Une ville où se côtoyaient Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, et Karl Lueger, qui expérimentait à la tête de la municipalité l’antisémitisme moderne. La capitale d’un Empire pas complètement démembré et une cité nonchalante et provinciale qui ignorait l’agitation des grandes métropoles européennes. Un monde d’Ancien Régime aux rituels inchangés, peuplé de bourgeois débonnaires aux favoris grisonnants, et une société effervescente qui inventait le XXe siècle, sous l’impulsion de Freud, Schönberg, Mahler, Wittgenstein, Robert Musil, Gustav Klimt, les grands artisans de cette « modernité viennoise ».
Zweig est le témoin capital de ces années. Ses succès, sa curiosité, sa générosité, son entregent lui ont ouvert toutes les portes pour faire de lui le trait d’union idéal entre la Vienne des Habsbourg, calée dans les habitudes de l’Empereur François-Joseph, le modèle rassurant d’une civilisation expirante, et la génération de la « Jung Wien », la Jeune Vienne artistique. À lui tout seul, l’ancien et le contemporain. Un classique quant à la forme, mais un moderne par ses thèmes de prédilection et son humeur, alternant périodes d’insouciance et phases de dépression, avant de basculer dans le malheur.
Les aller-retour dans le passé
Zweig était un magicien de la forme courte. Il appartenait à la famille des caressants, pas des pénétrants, littérairement parlant ; ne violant pas son lecteur, mais l’enveloppant dans du velours et de la soie. Nulle violence expressive chez lui. Il procédait par touches allusives et suggestives, délaissant les grandes fresques au profit de détails isolés pris dans un flou intentionnel. La photo tremblée d’une passion amoureuse, d’un échec, d’un remords. Sa nouvelle Le Voyage dans le passé, au titre si caractéristique, condense à elle seule l’art romanesque de Zweig. La brièveté correspondait au climat psychologique qu’il souhaitait instaurer. Des instants volés, des âmes qui s’étreignent avant de se séparer, des haltes dans la solitude d’existences meurtries. L’œuvre de Zweig est comme une sorte de confessionnal public où des inconnus avouent leurs secrets à des lecteurs indiscrets à travers des monologues haletants. Mais jamais ces aveux ne délivrent les consciences. La solitude a toujours le dernier mot.
L’auteur de La Confusion des sentiments a compris très tôt ce monde de comédie, de faux-semblants, d’illusions. Tout cela fera de lui un être désenchanté, plutôt que révolté. Il éprouvait une sorte de timidité devant la vie, surtout la vie profuse et brouillonne des génies. Il était désarmé devant eux, les aimant comme seuls les enfants savent aimer, ne croyant qu’en la littérature, en son pouvoir et en ses prêtres, tant et tant qu’il collectionnera, en véritable fétichiste, manuscrits originaux et lettres autographes (jusqu’au bureau de Beethoven). Il avouera ingénument à Schnitzler se sentir face à lui aussi démuni qu’un petit enfant, et, bon élève, soumettait tous ses textes au jugement sévère de Freud. Romain Rolland, Rilke, Rodin, Joseph Roth, Freud donc, autant de maîtres qu’il vénérait à l’égal de dieux. Ses lettres sont encombrées de formules de politesse affectées, de « cher maître » révérencieux, qui peuvent faire se méprendre sur la qualité de son amitié et de son admiration. L’une et l’autre sont pourtant irréprochables. Rien de mesquin chez lui, rien de petit, tout est altier. Une loyauté à toute épreuve.
Au service des génies
Le génie des autres sera la grande affaire de sa vie, beaucoup plus que les femmes, ses premières lectrices. Il en a poursuivi le secret dans sa correspondance et ses innombrables biographies. Alors que dans ses romans et nouvelles, il rassemblait ses forces autour de quelques personnages et se concentrait sur des recoins obscurs de l’âme humaine, il empoigne ici le monde à pleines mains. Un forçat de l’écriture, qui avait en tête une vaste série de portraits, Les Bâtisseurs du monde, sur laquelle il a bien avancée, travaillant par triptyque. D’abord ses Trois maîtres (Balzac, Dickens, Dostoïevski). Puis Le Combat avec le démon (Kleist, Hölderlin, Nietzsche). Suivi de Trois Poètes de leur vie (Stendhal, Casanova, Tolstoï). Enfin La Guérison par l’esprit (dont un portrait du père de la psychanalyse). Ce seront ensuite des monographies : Fouché, Marie Stuart, Marie-Antoinette, Magellan. Tous ces livres rencontrant un immense succès. Le public a vengé leur auteur d’une certaine indifférence de ses pairs, quand ce n’était pas de l’hostilité. Hermann Hesse, Thomas Mann, Rilke, Schnitzler, pourtant ses amis, l’ont régulièrement écorné. Trop facile, trop académique. Qu’à cela ne tienne, les lecteurs n’en ont pas moins continué de le plébisciter, restant à ce jour l’un des écrivains les plus lus au monde.
Le grand ennemi de Zweig aura finalement été l’histoire contemporaine. Il a ajourné autant qu’il a pu sa confrontation avec elle, se réfugiant dans le passé, les voyages, la fiction, le surmenage, la dépression. Tout, sauf l’horreur des temps présents, comme s’il se refusait à croire qu’elle pouvait durer. Mais voilà, il est sans arrêt rattrapé par la folie des hommes, leurs guerres absurdes, son destin juif. Il devra quitter l’Autriche en 1934, dès les premières humiliations nazies, pour s’installer en Angleterre, avant l’exil définitif en 1941, à Petrópolis, au Brésil.
Le seul parti qu’il adoptera devant cette « guerre civile européenne » (1914-1945), pour parler comme l’historien Ernst Nolte, qui va remplir quasiment la seconde moitié de sa vie, sera celui du pacifisme et de la nécessaire unification de l’Europe. Romain Rolland l’appellera d’ailleurs le « grand Européen ». Ce n’était pas un intellectuel au sens que nous donnons à ce mot. Il ne voulait pas s’engager, mais se dégager des engagements et des vassalités. Ce qui protestait en lui, ce n’était ni le Juif, ni l’Autrichien, mais l’homme. « Comme ce serait confortable d’être sioniste ou bolchevique ou tout autre sorte d’homme déterminé plutôt que d’être du bois flotté dans les flots déchaînés. »
Son compagnon Érasme
À trop s’enrôler au service d’une cause, il craignait de se retrouver sur le même plan que les nazis, d’être à son tour un petit soldat enrégimenté, rangé derrière ce qu’il appelait la « Chambre corporatiste de l’écriture ». Il s’y refusera, au grand désarroi de ses amis, qui lui reprocheront d’avoir érigé la neutralité en maxime de vie. Ce qui était pour le moins injuste, lui qui a été continuellement sollicité par les uns et les autres. C’est à bon droit qu’il pouvait écrire à l’un de ses proches en 1939 : « Bien sûr, le fait que tant de gens s’adressent à moi justifie globalement mon existence et la façon dont je l’ai menée jusqu’ici. »
Au fond, deux personnages cohabitaient dans ce Janus déchiré. L’humaniste, qui opposait au Moloch nazi les droits de la conscience individuelle, et l’homme privé, totalement désespéré. Le premier restait diplomate, courtois, conciliant, s’interdisant toute polémique dans l’espoir naïf de protéger les Juifs encore « otages » du Reich. C’est là sa grande erreur. Son silence surprend d’autant plus que sa correspondance nous montre un homme à qui la tragédie de l’histoire contemporaine ne semblait plus être, comme dans Macbeth, qu’un récit conté par un idiot, plein de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien.
C’est à travers son Érasme (1934) qu’il répondra à ses détracteurs. Érasme « voulait être homo pro se, homme pour soi-même, quelles qu’en fussent les conséquences ». Ainsi de Zweig. Lui, qui n’aura rien dit de plus sur lui que ce qu’il a consigné dans Le Monde d’hier (en mémorialiste beaucoup plus qu’en autobiographe), a dit de son Érasme que c’était son autobiographie cachée. Il a même songé à l’appeler « Portrait d’un vaincu ». Portrait, autoportrait, c’est tout un. Il récidivera en 1937 avec Conscience contre violence, qui exhume la figure oubliée de Castellion, humaniste français qui a assisté au bûcher de Michel Servet dans la Genève inquisitoriale de Calvin. Il écrira pareillement sur Montaigne. Avec la résignation d’un martyr, mais sans espoir de salut. « Là où règne la force, il n’y a aucun recours pour les vaincus. »
Suicide de l’Europe, suicide d’un Européen
Rien, sinon l’exil, la fuite et la mort. Le « bouddhisme » de Zweig, comme l’a relevé un jour Romain Rolland, en le lui reprochant. Selon sa première épouse, Friderike, Zweig est entré très tôt en dépression, dès 1914, avec l’entrée en guerre de la France, puis de l’Italie. Ses deux patries d’adoption, qui se retournaient ironiquement contre sa terre maternelle. Il a longtemps soigné sa neurasthénie par l’hyperactivité, le succès pourvoyant au reste. Mais un tel succès, foudroyant et durable, va finir par le tétaniser, à telle enseigne qu’il envisagera un jour d’écrire sous pseudonyme, rêvant d’ailleurs et d’anonymat, dans un mélange d’insoumission et de désertion. Il va se séparer de sa première femme et épouser sa secrétaire, Charlotte Altmann, de vingt-sept ans plus jeune que lui. Puis fuir, comme Lord Jim, le personnage de Conrad, de port en port, non pas tant à cause d’un sentiment de culpabilité diffus que d’une gloire encombrante, qu’il jugeait imméritée, et du cataclysme historique, devant lequel il se sentait impuissant. Voyager l’apaisera, un temps du moins. Berlin, Paris, Londres, l’Espagne, l’Algérie, l’Italie, New York, le Brésil. Il dira alors que sa lecture préférée est constituée par les indicateurs de chemin de fer. Bientôt des transatlantiques. C’est ainsi que, chemin faisant, ou dérivant, il va brûler un à un ses vaisseaux, s’abandonner à la vague, couler enfin, nous laissant en guise d’adieu une lettre sobre et déchirante, en date du 22 février 1942, avant de se suicider avec sa seconde épouse : « Je salue tous mes amis ! Puissent-ils voir encore l’aurore après la longue nuit ! Moi qui suis trop impatient, je m’en vais avant eux. »