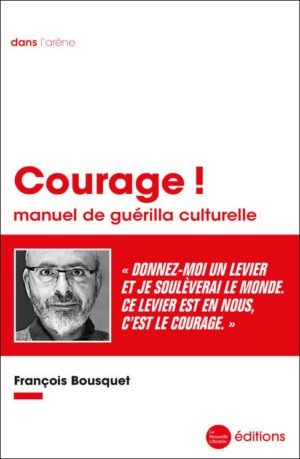Tout le monde n’a pas l’aubaine de naître un 1er avril d’une mère à moitié folle et d’un père écrivain raté. C’est pourtant ce qui est arrivé à Nicolas Gogol en cette étonnante journée d’avril 1809. Erreur d’état civil ou ironie du calendrier ? Nul ne le sait, et Gogol moins que tout autre, lui qui n’eut jamais la certitude d’exister réellement, sinon dans les mondes parallèles et indéterminés où il trouvait refuge auprès de personnages aussi évanescents que spectraux, l’homme de la grande ville, celui de « la foule solitaire », dont, le premier, il a pressenti l’avènement, à l’aube de la modernité. Ils donneront naissance à une lignée prolifique, des Notes du souterrain de Dostoïevski au Journal d’un homme de trop d’Ivan Tourguéniev, du Démon de petite envergure de Fédor Sologoub à La fin d’un petit homme de Léonid Léonov, le plus dostoïevskien des présidents de l’Union des écrivains soviétiques.
À la question de savoir s’il était une créature de Dieu ou un cancrelat kafkaïen déshumanisé, Nicolas Vassiliévitch Gogol n’a jamais clairement répondu, tant il vivait à côté de lui-même, se prenant pour une âme pieuse et un réformateur ami du genre humain, voire un écrivain édifiant, comme en attestent ses sentencieux et fastidieux Passages choisis d’une correspondance avec des amis (1846), alors qu’il constituait à lui seul le phénomène le plus curieux et le plus saugrenu de la plus étrange des littératures – la littérature russe. Un insecte asocial, solitaire et fantasque, qui, à l’instar du personnage de La Métamorphose, Gregor Samsa, s’est réveillé un beau matin sous les traits d’un scarabée, à cette réserve près que, contrairement au héros de Kafka, l’insecte se doublait chez Gogol d’un prodigieux entomologiste de l’espèce humaine et plus spécialement de ses innombrables déclinaisons russes : bureaucrates pétersbourgeois, notables provinciaux, domestiques et cochers de toutes sortes…
Une Ukraine folklorique, une Russie fantastique
Quoique né en Ukraine et ayant consacré à son pays natal, outre un roman historique souvent adapté au cinéma, Tarass Boulba (1835, 1839 pour la version définitive), une suite de récits, Les Soirées du hameau (1831-1832), tout en lui le rattache à la Russie. Ces Soirées sont d’abord et avant tout des contes pour la veillée du soir, à lire en hiver, autour du samovar. Quand bien même elles restent, en dépit des années, une merveille de fantaisie, elles ne font rien d’autre que ressusciter une Ukraine folklorique somme toute conventionnelle, jusqu’au narrateur Panko le rouge, dont Gogol ne manque pas de tirer tous les effets comiques possibles.
C’est seulement en débarquant à Saint-Pétersbourg que le Petit Russien est devenu grand, dans cette ville démesurée, artificielle, monstrueuse et tentaculaire, comme la perspective Nevski à laquelle il a consacré une nouvelle éponyme (1835). Sans la capitale septentrionale de la Russie, il serait resté l’ethnologue féerique et cocasse d’une Ukraine rêvée. À Pétersbourg, il est vraiment entré dans le monde de l’illusion dissolvante de la grande ville, celle construite sur les marées par Pierre Ier, véritable abcès occidental dont l’auteur des « Nouvelles pétersbourgeoises » allait faire un thème littéraire, ouvrant la voie au délire criminel de Raskolnikov dans Crime et châtiment et aux hallucinations de Nicolas Apollonovitch dans Pétersbourg d’André Biély. Quelque chose de la Russie a échoué là – avorté ? L’européanisation ratée de l’Empire des tsars, comme un acte manqué.
Cette Russie, Gogol l’a désossée comme nul autre avant lui, la mettant à nu avec une puissance comique, pathétique et anatomique inégalée. D’une certaine façon, il en a révélé l’envers, une Russie qui ouvre ses immenses perspectives grises et ternes balayées par un vent monotone et glacé. Du Révizor (1836), chef-d’œuvre du répertoire théâtral qui met en scène un vrai-faux inspecteur envoyé par le gouvernement dans une capitale provinciale semblable à une basse-cour, aux Âmes mortes (1842 pour la première partie), qui faisaient dire à Pouchkine, à la fois émerveillé par l’art de Gogol et accablé par la morosité de ses descriptions : « Mon Dieu, comme la Russie est triste ».
« J’ai rétrogradé les généraux en simples soldats »
Triste, c’est Gogol qui l’était, en dépit de son génie comique, lui qui était affligé de quantité de traits déplaisants et de manies absurdes, hypocondriaque, superstitieux, bigot, affecté et d’un air commun, nonobstant l’originalité absolue du personnage. En vérité, il offrait le visage contrasté d’un homme désespérément ordinaire et inimitablement excentrique, grandiloquent dans les petites choses et étriqué dans les grandes. Tout en lui aspirait aux idées élevées, mais se heurtait sans arrêt au plafond bas de son univers. D’où la tension dans ses livres entre une quête de beauté et la réalité triviale dans laquelle évoluaient ses personnages.
Comme dans une pantomime théâtrale, il marchait à petits pas dans de petits souliers en battant la chaussée avec sa canne, tout en étant secoué d’un petit rire nerveux. « J’ai rétrogradé les généraux en simples soldats », disait-il de son œuvre, en pensant d’abord à lui. Il a vécu comme un rond-de-cuir courtelinesque et est mort comme un Blaise Pascal slave, du moins l’imaginait-il, de folie et d’épuisement, à quarante-deux ans, en 1852. C’était en apparence une sorte de Monsieur Prudhomme, aussi quelconque que l’original, mais frappé d’angoisse métaphysique. Dieu lui apparaissait sous la forme tangible et menaçante d’un maître d’internat administrant des blâmes. Il le regardait avec une terreur sacrée et enfantine, son désir de punition le ramenant toujours à lui, comme s’il aspirait à être son souffre-douleur préféré, martyr consentant et masochiste.
Le Diable est la forme nominale qu’a prise son délire de persécution. Il croyait le loger en sa personne et a voulu l’expulser, en purgeant son corps par le jeûne et son œuvre par le feu. Dans les dernières années de sa vie, il vivait sous l’emprise de son confesseur, le père Matthieu Konstantinovski, qui l’obligea à brûler la seconde partie des Âmes mortes dans l’espoir de lui faire gagner un paradis régenté par un Dieu qui ressemblait plus à un chef de bureau ministériel qu’au Père céleste en majesté. Si l’homme a été créé à l’image de Dieu, alors Dieu doit être un bureaucrate impérial distribuant des cordons et des sucres d’orge à ses serviteurs les plus méritants.
Comment faire du Diable un imbécile ?
Le Diable, c’est le seul sujet de l’auteur du Journal d’un fou (1835). « Comment en faire un imbécile ? », comme l’a parfaitement résumé Dimitri Mérejkovski dans son Gogol et le Diable. Le Diable, c’est le personnage le plus rétréci, le plus racorni de l’univers, bref le plus proche de la « pochlost », ainsi que l’a souligné Nabokov dans ses remarquables tout autant qu’insupportables notes et cours sur Gogol. La « pochlost », mot intraduisible qui recouvre tout ce qu’il peut y avoir de vulgaire, de faux, d’inauthentique, de minable dans l’homme, l’infiniment petit et l’infiniment mesquin. « Le Diable, écrivait Gogol, est la plupart du temps si proche de l’homme qu’il le chevauche sans cérémonie. » Il ne se cache pas seulement dans les détails, il est tapi au fond de l’insignifiance des choses, comme chez Akaki Akakiévitch, le personnage principal du Manteau (1843), pour qui l’acquisition d’un manteau s’apparente à la quête d’un Graal d’autant plus obsessionnelle qu’elle est dérisoire.
On a parlé à son propos de « fantastique de la banalité ». On pourrait tout aussi bien parler de byzantinisme de la platitude, tant il y a dans son style des éléments de préciosité, mais détournés de leur destination initiale. Le maniérisme est appliqué à la description d’univers monodimensionnels et prosaïques, dans lesquels Gogol injectait du fantasque, du fantastique et de la fantaisie. Il n’y avait pas chez lui de transition entre les différents niveaux de réalité. Il glissait de la trivialité au fantastique dans des allers-retours incessants. Son naturalisme n’était que de façade, sans aucune intention réaliste. C’était plutôt l’effet d’un délire qui portait sur un morceau étroit de réalité.
Gogol était beaucoup plus physiologiste que psychologue. Il appréhendait le monde à la manière des myopes, collé à son sujet, examinant les choses par le petit bout de la lorgnette dans des effets de grossissement saisissants. Vu de près, tout est ridicule, minuscule et risible. Un matin, un petit fonctionnaire pétersbourgeois se rend au bureau avec son nez sous le bras, l’air de rien. Scène absurde. C’est que Gogol ne décrivait pas des personnages, seulement leur anatomie malencontreuse. Tel est le satiriste. Il ne voit pas des hommes, mais des homoncules encombrés d’organes inutiles, prenant la partie pour le tout, avant de l’animer d’une vie propre. Le nez d’abord, « ce nez qui a l’air d’un beignet bien cuit », comme le dit Georges Nivat. C’est le personnage principal (et le titre) de l’une de ses nouvelles (1836). C’est aussi Tchitchikov, le héros des Âmes mortes, qui se signale à l’attention des autres en tirant des bruits d’orchestre de son appendice nasal sempiternellement bouché.
Sganarelle dans les habits de Bossuet
Chez Gogol, la vie est toujours réifiée, chosifiée, mécanicisée, plus morte que vivante finalement – tel est d’ailleurs le sens second des « âmes mortes », l’âme éternelle qui se meurt (le sens premier étant les serfs – autrement dit les « âmes » – décédés que Tchitchikov rachète entre deux recensements). À l’inverse, les objets et les choses sont dotés d’une vie propre. Un chapeau, un manteau, un nez, subitement, s’animent. La beauté, une beauté maladroite et précaire qui se heurte aux rugosités du réel, surgit. Il y a une féerie dans les nouvelles pétersbourgeoises. On a l’impression que tous ces petits fonctionnaires glissent, ou patinent, sur les parquets cirés des ministères. Gogol est d’abord et avant tout poète, en prose et revêtu d’une livrée de cocher. Il a chorégraphié les ronds-de-cuir, les ventres replets et jusqu’à la vulgarité, si commune et si extraordinaire, de Tchitchikov, le Sancho Pança russe, la malhonnêteté en plus.
Son œuvre annonce tous les doubles dostoïevskiens, tous les Joseph K. kafkaïens et tous les rhinocéros ionesciens. Elle est comme le tombeau du fonctionnaire inconnu et de l’homme sans nom, même si c’est lui en réalité que Nicolas Gogol enterrait, crucifiant ses ridicules et les offrant en sacrifice. Jusqu’à immoler son diabolique humour, pour parler comme Dostoïevski.
Tel le crépitement des épines sous le chaudron, tel le rire de l’insensé, dit l’Ecclésiaste. Sous le démon du rire, Gogol cherchait en réalité un prédicateur mystique. Pour bien comprendre l’ultime mue du personnage, il faut imaginer Sganarelle, le valet de Molière, dans les habits de Bossuet inondant ses amis de sermons et de brochures apologétiques. Voilà le dernier Gogol. Il attend l’Apocalypse et le Jugement dernier, mais il les attend comme s’il s’agissait d’un contrôle fiscal, avec à la manœuvre un Révizor céleste, moitié trésorier général, moitié gendarme de Guignol. Il met donc sa comptabilité à jour, sous la férule obtuse du Père Matthieu. Brûlez, brûlez, lui dit son directeur de défiance, sinon c’est vous qui brûlerez en enfer. L’autodafé seul vous purifiera. Et c’est ainsi que Nicolas Gogol crut gagner le paradis, délesté de son œuvre, grimpant laborieusement l’échelle de Jacob, barreau après barreau, suant à grosses gouttes, le souffle coupé, son livre de comptes à la main.