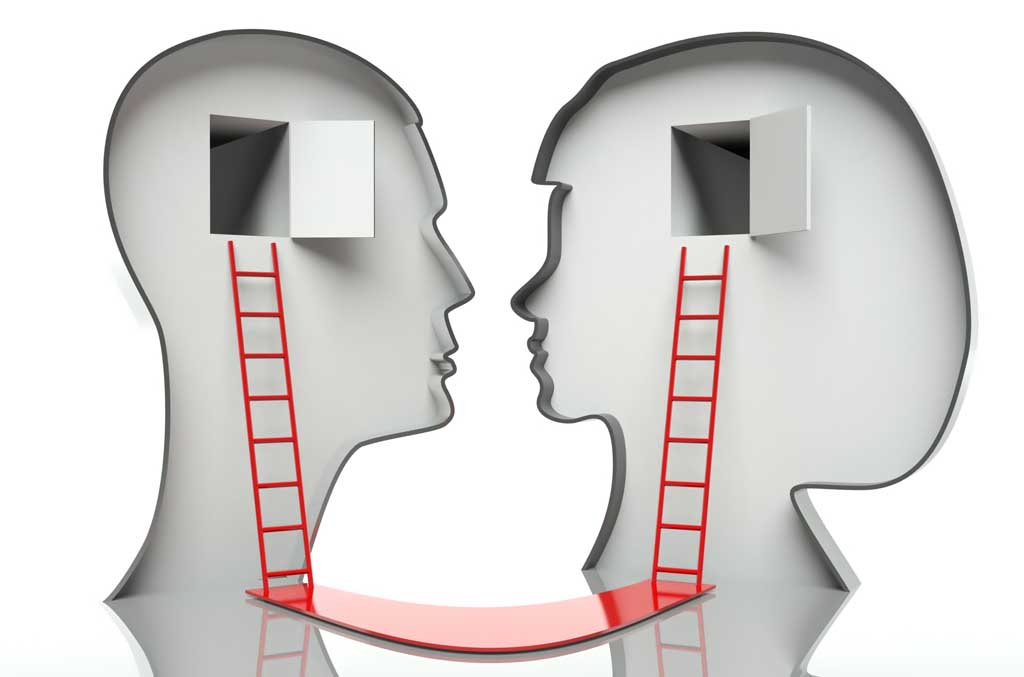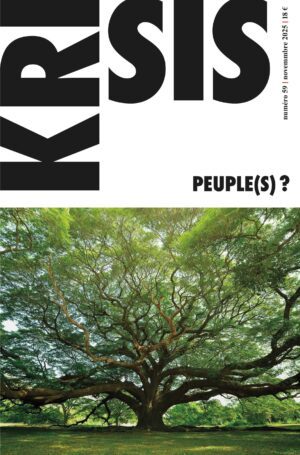À Carlos Rodrigues
Un entretien de David L’Épée avec le magazine en ligne Breizh-info.com (« Il faut réhabiliter l’art de la séduction ! », 21 août 2025) me fait supposer que les relations hommes-femmes, qui incluent l’art de la séduction (titre de l’entretien) sont un sujet qui peut encore intéresser.
Il me faut tout d’abord dire que tout est pertinent, très bien vu et pensé dans les analyses de David L’Épée qui tournent autour de la séduction au sens large. Séduire a deux sens : amener quelqu’un à des relations sexuelles. Comme forme intense de relation humaine, on conviendra que ce n’est pas si mal ! Et un deuxième sens : amener quelqu‘un à nous admirer et à nous estimer (ce qui est une condition nécessaire à des relations sexuelles mais non suffisante et encore moins obligatoire).
Le climat idéologique actuel n’est pas favorable aux bonnes relations entre hommes et femmes (nous verrons que la pratique et les vécus échappent heureusement en bonne part à ce climat). Alors que les sexes sont naturellement entremêlés dans un mélange d’insurmontable altérité et de tentative pour la surmonter, l’actuelle idéologie « woke » tend à instaurer un apartheid des sexes. Cela se fait au nom d’un refus de l’intrusion poussé à l’extrême, consistant, pour ne créer aucune ambiguïté, à refuser toute communication entre les sexes. On passe du safer sex au safe space, aux espaces voulus de non-mixité (dont il existe aussi des versions raciales et des combinaisons sexe-race).
La question du désir
Or, ce n’est pas ce que demande la majorité des femmes. Elles ne confondent pas le respect et l’inintérêt. Elles ne sont pas hostiles à ce que les hommes les remarquent (bien au contraire souvent !), et à ce que les hommes leur parlent, à condition que ce soit avec les formes adéquates. C’est du reste quelque chose que l’on peut étendre aux conversations entre hommes, même dans des espaces aussi peu propices aux conversations que les transports en commun d’une grande ville.
Mais bien entendu, entre hommes et femmes, il intervient vite une dimension qui n’existe pas (sauf pour les homosexuels) entre hommes ou entre femmes. C’est la dimension du désir. Ce désir est certes en partie sexuel (cela dépend des circonstances et de l’âge notamment), Mais il est loin d’être uniquement sexuel. Il est relationnel. Il est désir de soulever un peu le voile de mystère de l’autre. Et quel autre est plus autre que celui du sexe opposé ? « Les gens gagnent à être connus. Ils gagnent surtout en mystère », dit Jean Paulhan. Tout homme qui aime l’altérité – et même l’altérité des idées, comme c’est mon cas – ne peut qu’aimer les femmes. Elles sont si différentes de nous ! Tout désir n’est donc pas sexuel mais tout désir est assurément sexué.
Dans le domaine relationnel, le partage d’un certain nombre de codes est nécessaire pour que les relations entre hommes et femmes se passent bien. Par exemple, si un des partenaires appartient à une culture de l’islam et l’autre partenaire à une culture chrétienne, il y aura certainement une difficulté. Elle n’est pas toujours insurmontable : c’est une question de niveau culturel. Mais sans qu’il y ait une impossibilité absolue, c’est tout de même statistiquement peu facilitateur. Et ce peut être un obstacle carrément insurmontable si la femme (ou l’homme) appartient à un islam salafiste ou wahhabite, ou est proche des Frères musulmans, et l’autre partenaire de culture chrétienne. Ce qui renvoie en bonne part à la question du niveau (on sous-estime souvent ces différences à l’intérieur même de l’islam, différences analysées avec pertinence par Youssef Hindi. Sait-on par exemple que nombre d’Algériens passent leurs vacances en Tunisie parce que l’islam y est moins rigoriste ?). Pour se parler, et a fortiori pour vivre ensemble, la question d’une culture commune est essentielle.
L’unique et le multiple
En ce qui concerne la barrière des âges, elle apparait moins importante que celle des milieux sociaux à David L’Épée. Il n’est pas sûr que, quand il aura mon âge, c’est-à-dire près de 70 ans, il verra les choses de la même façon ! L’écart important d’âge n’est pas facilitateur. Mais là encore, ce n’est pas un obstacle absolu. Il peut même devenir mineur dans certaines circonstances. Par le biais de centre d’intérêts communs, tel que le dessin, la peinture ou la danse, on peut parfaitement surmonter les différences d’âge. Il est tout à fait possible, à près de 70 ans, d’engager la conversation ou d’être abordé (cela m’arrive) par de jeunes personnes de l’« autre sexe » sur la base de dessins, portraits et croquis, faits dans les transports en commun. Bien entendu, la séduction n’est pas le motif principal, ni dans un sens ni dans l’autre : il est question d’intérêt humain, voire d’empathie, ce qui n’est négligeable.
Enfin, même quand on s’inscrit dans un registre qui relève plus directement de la séduction, il est rare, comme le souligne David L’Épée, que la réaction soit virulente si l’approche est faite avec tact. Mais cette approche de « drague » est-elle la plus intéressante par rapport à l’approche thématique, celle qui se fait, assez naturellement, sans excès d’intentionnalité (comme dirait Husserl) sur la base d’intérêts communs ? Je n’en suis pas sûr. Il reste que je partage entièrement la remarque de David L’Épée. « […] en voulant désarmer le patriarcat, les néo-féministes ne sont parvenues qu’à castrer les hommes les plus courtois (potentiellement les plus séduisants) tout en ne laissant sur le terrain de chasse que les plus brutaux et les plus machistes ! » On observe aussi que les femmes qui font le moins bon accueil aux hommes sont souvent les moins jolies et les plus mal dans leur peau (ce qui va souvent ensemble).
En tout état de cause, une rebuffade fait partie des expériences de la vie. Aborder les autres, c’est toujours « une petite victoire contre l’atomisation de la société ». Un séducteur n’est jamais, par définition, sûr de séduire. Sinon, ce serait un consommateur et ce serait beaucoup moins intéressant. Il n’est jamais certain non plus de satisfaire sa partenaire. Surtout si lui-même a une vision purement performative de la « satisfaction ». C’est du reste pour cela que certains hommes sont fascinés – ivresse de l’illimité – par ce qui leur paraît – à tort – comme une infinie disponibilité sexuelle féminine, disponibilité opposable à la finitude évidente des « performances » masculines. Ici aussi, il est souhaitable de savoir goûter le plaisir infini de… la finitude. « Faire l’amour n’est pas ne faire qu’un, ni même deux, mais faire cent mille », dit Gilles Deleuze. L’unique débouche sur le multiple. Et le multiple se ramène à une quête de l’unique. Ce qui veut dire : faire l’amour, c’est recréer le monde. C’est prendre au sérieux la natalité. (« Tout se passe comme si, depuis Platon, les hommes ne pouvaient prendre au sérieux le fait d’être né mais uniquement le fait de mourir », Hannah Arendt, Journal de pensée, 1950-1973).
Entre hypersexualisation et wokisme
L’homme contemporain se trouve ici coincé entre le « wokisme » et le féminisme anti-sexe qui est en fait un féminisme anti-hommes, et, d’un autre côté, les mythes de l’hypersexualisation, véhiculés par la publicité et par la pornographie. Se faire une place entre ces écueils n’est pas simple. C’est en un sens toujours le rapport à Mai 68 qui est en question. Il y a eu trois Mai 68 : le Mai 68 ouvrier, celui de la dignité, celui du refus des femmes de se faire « ennuyer » par tel petit chef de service, le Mai 68 libéral-libertaire, déjà nihiliste, voulant dépénaliser la pédophilie, ricanant à propos de tout ce qui traditionnel comme le goût du travail bien fait, un Mai 68 ultra-individualiste, qui ne laisse que l’argent comme échelle de valeur. Et enfin, il y eut un troisième Mai 68, libertaire mais non libéral, communautaire, partisan de recourir à un nouveau lien avec la nature, attaché aux petites communautés, aux petites patries, au local, redécouvrant les chants traditionnels (Michel Fugain et les chants corses). C’est ce dernier Mai 68 qui a été marginalisé au profit du Mai libéral-libertaire, celui de Daniel Cohn-Bendit, de feu Richard Descoings, d’Olivier Duhamel, un Mai 68 euro-mondialiste (mondialiste sous couvert d’une fausse Europe) et ami du Capital.
Entre hypersexualisation de la société marchande et idéologie « woke » de l’apartheid des sexes, la voie est donc difficile à trouver. Pourtant, les pratiques sociales peuvent échapper à cette pince qui semble réduire l’espace de la vie heureuse entre hommes et femmes. Là comme ailleurs, il s’agit d’échapper à l’atomisation sociale et à l’anomie. Or, l’audace de se parler entre hommes et femmes soigne la solitude sociale. En ce sens, le milieu du tango argentin est paradigmatique d’un bon équilibre possible. Il est fondé sur le partage de codes de communication : le regard (quoique… le tango se pratique aussi entre aveugles et la voix supplée au regard, et le toucher est bien sûr une forme de communication, comme le savent nos amis les chats), l’approche courtoise, la bienveillance. Le partage se fait pleinement, mais pour un temps donné. La jalousie n’a pas sa place. Le degré d’enlacement (abrazo) est choisi par la femme, sans que les mots ne soient nécessaires : abrazo (ou étreinte) ouvert, semi-fermé, fermé, tête contre tête. On ne se parle pas pendant la danse, mais rien n’empêche de le faire après la danse. Aussi n’est-il pas rare que naisse des amitiés, voire autre chose. Enfin, les hommes se parlent aussi entre eux. Les rivalités (entre hommes et entre femmes) ne sont pas inexistantes, mais ne se situent pas à un degré qui soit une entrave à une certaine complicité autour de la danse et autour de la présence de femmes généralement élégantes et souvent jolies, complicité bien naturelle et très éloignée d’un entre-soi masculin vulgaire et égrillard. Quant aux femmes, elles ne sont nullement indifférentes au climat (érotique, sensuel, esthétique) résultant de la présence autour d’elles d’autres jolies femmes.
Sexué, pas forcément sexuel
Enfin et surtout, comme dans le sport, en tout cas dans certains sports (escalade par exemple ou sports de combat, Taï Chi Chuan, karaté, boxe, etc.), les relations hommes-femmes apparaissent sur un fond social, communautaire, esthétique qui donne sens à la rencontre (une dimension relationnelle que voit bien Montherlant, Les Olympiques, 1926, ou Jean Prévost, Plaisir des sports, 1925). Pour le dire à nouveau, les rencontres sont sexuées avant d’être sexuelles. On pourrait dire qu’elles sont métasexuelles, c’est-à-dire médiées par une passion qui se situe en amont de la dimension sexuelle sans pour autant (heureusement) abolir celle-ci. Le possible passage à la sexualité se fait sur un fond commun partagé. Un fond imaginaire et une certaine musique partagée de la vie. « Je suis finie, j’ai peur, quel mystère, quelle beauté, mon Dieu… » dit Ingrid Bergman dans Stromboli de Roberto Rossellini (1950). C’est cette peur qu’il s’agit de surmonter par les danses de couple. Et le défi concerne les hommes comme les femmes.
Pierre Le Vigan est essayiste et philosophe. Il a publié récemment Avez-vous compris les philosophes I à V (La Barque d’or) ; Clausewitz, père de la théorie de la guerre moderne (Perspectives libres) ; Le Grand empêchement. Comment le libéralisme entrave les peuples (Perspectives libres) ; Nietzsche. Un Européen face au nihilisme (La Barque d’or) ; Les démons de la déconstruction (La Barque d’or). Il publiera prochainement un essai sur L’architecture et la question de la beauté, et un essai sur Napoléon et la géopolitique.