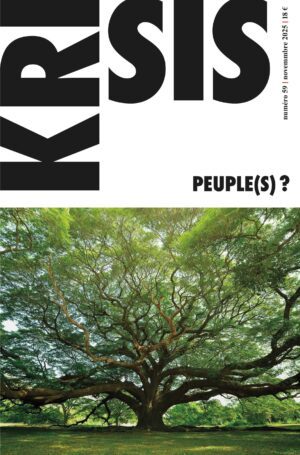La solidarité internationale est un phénomène nouveau qui est apparu d’abord comme une composante de l’opinion publique, autrement dit comme un thème des médias. Ses prémices au XIXe siècle, à l’occasion des insurrections polonaises et de la guerre d’indépendance grecque, sont contemporaines du développement de la presse, du télégraphe et du chemin de fer qui permet de faire « Le Tour du monde en 80 jours ». Mais c’est dans la seconde moitié du XXe siècle qu’elle a pris la place que nous lui connaissons dans le discours politique et qu’elle est devenue, avec les agences de développement et les ONG, un véritable secteur d’activité.
Elle s’est installée dans le champ politique comme une voix de la conscience humanisant les monstres froids que sont les États, au point que certains politiques en ont fait une des motivations de leur action internationale. C’est particulièrement le cas aujourd’hui avec l’Ukraine et avec la Palestine, mais cela a été aussi vrai de l’internationalisme soviétique comme de de l’aide publique au développement (APD) déployée dans les pays du sud à partir de 19491 avec l’objectif d’y prévenir des révolutions communistes. Dans tous les cas, il est aisé de repérer des motivations moins altruistes, mais la solidarité internationale est devenue un thème obligé. Au point que le parlement français a voté à l’unanimité en 2021 la loi de programmation de l’aide au développement. A l’unanimité signifie avec les voix du RN, parti dont le fondateur avait écrit dans le programme de sa première campagne présidentielle un demi-siècle plus tôt: « La coopération sera supprimée ».
De l’opinion publique, on est passé à la société civile et aux organisations dites non gouvernementales. A de rares exceptions près (en France Médecins sans Frontières), elles sont financées majoritairement par les pouvoirs publics, qu’il s’agisse des organismes internationaux, des États ou des collectivités locales. Pour les agences internationales et pour les États, les ONG sont devenues des opérateurs dont les coûts sont inférieurs à la mise en œuvre des programmes d’aide par des coopérants bénéficiant du statut d’agents publics. Dans les pays du sud, se sont constituées des ONG locales qui agissent, selon l’expression forgée par J-P Olivier de Sardan, comme des « courtiers en développement ». Un des domaines d’action des ONG, la promotion de la démocratie ou « bonne gouvernance », est devenu un canal d’influence des démocraties occidentales.
Ces financements ont entraîné une professionnalisation du secteur, avec du personnel permanent, des frais de structure et donc la nécessité de rechercher de nouveaux financements. Un véritable lobby de la solidarité internationale a ainsi obtenu de divers gouvernements français non seulement l’engagement d’augmenter le budget de l’aide Publique au Développement à 0,7% du PIB2 mais aussi d’en attribuer un certain pourcentage aux ONG.
Laïcisation de la charité
Toujours dans la seconde moitié du XXe siècle, les collectivités locales ont découvert la solidarité internationale, d’abord sous la forme des jumelages. Ce fut l’occasion de sympathiques voyages qui ne manquèrent pas de dégénérer en avantages en nature des élus, dont le Canard Enchaîné a longtemps tenu la chronique. Aujourd’hui, l’action internationale des collectivités locales se divise essentiellement en deux branches, l’économie (recherche de marchés pour les entreprises locales et d’investisseurs) et le financement d’ONG souvent liées aux diasporas locales.
La solidarité est une laïcisation de la charité, correspondant à la substitution, à partir du XIXe siècle, de la religion de l’humanité à la religion chrétienne. Mais l’ajout de la dimension internationale n’est pas un simple élargissement, il entraîne un changement de nature. La charité prônée par toutes les religions est un devoir envers son prochain, c’est-à-dire son voisin. Son déclencheur est une perception de la souffrance, une sympathie. Dans le cas de la solidarité internationale, cette perception est médiée. C’est par l’écran de télévision, ou désormais de téléphone, que nous arrive l’image ou le témoignage de la souffrance.
Cette médiation a plusieurs implications. La première est que la solidarité est devenue un instrument de politique internationale piloté par les médias et ceux qui les contrôlent. Ils choisissent parmi toutes les misères du monde celles qu’ils vont montrer aux téléspectateurs. A cet égard, les nouveaux médias d’internet ne constituent pas un changement fondamental. Le choix des images revient de plus en plus à des algorithmes, mais ceux-ci ne sont ni neutres ou innocents. Au pouvoir de sélectionner les images s’ajoute celui de les cadrer, c’est-à-dire de les constituer en récit. Les exemples abondent de scènes qui, photographiées en gros plan ou en plan large racontent une toute autre histoire. A l’extrême, il y a le faux récit des images poignantes d’enfants atteints de maladies génétiques censées illustrer une famine à Gaza. Et bien sûr, ces pouvoirs s’exercent également en négatif en choisissant de ne pas montrer des images de drames qui, dès lors n’existent pas dans la conscience publique des pays riches. La solidarité internationale est toujours fabriquée.
Une misère virtualisée
La médiation technologique de la souffrance et du sentiment de solidarité a une autre conséquence : l’abolition de la charité. Quiconque a un peu parcouru le monde pauvre hors des mégalopoles sait qu’on y a le souci du prochain, connu ou inconnu. La souffrance du pauvre y est vue comme un phénomène de nature qu’il est normal de côtoyer et qui vous crée une obligation. En Europe, le mendiant était autrefois un personnage normal du parvis de l’église. Aujourd’hui, la place de la misère est sur l’écran de télévision ou d’ordinateur qui nous en livre une forte dose quotidienne. Ce flot de souffrances médiatisées par les écrans entraîne une forme de mithridatisation. Le SDF dans le métro ou couché sous une porte cochère des beaux quartiers n’est pas un objet de sympathie mais de scandale. On passe son chemin en se dispensant de croiser son regard et l’on attend de l’État qu’il le fasse faire disparaître du paysage, comme il l’a fait, sous les louanges, à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris. Cette priorité donnée au lointain sur le voisin comme objet de sympathie est un trait de l’enfermement anomique dans leurs écrans des sociétés développées.
Si Jean-Marie le Pen s’est acquis le privilège d’incarner le diable sur la scène politique française, ce n’est pas seulement à cause de ses provocations négationnistes, c’est aussi parce qu’il a eu cette phrase dont la gauche a fait une sorte d’anti-totem : « Je préfère mes filles à mes nièces et mes nièces à mes voisines ». Cette formule, qui est censée résumer l’esprit d’exclusion de la droite, énonce en fait une évidence que peu d’entre nous, de gauche comme de droite, renieraient dans leur particulier. Si elle a pu être érigée en repoussoir, c’est parce que, comme la reproduction sexuée par accouplement d’un homme et d’une femme, elle sent trop l’organique3. Gilles Deleuze qui louait « le corps sans organes » avait fait de la capacité à regarder d’un point de vue lointain l’un des marqueurs de la gauche.
Ce qui s’oppose à l’organique, on le voit chaque jour d’avantage, c’est le technologique, c’est-à-dire la numérisation, c’est-à-dire la déréalisation. C’est vrai du regard qui ne se pose plus sur le monde mais sur l’écran, c’est vrai aussi de l’abolition de la distance par le transport aérien perfectionné par l’électronique. La solidarité internationale est née non seulement de la télévision mais aussi de l’aviation. Pas d’envoyés spéciaux, pas d’humanitaires, pas d’experts en développement sans avions4. Il revient à la médiologie, ce nouveau département du savoir, de décrire le « petit remplacement », comme dirait Renaud Camus, du voyage, lente expérience de la distance, des frontières, apprentissage douloureux de l’altérité, par « le voyage » , expédition quasi-instantanée d’un colis humain dûment contrôlé, d’un aéroport à un autre aéroport identique, suivie d’un séjour dans un hôtel aux normes occidentales. Le vrai voyage, les œuvres des authentiques voyageurs comme Nicolas Bouvier en témoignent, est une prise de risque qui seule permet d’écarter les voiles de nos préjugés pour parvenir à une forme de sympathie, à un début de compréhension des indigènes.
La bonne conscience mise au service du « soft-power »
La solidarité internationale est un mot d’ordre purement occidental. Elle n’est pas une relation, sinon celle que décrit le proverbe africain : « la main qui reçoit est toujours en-dessous de celle qui donne ». Cela est si évident qu’on a récemment vu diverses tentatives de donner de l’aide au développement une formulation moins inégalitaire en la couplant à l’exigence écologique : développement durable, co-développement, Biens publics mondiaux, etc. Elle est pourtant considérée comme un marqueur de démocratie, entendue sans doute comme bénévolence. Les seuls pays qui ont atteint ou dépassé l’objectif des 0,7% d’APD sont les pays scandinaves et l’Allemagne, soit ceux qui semblent le mieux incarner l’idéal démocratique occidental.
Soulagement facile du remords de l’homme blanc, instrument de « soft power » des États, alibi des paresseux du ciboulot qui prétendent résoudre le problème migratoire en augmentant l’APD, business pour certains, la solidarité internationale est une dimension insécable de la mondialisation libérale dont elle est contemporaine. Lui survivra-t-elle ? Le « capitalisme de la finitude »5 qui est en train de se substituer à la « mondialisation heureuse » sera certainement moins enclin à gaspiller des ressources pour entretenir la bonne conscience des dominants. Dans le nouveau monde inquiet qui émerge sans arbitre hyper-puissant pour y faire régner l’ordre, le « hard power » comptera plus que le « soft power ».
Pour autant, l’unité du monde scellée par les photographies des astronautes, ne sera pas abolie, les images continueront à circuler d’un bout à l’autre de la planète. Mais quelles images ? L’intelligence artificielle est en train de porter un coup fatal à leur crédibilité. Or, nous l’avons vu, les images sont le moteur principal de la solidarité internationale. La dévalorisation des images, dans une civilisation dominée par le regard, est un phénomène dont on ne mesure pas encore les conséquences. Les optimistes diront que la prise de conscience de ces bidouillages va renforcer l’esprit critique. Les pessimistes y verront l’apparition d’une forme radicalement nouvelle d’iconoclasme – on ne peut plus croire les images – qui va emporter dans un tourbillon de confusion notre représentation du monde, notre confiance dans le discours politique et au-delà, notre croyance dans la Vérité. Le fanatisme s’en accommodera fort bien : il n’a pas besoin de croire à la vérité de ce qu’on lui montre, la vérité n‘est pas nécessaire à la haine.
Quant à la solidarité internationale, c’était peut-être une ultime tentative du post-christianisme de confondre la Cité terrestre et la Cité de Dieu. L’une des précédentes, l’internationalisme prolétarien, s’est volatilisée le 1er août 1914. La solidarité internationale nous protègera-t-elle mieux d’un nouvel été 14 ? Il est permis d’en douter.
Notes :
1 Discours d’investiture de Harry Truman le 20 janvier 1949
2 Conformément à un engagement des Nations-Unis de 1970, rarement atteint, jamais en ce qui concerne la France.
3 cf Gilles Carasso, La Solution biotechnologique, in L’Atelier du Roman , n° 99 décembre 2019
4 Ayant travaillé de 2004 à 2006 au Niger, pays où le tourisme et l’industrie étaient inexistants, j’ai constaté que la majorité des passagers de la ligne Paris-Niamey étaient des blancs.
5 Cf Marc Orain, Le Monde confisqué, Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle), Flammarion 2025