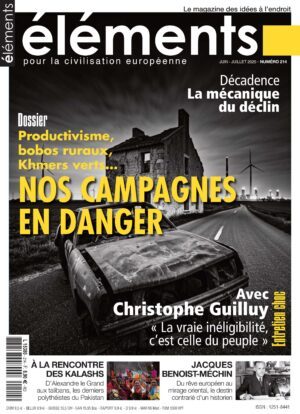REVUE ÉLÉMENTS. Pour déclencher la guerre dite des Douze jours, Israël a prétendu mener une action défensive contre le programme nucléaire et balistique iranien. Cette séquence ne vous rappelle-t-elle pas, dans une certaine mesure, l’invasion de l’Irak en 2003 sous couvert de neutraliser les armes de destruction massive de Saddam Hussein ?
THIERRY COVILLE. Oui, ce parallèle m’a frappé. Comme en 2003 avec l’Irak, on assiste à une guerre sans preuve convaincante. Aucune donnée solide n’indique que l’Iran cherche à fabriquer la bombe atomique. L’attaque préventive viole la Charte des Nations unies, tout comme les frappes contre des sites nucléaires civils ou l’assassinat de scientifiques.
La différence avec 2003, c’est l’absence de réaction européenne. À l’époque, des voix comme celle de Jacques Chirac s’étaient élevées. Aujourd’hui, Emmanuel Macron affirme qu’Israël, en attaquant, exerce son droit à la légitime défense, ce qui est juridiquement absurde. Et quelques jours plus tard, il affirme que l’offensive va « dans la bonne direction ». On ne comprend plus rien. Pire encore, le ministre des Affaires étrangères français a invité les Iraniens à négocier sous les bombes. L’Europe ne défend plus le droit international et sa diplomatie s’est effondrée.
REVUE ÉLÉMENTS. Les Européens et les Américains estiment sans doute que, faute d’avoir pu contenir le programme nucléaire iranien par la négociation ou par l’action de l’AIEA, il ne restait plus que la force pour y parvenir.
THIERRY COVILLE. De ce point de vue, médias ont participé à une vaste entreprise de désinformation. Alors même qu’une sixième session de négociations sur le nucléaire était prévue, les Israéliens ont attaqué sans attendre. On découvre aujourd’hui qu’il y avait une coordination avec les États-Unis. Cela signifie que les Américains n’ont jamais négocié de bonne foi ; leur but était de préparer l’attaque en endormant l’Iran. Cette situation renforce la position des durs du régime iranien, qui affirmaient depuis le début que les négociations avec Washington n’étaient qu’un piège. Aujourd’hui, même des dirigeants modérés doutent de l’intérêt du dialogue. Trump avait déjà trahi l’Iran en 2018 en sortant de l’accord de Vienne que Téhéran respectait. Et maintenant, en pleine négociation, l’Iran est attaqué. Beaucoup de responsables iraniens se demandent à quoi bon négocier si c’est pour être trahis. Même le président Pezeshkian, pourtant favorable au dialogue, a été visé par une tentative d’assassinat israélienne. Les Européens exhortent l’Iran à reprendre les négociations, mais les Iraniens rétorquent : négocier pour quoi ? Pour se faire attaquer à nouveau ?
REVUE ÉLÉMENTS. Cette spirale a-t-elle contribué à la reprise par l’Iran de la diplomatie des otages, avec notamment les deux Français emprisonnés à Evin ?
THIERRY COVILLE. Oui, malheureusement. La sortie américaine de l’accord a eu pour effet de renforcer les radicaux, qui ont une vision purement sécuritaire des relations internationales. Leur logique, c’est que les Occidentaux ne respectent pas le droit et que seule la force peut les faire plier. On l’a vu avec le cas de l’Anglaise Nazanin Zaghari-Ratcliffe, détenue en Iran jusqu’au remboursement d’une vieille dette britannique.
REVUE ÉLÉMENTS. Sur le plan économique, le régime iranien peut-il survivre durablement sous sanctions, en comptant seulement sur la Chine et la Russie ?
THIERRY COVILLE. L’économie iranienne reste sous pression, mais elle a partiellement rebondi. À la fin du mandat Trump, les exportations de pétrole étaient tombées à 200 000 barils par jour, contre plus de 2 millions auparavant. Aujourd’hui, grâce aux achats chinois et à des circuits opaques -pétroliers fantômes, détours par la Malaisie -, l’Iran exporte à nouveau 1,5 million de barils par jour. Les échanges avec la Chine sont devenus essentiels : Pékin achète la majeure partie du pétrole iranien et fournit en retour des produits manufacturés. La Chine représente désormais près de 26 % du marché iranien. Cette dépendance croissante à Pékin est une réalité économique, mais elle permet au régime de résister, au moins à court terme.
REVUE ELEMENTS. Le régime respire provisoirement avec l’effet drapeau due la guerre. A plus long terme, entrevoyez-vous une possible transition politique ?
THIERRY COVILLE. Je fais rarement des prévisions, mais j’essaie d’abord de comprendre ce qui se passe. Je pense qu’il y avait un sociologue iranien pendant la crise de 2022 qui avait dit quelque chose d’assez vrai. Alors les pourcentages, on n’en sait rien, mais parle de 15%, d’Iraniens peut-être plus, qui soutiennent le régime, quoi qu’il fasse. C’est en quelque sorte le MAGA iranien qui répète « Mort à l’Amérique »
De l’autre côté, 15% de la population haït le régime. Au milieu, la classe moyenne éduquée urbaine reste très nationaliste et souhaite la transition vers la démocratie et l’État de droit. Pour autant, ces Iraniens ne prendront jamais un fusil, pas plus qu’ils ne descendront dans la rue. Ils veulent une évolution pacifique, contrairement aux guerres civiles qui ont déchiré la Syrie et l’Irak. La répression, d’une ampleur considérable en 2022 face au mouvement « femme, vie, liberté », effraie aussi cette classe moyenne. Malgré tous les reproches qu’elle lui adresse, cette dernière ne voit pas d’alternative politique crédible à la République islamique d’Iran.
Il y a un rapport de force entre la société et le système politique. Je me suis rendu en Iran juste avant la guerre. Aujourd’hui, on croise des femmes sans voile dans la rue, dans les débats télévisés, on conteste même le rôle du Guide, ce qui était tabou auparavant. C’est ce que j’ai appelé dans un livre La révolution invisible.
REVUE ÉLÉMENTS. Le système politique iranien en a-t-il tiré les enseignements qui s’imposent ?
THIERRY COVILLE. Pour l’instant, les priorités semblent ailleurs. D’après ce que j’entends des mouvements d’opposition intérieure — à l’exception notable du Prix Nobel Narges Mohammadi —, la défense de l’intégrité territoriale passe avant toute autre considération. L’Iran a été attaqué, et la protection du pays prime le reste.
Du côté du pouvoir, j’ai récemment entendu une interview intéressante d’Ali Larijani, ex-président de l’Assemblée et conseiller du Guide suprême. Il y reconnaît que le régime a regagné un peu de légitimité grâce à l’élan nationaliste de la population qui a soutenu le pays face à l’agression. Larijani insiste sur la nécessité pour le système politique de ne pas répéter les erreurs du passé et de préserver la confiance du peuple, de renouer avec lui. Mais le contexte reste celui d’un pays en état de guerre. Les autorités craignent que le cessez-le-feu soit précaire. Quant à savoir si le pouvoir fera preuve de modération, c’est incertain, car ce sont actuellement les radicaux qui dominent. Je pense que ceux qui s’attendent à un changement de régime rapide font fausse route.
Thierry Coville a publié L’Iran, une puissance en mouvement (Eyrolles, 2022)