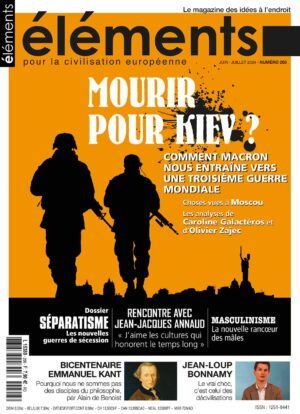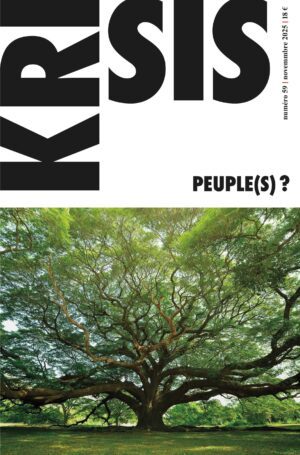À la suite du discours du général Mandon appelant le pays à se préparer à une guerre avec la Russie, Élisabeth Lévy a publié sur le site du magazine Causeur une chronique approuvant ces propos, intitulée « Mourir pour Kiev ». Ce titre fait écho à celui de l’article de Marcel Déat publié en mai 1939, « Faut-il mourir pour Dantzig ? ». Alors que la garantie franco-britannique donnée à la Pologne avait affirmé notre devoir de solidarité, la question reçut quelques mois plus tard une réponse ambigüe : on déclara la guerre et puis on ne la fit pas ou presque pas, avant de finalement la subir.
La fière proclamation de la solidarité franco-polonaise n’a sauvé la Pologne ni du dépeçage de 1772-1795 (et Bonaparte n‘a pas tenu sa promesse de rétablir la souveraineté polonaise), ni en 1830, ni en en 1863, ni en 1939, quand nous sommes restés l’arme au pied pendant que Hitler et Staline rejouaient la pièce du partage. Et comme l’a dit avec franchise Claude Cheysson, alors ministre des Relations extérieures, lors de la loi martiale polonaise de 1981 : « Naturellement nous ne ferons rien. » L’exception, qu’il faut relever, à l’impuissance française à traduire en actes sa solidarité avec le Pologne, c’est 1920, le « miracle de la Vistule », quand une solide délégation d’officiers français (mais sans forces combattantes) a aidé la jeune armée polonaise à s’organiser pour repousser l’Armée rouge parvenue aux portes de Varsovie.
La morale n’est pas la stratégie
La cause immédiate de la Seconde Guerre mondiale a été le conflit germano-polonais autour de ce fameux corridor de Dantzig. C’était une création de la Conférence de Versailles chargée d’organiser le rabotage de l’empire allemand et le démembrement de l’empire austro-hongrois, la même qui a créé une Tchécoslovaquie avec 3 millions d’Allemands à l’intérieur de ses frontières. Ce corridor séparait la Prusse occidentale de la Prusse orientale pour offrir un accès à la mer au nouvel État polonais. On peut épiloguer sur les causes profondes de la guerre, sur l’expansionnisme hitlérien, il n’en demeure pas moins que les occasions des deux agressions qui ont déclenché la guerre, les Sudètes et Dantzig, ont été créées par les défauts d’un traité d’inspiration wilsonnienne qui se souciait plus de la morale, du droit de peuples, que du réalisme géopolitique.
Aujourd’hui la réalité géopolitique de l’Europe à laquelle la France est confrontée n’est plus la même. Du fait des grands nettoyages ethniques de 1942-45, la question des minorités ne se pose plus de façon aussi aiguë que dans l’entre-deux-guerres. Pourtant, à la suite de la disparition de l’Union soviétique, elle a réapparu en Ukraine et dans les pays baltes avec les minorités russophones, ainsi que dans le Caucase. Mais elle est incompréhensible pour des Européens qui ont grandi dans un monde où la coïncidence des États et des appartenances nationales semble aller de soi. L’autre grand changement est que la politique étrangère française a perdu son principe organisateur essentiel qui était de se prémunir contre le péril allemand. Une troisième différence est que la France est insérée dans l’Union européenne, un objet politique nouveau, à la fois espace économique commun, alliance politique, et proto-État fédéral.
Mais il y a une constante qui a traversé le XXe siècle : c’est la question de l’organisation de « la ceinture des peuples mêlés » (Hannah Arendt), c’est-à-dire de l’équilibre des forces et des intérêts nationaux en Europe orientale, ouverte par la disparition des empires en 1917-18. Un gouffre d’instabilité s’est alors creusé, où s’est abîmée un seconde fois l’Europe en 1939. Il fut ensuite plus ou moins masqué en 1945 par l’expansion soviétique, puis après l’effondrement de l’Union soviétique par les élargissements successifs à l’est de l’OTAN et de l’Union européenne. Mais alors qu’on l’avait cru refermer en 1991, il s’est réouvert entre Kiev et Donetsk en 2014. Et les élargissement, justifiés à nouveau par le droit des peuples, entraînent l’Europe occidentale vers ce gouffre.
Qui est prêt à mourir ?
Ce qui se poursuit, après l’illusoire « fin de l’histoire », c’est l’affrontement de la Pologne et de la Lituanie avec la Russie qui dure depuis trois siècles et qui a forgé la nation et l’État ukrainiens. Et de même, prolongé jusqu’à la guerre d’Hiver finno-soviétique, le face-à-face de la Scandinavie avec la Russie a des racines historiques aussi profondes, déterminées par l’enjeu du contrôle de la mer Baltique.
Avec le recul on peut dire qu’il ne s’agissait pas en 1939 de mourir pour l’intégrité de la Pologne, mais pour la liberté de l’Europe. Peut-on en dire autant aujourd’hui de « Mourir pour Kiev » ? Certainement pas, les projets de Vladimir Poutine n’ont rien à voir avec ceux de Hitler. Celui-ci avait soif de lebensraum, d’espace vital, celui-là cherche à fortifier un trop grand espace. S’il ne s’agit pas de cela, alors affirmer une solidarité jusqu’à la mort, prendre le risque d’une confrontation nucléaire, c’est affirmer que l’Ukraine, ou du moins l’Estonie ou la Pologne, parce qu’ils appartiennent à l’Union européenne, sont des parties de notre nation, c’est effectuer ce saut fédéral que, si j’ai bien compris, Élisabeth Lévy récuse. Car, Alain de Benoist le rappelait à la suite de Carl Schmitt dans sa dernière chronique, on ne doit faire la guerre, envoyer ses enfants sur le champ de bataille, que quand la survie de la nation est en jeu.
Poutine n’est pas Hitler
Si l’on peut tenir des propos aussi inconséquents c’est parce qu’on croit, dans le fond, que ça ne se produira pas. La perception de la « menace russe » n’a rien de comparable pour les Français, et à juste titre, avec ce qu’était la menace allemande. Ceux qui ont autorisé le chef d’état-major de la grande muette à s’exprimer comme il l’a fait ne le croient sans doute pas non plus. Notre président nous a habitués à son usage immodéré du mot « guerre ». Mais tous jouent un jeu dangereux. Fin juillet 1914, c’est l’escalade des mobilisations qui a rendu inéluctable le dérapage final vers la catastrophe.
Au lieu de sonner le clairon et d’aller chercher des preuves de la menace russe dans des jeux d’influence africains ou dans le nouveau Far West de l’espace numérique, on ferait mieux de se pencher enfin sérieusement sur les causes des paranoïas croisées est-européennes : l’angoisse de l’invasion russe chez les est-Européens, celle de la menace otanienne chez les Russes. Et, sans agiter les mots ronflants, rechercher un accord de paix durable, c’est-à-dire celui qui offrira la seule véritable garantie : la création d’un système européen d’équilibre des forces et des intérêts intégrant la Russie, comme l’avait proposé, en vain, François Mitterrand en 1991.