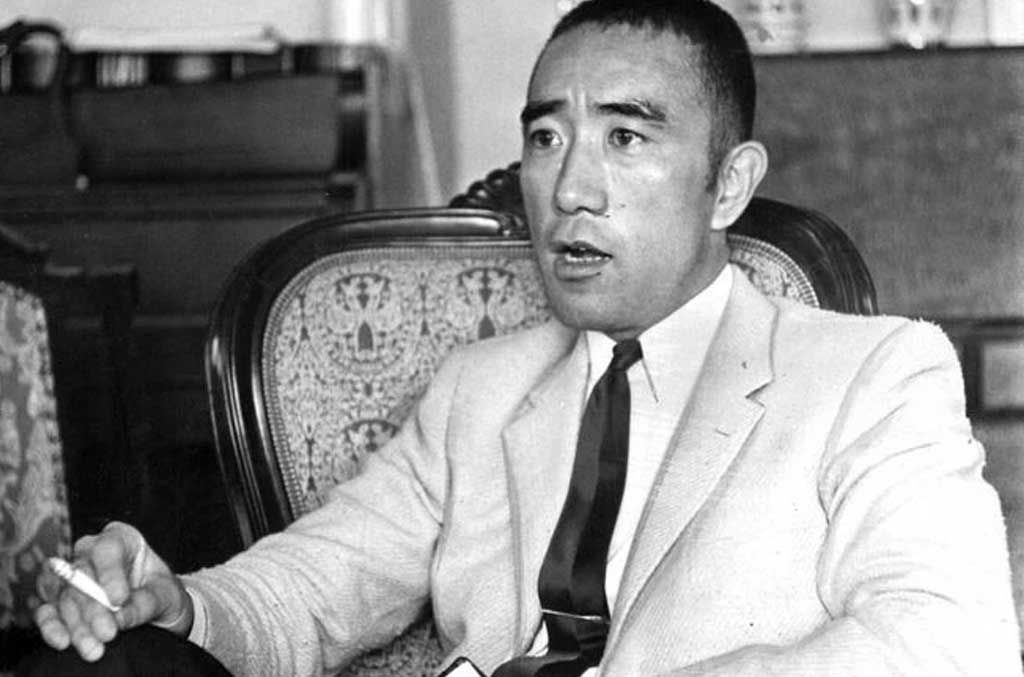Une célèbre maxime de La Rochefoucauld tinta confusément à mon esprit, comme s’adressant directement à Mishima : « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement ». Aphorisme trempé dans l’acier du classicisme français, auquel l’écrivain japonais ne fut pas insensible. Le soleil et l’acier, lu et relu chaque été, produisait l’enchantement trouble auquel nulle âme un peu mal tournée ne saurait résister. Enchantement suscité par la jointure du soleil et de la mort, irradiés par la parfaite lumière de la perversité. « Le soleil d’été, écrit Mishima, prodiguait le fin tissu d’une lumière impartiale à la création tout entière. » Certes, mais le soleil de l’écrivain n’était pas tout à fait ce bel astre de clarté. Son soleil est tragique, envoûtant, mystique, impérial et mortel. Ses taches sont vouées à l’implosion avec l’ensemble de ses rayons.
Ce livre inclassable, subjectif et lyrique, morbide, tonifiant, solaire, romantique jusqu’à la décomposition, d’un classicisme violemment inverti, distillait son bienfaisant poison. Mishima situait cet ouvrage étrange et somptueux « à mi-chemin entre la nuit des confessions et le grand jour de la critique », avant de proposer une dénomination : « la critique confidentielle ». Il s’agissait alors de trouver « un mode d’expression du corps ». Un objet hybride donc. Récit d’une initiation, prélude d’une destruction : édification d’un corps, forteresse de muscles à la Vauban, qui se dresse face à l’influence délétère des mots, à « leur pouvoir de ronger », « leur capacité corrosive ». Car, si Mishima était un écrivain, un poète, en dépit de ses dénégations – « Je n’ai jamais été poète » – et l’un des plus grands, il situait sa destinée au-delà des mots, et même contre eux en quelque sorte. En cela, il est à rapprocher d’un Paul Valéry, dont la défiance à l’égard du langage et des ses sortilèges n’a pas d’égale, hormis chez le deuxième Wittgenstein, celui des Investigations.
Pour Mishima – c’est la description qu’il en fait – c’est comme si les mots s’attaquaient à son corps, à l’exemple des fourmis blanches qui se nourrissent d’un pilier de bois. Ainsi, deux tendances contradictoires s’éveillèrent en lui, qui dégénérèrent en antinomie complète. « L’une, écrit-il, fut la détermination de favoriser en toute loyauté la fonction corrosive des mots et d’y consacrer ma vie professionnelle. L’autre fut le désir d’affronter la réalité dans un domaine où les mots ne joueraient aucun rôle. » L’impalpable irisation des sens en éveil face au monde perçu fut d’emblée entravée par la présence invasive des mots.
« À l’école, rapporte-t-il, mon maître se montrait souvent mécontent de mes rédactions, vierges de tout vocable qui aurait pu avoir trait à la réalité. Il semble que, dans mon esprit d’enfant, j’eusse quelque pressentiment de la subtilité, de la délicatesse des lois du langage et que je n’ignorasse pas la nécessité d’éviter autant que possible d’entrer en contact avec le réel au moyen des mots si l’on voulait, tout en profitant des avantages de leur fonction corrosive, échapper à leur effet négatif, si, soit dit plus simplement, on voulait maintenir la pureté des mots. D’instinct, je savais que la seule possibilité qui s’offrait était de surveiller sans cesse leur action corrosive, de peur qu’elle ne vînt soudain buter contre un objet qu’elle pourrait attaquer. » Dès l’enfance, Mishima consommait le divorce entre le mot et le monde, qui sera le drame intime de Mallarmé, intime et néanmoins métaphysique. On croirait une ruche qui s’ébranle au cœur d’un essaim démâté, telle une conque que toute fêlure imprègne. Mallarmé évoque ce concret qui se volatilise, dans un style plus impressionniste et plus onirique : « Si clair, cet incarnat léger, qu’il voltige dans l’air assoupi de sommeils touffus. »
Dépasser les mots
Pour rejoindre la réalité, les mots, non seulement ne suffisent pas, mais ils deviennent l’obstacle majeur. Le corps, qui naturellement devrait accomplir cette tâche consistant à nous plonger dans le grand bain de l’existence, est malheureusement contaminé de mots. Le corps souffre ambiguïté. « J’ignorais que le corps de l’homme ne se révèle jamais »en tant qu’existence ». Mais telles que je voyais les choses, il aurait dû apparaître, en toute clarté et sans équivoque, comme existant » Afin d’assurer au corps la possibilité d’être au monde, pleinement existant, il convient de le libérer des mots : « Et, puisque, échappant à la norme, ma propre existence corporelle était sans aucun doute le produit de la corrosion intellectuelle des mots, alors le corps idéal – l’existence idéale – doivent, me dis-je, demeurer absolument indemnes de toute interférence des mots. Ses caractéristiques pourraient se résumer ainsi : taciturnité et beauté formelle. » Ici commence « la poursuite d’une beauté exempte absolument de toute corrosion. »
« Grâce au soleil et à l’acier, je devais apprendre le langage de la chair, à peu de chose près comme on apprendrait une langue étrangère. Ce fut une seconde langue, un aspect de mon développement spirituel. » Il n’en a pas toujours été ainsi, avant cela Mishima et le soleil étaient brouillés : « L’hostilité envers le soleil constituait mon unique rébellion contre l’esprit de l’époque. Je soupirais après la nuit de Novalis et les crépuscules irlandais de Yeats. » Mais il y a eu les porteurs de châsses mobiles, au nombre desquels Mishima a eu le privilège de compter, lors de la fête locale des reliques. Et la révélation de l’azur, d’un ciel pur, bleu et insolite, voûte céleste servant de decorum au pathos tragique, dispensant ses « éléments d’ivresse et de clarté surhumaine ». Il y eut, enfin, la réconciliation : « C’est en 1952, sur le pont d’un navire où j’accomplis mon premier voyage à l’étranger, que j’échangeai avec le soleil la poignée de main de la réconciliation. Depuis ce jour, je suis devenu incapable de lui fausser compagnie. Le soleil fut désormais mon compagnon sur la grand-route de ma vie. Petit à petit, ma peau a bruni sous son hâle, signe que j’appartenais désormais à l’autre race ».
L’acier, impatient, entra en scène, puisque le soleil « m’ordonnait d’édifier une demeure nouvelle et robuste où mon esprit, à mesure qu’il s’élèverait peu à peu vers la surface, pourrait vivre en sécurité. Cette demeure, poursuit-il, c’était une peau bronzée et luisante, des muscles puissants, délicatement ondulés. » L’acier deviendra alors l’alliage qui ressoudra les mots et le corps. Le corps, en changeant de forme, adoptera des formes analogues aux formes artistiques. « Les muscles sont devenus progressivement quelque chose qui s’apparente au grec classique. Ressusciter la langue morte nécessitait la discipline de l’acier. »
Culturisme et littérature
La pratique du culturisme et la littérature se compénètrent, le corps et les mots ne sont plus des antagonistes absolus, puisque le développement musculaire rejaillit sur le style. « À présent, j’avais fait de mon style une chose appropriée à mes muscles : il était devenu souple et libre, dépouillé de tout ornement onctueux, tandis qu’avait été assidûment maintenue une ornementation « musculaire ». […] Par-dessus tout, je me préoccupais de distinction. […] Mon idéal en fait de style aurait possédé la beauté sérieuse du bois verni dans le vestibule d’une demeure de Samouraï par une journée d’hiver. » Le fantasme d’une harmonie possible entre ces entités contraires surgit : « Quelque part en moi, je commençais à projeter d’unir l’art et la vie, le style et une éthique de l’action. »
Cependant, par-delà l’édification d’un corps que la statuaire grecque n’aurait pas reniée, la mort veille. « Par-delà le processus éducatif, s’en dissimulait également un autre, un dessein romantique. L’élan romantique, à partir de l’adolescence, avait toujours été en moi une veine cachée, n’ayant de signification qu’en tant que destruction de la perfection classique. » Le romantisme comme destruction de la perfection classique, voilà une conception des choses qui possède de forts accents maurrassiens. Stéphane Giocanti, dans son livre Yukio Mishima et ses masques n’a pas manqué de relever les nombreuses analogies qui lient – « l’analogie est le plus beau de tous les liens » disait Platon ! – le provençal au japonais. Mais poursuivons pour conclure : la beauté classique était en proie à la pulsion de mort romantique depuis l’origine. « En l’espèce, je chérissais un élan romantique vers la mort, tout en exigeant en même temps comme véhicule un corps strictement classique ; un sentiment particulier de la destinée me faisait croire que la raison pour laquelle mon impulsion romantique vers la mort demeurait inaccomplie dans la réalité, c’était le fait immensément simple que me manquaient les nécessaires qualifications physiques. Une charpente puissante et tragique, une musculature sculpturale étaient indispensables à une mort noblement romantique. » Le 25 novembre 1970, à 10 heures 30 du matin, au quartier général des forces d’autodéfense japonaises, en plein cœur de Tokyo, Mishima se suicide par seppuku, après avoir prononcé un discours, sans recevoir d’écho autres que les huées de la foule. Alors, les mots étant inutiles, il ne restait plus qu’à détruire le corps. Heureusement, il restera toujours un hiatus entre le corps de Mishima et ses mots. En effet, si Mishima s’est donné la mort, il n’a jamais laissé la mort corrompre son style, auquel ses mots doivent l’immortalité.
Pour en savoir plus :