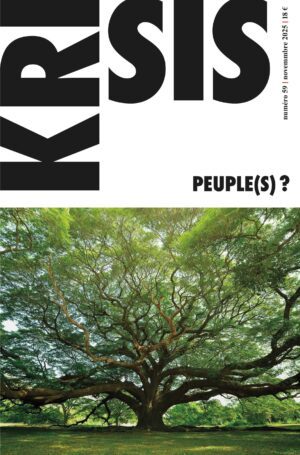Comme dans la chanson de Gaston Ouvrard, le septième art américain n’est pas « très bien portant ». À en croire Le Point de ce 7 août, « Seuls 762 millions de billets ont été vendus en 2024, contre 1,2 milliard en 2019. » Soit une baisse de 37 %. Dans le même temps, confinement oblige, les plates-formes de streaming se sont taillées la part du lion, avec 38 % de parts de marché supplémentaires. Pour tout arranger, Hollywood tourne en rond, n’en finissant plus d’exploiter des franchises faisant de moins en moins leurs preuves, des super-héros Marvel et DC, en passant par Star Wars, du Seigneur des Anneaux à Harry Potter. Bref, ce n’est pas l’imagination qui risque de fatiguer les scénaristes locaux. Lesquels se sont d’ailleurs mis en grève en 2023, près de cinq mois durant, occasionnant ainsi des pertes de plusieurs milliards de dollars à leurs employeurs.
Les artistes battent en retraite…
Et, cerise sur le pancake… l’élection de Donald Trump. Sans surprise, l’écrasante majorité du gratin hollywoodien a pris fait et cause pour Kamala Harris, sa rivale démocrate malheureuse. Ça, ce n’est évidemment pas le plus grave, sachant que nos héros d’un jour ont jugé plus raisonnable de demeurer discrets lors de la dernière cérémonie des oscars. L’occasion de vérifier, qu’administré à doses homéopathiques, le courage ne présente pas de danger majeur pour la santé. En d’autres termes, la résistance acharnée de Fort Alamo ne devrait pas être pour demain ; ce d’autant plus que les géants technologiques de la Silicon Valley avaient déjà fait allégeance à Donald Trump en pleine campagne présidentielle. Et comme ce sont les mêmes qui, rachetant les studios traditionnels à tours de bras, deviennent les nouveaux donneurs d’ordres, tout ce petit monde devrait bientôt réintégrer Beverley Hills, ses piscines, sa cocaïne, ses villas, ses majordomes et autres signes extérieurs de cette richesse avec laquelle l’esprit de résistance ne saurait forcément faire toujours bon ménage.
Les bals de fin d’année sont une spécificité américaine; celui des faux-culs en est une autre, tel qu’en témoigne l’empressement d’Amazon à rediffuser l’intégralité de The Apprentice, jeu télévisé dont Donald Trump fut le tonitruant présentateur. Mais des faux-derches aux lèches-prose, il n’y a qu’un pas, vite franchi, cette plate-forme ayant annoncé la diffusion prochaine d’un documentaire consacré à Melania Trump, première dame de la Maison-Blanche. On en connaît qui auront mauvaise haleine dans pas longtemps.
Il est vrai que ce ne serait pas la première fois que cette industrie démontrerait qu’à défaut d’avoir les reins solides, elle aurait toujours eu l’échine souple.
Les paradoxes d’Hollywood…
Dès la fin de la Première guerre mondiale, Washington pressentant le soft power potentiel de cette industrie naissante a tôt fait de l’embrigader sous sa bannière étoilée. Hormis la parenthèse du Nouvel Hollywood, à la fin des années 60, durant laquelle le septième art local parvient à desserrer l’étau, la machine à rêves n’arrêtera jamais d’usiner pour les intérêts supérieurs des USA. Ainsi, tel que noté, le 7 mars dernier, par Le Monde : « Les studios californiens, à l’exception de la Warner, se gardèrent de contrarier le parti d’Hitler, jusqu’à l’entrée en guerre des États-Unis. On en arriva à ce paradoxe qu’un homme comme Carl Laemmle, dirigeant d’Universal, se pliait aux diktats de Berlin en licenciant les employés juifs de la filiale allemande du studio, tout en organisant une filière pour évacuer les Juifs persécutés par le régime nazi. » Durant la parenthèse maccarthyste, les mêmes dirigeants juifs se soumettent au même exercice de contrition, les présupposés communistes hollywoodiens étant souvent des coreligionnaires, tel que brillamment conté par Neil Gabler, dans Le Royaume de leurs rêves, la saga des Juifs qui ont fondé Hollywood (Calmann-Lévy). D’autres artistes devront encore en rabattre, tel Martin Scorsese, avec son Kundun, tourné en 1997 et consacré au dalaï-lama, vite passé en pertes et profits, afin de ne point froisser cette Chine où Hollywood, sous la houlette de la Maison-Blanche, entendait massivement investir.
D’un côté, les impératifs géopolitiques du soft power ; de l’autre, ceux des vedettes. Les secondes ne pèsent guère vis-à-vis des premières.
Et à la fin, c’est le capitalisme qui gagne…
Mais, au-delà de ces considérations, demeure le principal : le dollar. Ce qui permet de mieux comprendre l’actuel virage idéologique des grands studios : le wokisme ne paye plus. Ce pragmatisme, on remarque que les décideurs de naguère n’en ont guère fait preuve. Quelle idée, aussi, de transformer le studios Disney, entreprise familiale par essence, en lessiveuse inclusive ? Les minorités sexuelles, au sortir de la Gaypride, vont elles se ruer voir les dernières aventures de Mickey ? Non, il y a les films de John Waters (par ailleurs excellents) pour ça. Quant aux familles plus traditionnelles, elles ne peuvent qu’être déçues, quand ce n’est pas tout simplement furribardes. Surtout en allant voir le Blanche-Neige de Mark Webb, sorti en mars dernier. Et là, l’accident industriel, la tuile format XXL, le bousin total. Car cette petite fantaisie, façon film de patronage pour inculquer le beau, le bien et le vrai au patriarcat blanc, n’a pas coûté le prix d’un court-métrage filmé sur téléphone portable. Le budget ? 270 millions de dollars, auxquels il faut encore en jouter cent, pour la promotion. Il fallait bien ça pour lutter contre celle ayant inondé les réseaux sociaux, afin d’expliquer à quel point il ne s’agissait pas exactement du chef-d’œuvre du siècle.
Du coup, les comptables refont leurs comptes et se disent que les dingueries ont assez duré. Et Bob Iger, le nouveau patron du studio aux grandes oreilles de siffler la fin de la récréation : « Les créateurs ont perdu de vue ce que devait être leur objectif numéro un. Nous devons, d’abord, divertir. Il ne s’agit pas d’envoyer des messages. » Surtout lorsque ces derniers ne rapportent pas un fifrelin.
Ce système capitaliste nous aura fourgué du woke sur grand écran des années durant. Et c’est lui qui, aujourd’hui, pourrait bien lui porter le coup de grâce. Cruelle ironie.