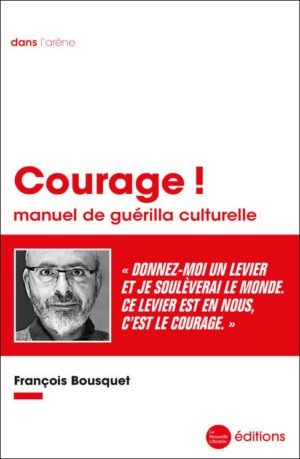Il y a plus d’un siècle, en 1910, mourait Lev Nikolaïevitch Tolstoï dans la petite gare d’Astapovo, province de Riazan, à 350 km de Moscou, loin de sa propriété de Iasnaïa Poliana, qu’il avait quittée quelques jours plus tôt dans une fuite digne du roi Lear. Le vieillard âgé de 82 ans savait qu’il allait quitter la vie. Alors, il a tout quitté, sans regret, sans se retourner, n’attendant plus que « la vérité, la vérité… » (ce sont ses derniers mots). Sortir enfin de la prison où l’avaient enfermé ses livres, sa femme, ses disciples. Se sauver, dans le double sens du mot : la fuite et le salut, en guise d’adieu au monde. Le fuyard avait rêvé d’un tel départ, le voilà exhaussé. C’est l’histoire du Père Serge, l’une de ses plus grandes nouvelles, parue après sa mort. Sans aucune vocation religieuse, le Père Serge entre malgré tout dans les ordres, seule manière de venger son orgueil humilié, ayant appris que la femme qu’on lui destine est une ancienne maîtresse de l’empereur, marchandise défraîchie. Que lui restait-il alors pour dépasser son roi ? La sainteté, mais une sainteté parodique, s’apparentant à une quête d’excellence, seule alternative à son vide spirituel et qui fera du Père un « starets » abusivement vénéré. Après s’être laissé séduire par une femme, l’imposteur est réduit à fuir de ville en village, pèlerin parmi les pèlerins. Fuir la fausse idole de sa sainteté que ses mensonges avaient créée, comme si Tolstoï mettait en garde ses disciples : ne faites pas une idole de l’homme qui a renversé les idoles. Trop tard néanmoins.
Dans Tolstoï est mort, Vladimir Pozner a restitué à merveille cette agonie, en rassemblant des communiqués de presse d’alors, des dépêches d’agence, des extraits de l’œuvre et des journaux intimes. Ce sont les minutes d’une mort inconcevable dont Pozner est le soigneux metteur en scène. Le vagabond a voyagé sous un nom d’emprunt, avec l’une de ses filles, son médecin personnel et Tchertkhov, le disciple d’entre les disciples, avant de s’arrêter, malade, dans cette gare perdue d’Astapovo, aussitôt transformée en lieu de pèlerinage, où tout est conservé à l’identique depuis ce 20 novembre 1910 : le lit de fer du mourant, la table dépouillée, jusqu’aux aiguilles de l’horloge calées pour toujours sur 6 h 05, l’heure de sa mort.
Un grand seigneur et un moujik
Épilogue d’une vie qui aura été le théâtre d’un combat titanesque et d’une lutte de tous les instants. Éros contre Thanatos, esthétique contre éthique, mal contre bien, jusqu’au jour où Tolstoï a tranché dans le vif par ablation de l’œuvre. Il avait mis un demi-siècle à l’édifier, il va la piétiner sauvagement. Elle sera tout juste bonne à alimenter le feu du poêle. L’art ? Une ineptie qui corrompt le peuple ! Le sexe ? Une souillure séminale sur la blouse immaculée du moujik ! Et de massacrer sa création, comme un moine flagellant, dans un cas limite de mortification littéraire. Il était taureau ailé, et le voilà bœuf claudiquant. Il était Pégase, le cheval mythologique, et le voilà percheron disgracieux. Premier des écrivains, et le voilà dernier parmi les hommes. Il y a quelque chose d’une émasculation symbolique dans le dernier Tolstoï, qui s’est découvert, lui l’être violemment sensuel, une horreur abyssale pour la chair.
Tolstoï a tout essayé. La débauche, la guerre et la vie de famille. Sur les trois, il a prononcé une condamnation sans appel. Il disait avoir eu quatre vies. Celle de l’aurore claire et radieuse, qu’il consignera dans Enfance (1852), Adolescence (1854), Jeunesse (1855), trilogie miraculeuse baignée d’une lumière aurorale. Celle des armes et de la vie licencieuse, temps du dévergondage, dont il tirera les Récits de Sébastopol (1855) et Les Cosaques (1863). Celle du père de famille assagi trônant sur son arche de Iasnaïa Poliana, sa propriété, où il composera les grands chefs-d’œuvre. Celle, enfin, de la crise et de « la délivrance », pour reprendre le titre du livre d’Ivan Bounine, ancien tolstoïen, prix Nobel de littérature qui a retenu la leçon de style du maître. Autant de réincarnations successives, comme dans le bouddhisme, avant l’illumination finale, la mort à Astapovo, comme un ver nu.
De tous les grands schismatiques russes, Tolstoï est le plus singulier. Mélange sans pareil de grand seigneur distingué et de moujik sans manière, de centaure insatiable et de vieux chêne imposant, de faune priapique et de chameau abstinent, de patriarche illuminé et de saint homme, de roi mage et de Moïse sur le Sinaï, de Raspoutine et de gourou. Prophète pour les uns, fou pour les autres. Un homme entouré d’une ferveur religieuse. La lumière venue de Russie, selon Romain Rolland. Un apôtre et un Père de l’Église, d’après Alain. Un Dieu serein, pour Proust. Des disciples partout, en France, en Amérique, en Australie, ailleurs, reconnaissables à leur allure : une longue barbe, la culotte bouffante rehaussée du ceinturon, des bottes grossières. Tels sont les habits du moujik, signes de l’arriération russe, selon Pierre le Grand, que Tolstoï réhabilitera.
Ô femmes !
Quel écrivain a déclenché une pareille dévotion ? Rousseau ? Et encore. Tolstoï et Rousseau. L’aristocrate et le plébéien. Tout les oppose en apparence et tout les réunit en profondeur. Le Russe a tout lu du Genevois. Tous deux avaient en commun un même amour de la nature, une même horreur des mondanités, une même aversion pour la civilisation, le théâtre, les inégalités de naissance, les monarques, absolus ou pas. Mais nul contrat social chez Tolstoï. Le contrat, il le déchire. Le contrat, c’est ce que le Léviathan étatique – monstre biblique et Bête de l’Apocalypse – tend à l’homme nu. Tout ou rien, tel est le choix du maximaliste, du fou et du prophète. Mélange explosif. C’est celui qui s’est produit chez Tolstoï quand son rousseauisme est entré en point de contact avec le millénarisme russe.
Tolstoï a vécu avec une intensité peut-être inégalée la contradiction d’être homme. C’est celle qui étreignait déjà le prince André dans Guerre et Paix (1865-1868), quand il écoutait chanter Natacha Rostov, l’une des plus belles héroïnes du roman mondial : « Il y avait une effroyable contradiction entre quelque chose d’infiniment grand et vague qui était en lui et cette chose étroite et charnelle qu’il était lui-même et qu’elle était. » Tolstoï a saisi l’éphémère de la beauté féminine, l’instant papillon de la femme, quand Natacha danse ou Anna Karénine triomphe de sa rivale. Ensuite, le voile d’illusions – Mâyâ – finit par se déchirer. Tolstoï a lu Schopenhauer, les grands textes védiques. Rien ne saurait durer. Aussi Vronski cesse-t-il d’aimer Anna Karénine ; Natacha prend-t-elle du ventre. Quant à la femme de Tolstoï, Sophie Andreïevna, la comtesse Sophie, d’abord fée du logis, la voilà réduite à produire sur lui une sorte de dégoût voisin de la haine. Tolstoï veut posséder le monde, ou être possédé par lui. Sa femme veut seulement posséder son mari. La lutte est trop inégale. Pauvre Sophie restée dans le monde des bals et des robes de gala, alors que « lui » est ailleurs. On sent, comme chez Louis Althusser, qu’il aurait pu la tuer. N’a-t-il pas écrit une pièce de théâtre, La Lumière qui brille dans les ténèbres (inachevée), où il met en scène un tolstoïen – lui ? – qui tue bel et bien sa femme.
Un dieu créateur et un titan destructeur
Désillusion, cendres. C’est ainsi que chemin faisant, le nid familial – l’utopie biblique du romancier (de la sensualité à la fécondité) – s’est transformé en enfer domestique. L’homme-étalon et le mari fatigué se sont lancés dans l’écriture compulsive de pamphlets délirants, violemment puritains, comme si à travers eux, il s’efforçait de conjurer la concupiscence qu’il portait en lui, ayant trop d’énergie pour la réprimer et trop de morale pour la tolérer. Pareil à Adam, il fait alors porter le poids de son désir sur Ève, son épouse, la tentatrice. Une Ève qui avait horreur des contacts physiques. Or, elle a épousé un homme au désir tout-puissant, qui fait profession de haïr la chair et écrit La Sonate à Kreutzer (1887-1889), histoire d’adultère halluciné.
Fascinant renversement, comme si on avait interverti les pôles et que Tolstoï s’était retrouvé la tête en bas. Le grand écart d’un titan ; entre les deux pieds, une distance considérable. Une partie du corps aux enfers, l’autre dans les nuages. Un homme-création et un homme-destruction, les deux surdimensionnés, « hénaurmes ». Tolstoï, c’est treize enfants, une barbe druidique, une énergie herculéenne, une longévité sylvestre, quatre-vingt-dix volumes d’œuvre complète. Qui dit mieux ? Le vieux comte montait encore à cheval à quatre-vingts ans et se baignait dans les rivières froides. C’était une force cosmique élémentaire. La sève, l’élan vital, le mouvement héraclitéen (là où Dostoïevski en est le feu). Un personnage olympien « semblable à Dieu », comme l’écrivait Gorki, « assis sur un trône d’érable sous les branches d’un tilleul d’or ». Le premier romancier de son temps, et peut-être de tous les temps, et le dernier grand romancier épique, homérique, édénique. « Le grand écrivain de la terre russe », disait Tourguéniev. L’enchanteur absolu, celui qui est parvenu à brouiller la frontière entre le réel et la fiction. Où commence le roman ? Où termine la vie ? Impossible de trancher. Lire Tolstoï, c’est comme contempler l’infini d’une mer calme ; vivre une journée de printemps qui n’en finit pas ; reprendre Les Travaux et les jours là où les a laissés Hésiode.
Un dieu au balcon
Un dieu au balcon de sa création. Le Homère russe, qui renoue avec l’antique vision pastorale. Noblesse des visages, majesté des paysages qui saisissent les cinq sens. Comment ne pas songer à la musique de Debussy, disait Vladimir Jankélévitch ? Pas d’intelligence ici. Qu’un bonheur fugitif, sensation immédiate qui ne doit faire l’objet d’aucun raisonnement. Tolstoï ne dit-il pas de Natacha Rostov, mais ça vaut tout autant pour lui, qu’elle ne daignait pas être intelligente ? Seulement heureuse, d’un bonheur que le romancier a poursuivi et étreint, dans les bals, la nature, la chasse, la vie de famille, le travail dans les champs. Ses livres en conservent la trace miraculeuse. C’est le matin du monde. Ils en célèbrent la promesse, celle que contenait Iasnaïa Poliana, littéralement « la claire clairière », la propriété familiale dont il a hérité après la mort de son père. Sa mère étant morte quand il avait deux ans, emportant avec elle une tendresse d’autant plus chérie qu’elle fut brève. Iasnaïa Poliana : 2 000 hectares de terre, sept cents serfs, une vingtaine de domestiques. Il y est né en 1828 et y passera la plus grande partie de sa vie. Il quittera le domaine pour des études bâclées, les hivers à Moscou et à Saint-Pétersbourg, l’armée, les voyages en Europe, les années de débauche et leurs orgies de jeu et de dettes, de champagne et de tsiganes. C’est son frère qui le traînera dans le Caucase, où il se battra contre les Tchétchènes, puis à Sébastopol, d’où il tirera les Récits de Sébastopol, premier succès, immense. Les autres s’enchaîneront.