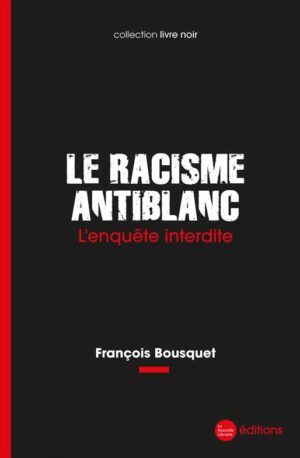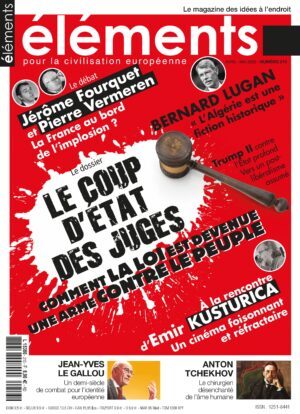D’où cette interrogation du quotidien Libération de ce 29 mars, titrant en une : « Où sont passés les démocrates ? ». La question est tout sauf anodine, ces derniers semblant être aux abonnés absents depuis quelque temps. Soit l’occasion de méditer cette analyse du politologue Costas Panagopoulos : « Leur stratégie actuelle semble consister à rester en coulisses et d’attendre de voir ce qui se passe. » Ce qui est un peu court, on en conviendra. Mieux : « Il semble donc que les démocrates se morfondent aujourd’hui, sans stratégie de communication efficace. Ils ont besoin de deux choses essentielles : un message et des messagers. Pour l’instant, il ne semble pas y avoir de message cohérent et constant qui pénètre la conscience de l’électorat, ni de messagers ou de petits groupes de messagers qui transmettent ce message au public. »
Comme Reagan avant, Trump saura-t-il transcender les clivages politiques ?
Il est vrai qu’avec sa campagne hors-normes, Donald Trump a bouleversé le paysage politique, à la façon d’un Ronald Reagan au siècle dernier. Le parallèle entre les deux hommes n’a rien d’incongru. En effet, Ronald Reagan, issu du Parti démocrate, syndicaliste militant (de 1947 à 1952, il préside la puissante Screen Actor’s Guild tout en s’opposant à la chasse aux “communistes” diligentée par le sénateur Joseph MacCarthy), il rejoint peu à peu le Parti républicain avant de faire la jonction entre ces deux électorats, lors de son accession à la présidence, en 1980. Donald Trump ayant lui aussi oscillé entre ces deux partis régissant la vie américaine depuis des décennies, est parvenu au même tour de force, au mépris de ces élites l’ayant, lui comme son prédécesseur, tenus pour ploucs mal dégrossis. Déjà, à l’époque, le Parti démocrate demeurait singulièrement atone et mit quelques années à s’en relever, grâce à une personnalité parvenue à faire l’unanimité dans un camp plus que déchiré de l’intérieur : Bill Clinton.
Le grand défi des démocrates : social ou le sociétal ?
En 2025, la situation n’a fait qu’empirer, les dingueries sociétales étant passées par là. Résultat ? Les deux seuls « messagers » plus haut évoqués ne sont autre que Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. Le premier, même si apparenté à un Parti démocrate lui ayant toujours refusé l’intronisation à l’élection présidentielle, a toujours affirmé son indépendance vis-à-vis du traditionnel bipartisme. Héraut d’une gauche à l’ancienne, il est plus préoccupé de la question sociale que des revendications sociétales. La seconde, fossé des générations oblige, est son exact contraire. D’un côté, la défense des cols bleus ; de l’autre, celle des lesbiennes à cheveux bleus, pour aller court.
Les deux sont néanmoins les seuls à arpenter les estrades pour tenter de faire pièce à la présidence du président aux cheveux orange, histoire de continuer à filer la métaphore capillaire. C’est dire si le parti de JFK n’affiche pas une forme tout à fait olympique… Ce d’autant plus que, de manière assez ironique, leur discours n’est pas très éloigné de celui d’un Donald Trump, puisque consistant à lutter contre l’oligarchie en place. Pour ce dernier, il s’agit de faire face à l’État profond et au complexe militaro-industriel y afférent, tandis que ce duo inédit aurait plutôt tendance à s’en prendre à celui qu’incarnerait le fantasque Elon Musk.
Contre les milliardaires, démocrates comme républicains…
Bernie Sanders voit bien le hiatus, à la fois sémantique et politique, quand il affirme, à en croire Le Figaro de ce 30 mars : « Il existe désormais un profond dégoût à l’égard des deux partis politique. Le Parti républicain est celui où Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, dépense 270 millions de dollars pour élire Donald Trump. […] Mais je ne dirais pas la vérité si je ne disais pas que des milliardaires exercent aussi une influence indue au sein du Parti démocrate. Ce n’est pas ce que l’Amérique est censée être. La démocratie, c’est une personne, un vote, pas des milliardaires qui achètent les élections. » Histoire d’en ajouter une couche, et ce toujours selon la même source, Bernie Sanders stigmatise au passage un Parti démocrate coupable de s’être focalisé sur « les identités raciales et sexuelles, au détriment des revendications salariales et de protection sociale. »
On notera qu’à l’occasion, Alexandria Ocasio-Cortez semble avoir abandonné ces mêmes lubies wokistes dont le moins qu’on puisse prétendre est, qu’hormis quelques quartiers chics des côtes Est et Ouest, ne mobilisent guère l’électorat américain ; et surtout pas celui de la classe ouvrière blanche, sans négliger celui des minorités immigrées dont la l’ancestrale culture patriarcale n’est plus à prouver. Ce sont d’ailleurs celles-ci qui, en grande partie, ont fait pencher la balance du côté trumpien.
Une résonance en France ?
Certes, comparaison n’est pas raison et ce qui se passe de l’autre côté de l’Atlantique n’a pas forcément toujours de résonnance chez nous ; quoi que… Ainsi, le bloc central américain (républicains de gauche et démocrates de droite), n’est pas sans évoquer son équivalent macronien, débordé d’un côté par un populisme ayant le vent en poupe et, de l’autre, par une extrême gauche de plus en plus déconnectée du terrain électoral ; voir du terrain, ou du terreau français, pour être plus précis.
Un autre parallèle peut éventuellement s’imposer ensuite : Bernie Sanders, c’est un Jean-Luc Mélenchon qui serait demeuré fidèle aux idéaux de la gauche historique, tandis qu’Alexandria Ocasio-Cortez pourrait faire figure d’une Marine Tondelier ayant enfin compris que ses couinements ne concernaient finalement qu’une autre gauche, celle des gosses de riches mal élevés. L’avenir de ce qui demeure de la nôtre nous viendra-t-elle des USA ? C’est à croire et ce ne serait pas la première fois.
© Photo : Jesse Paul / Shutterstock. Le sénateur Bernie Sanders le 21 mars 2025 avec Alexandria Ocasio Cortez, lors de son plus grand rassemblement, avec une participation estimée à plus de 30 000 personnes.