ÉLÉMENTS. Sommes-nous toujours dans les prolégomènes de l’« avant-guerre civile », une drôle de guerre qui aurait encore un « air de guerre », pour parler comme l’un de vos précédents ouvrages ? Ou avons-nous basculé dans quelque chose de nouveau où la frontière entre la paix et la guerre est plus brouillée que jamais ?
ÉRIC WERNER. Quand on parle d’avant-guerre civile, on sous-entend qu’il y aurait d’un côté l’avant-guerre civile et de l’autre la guerre civile. Ce seraient deux réalités différentes. Mais peut-être se trompe-t-on en le disant, et en fait l’avant-guerre civile est-elle déjà la guerre civile. Nous ne nous en rendons pas compte, parce que nous nous faisons une idée préconçue de la guerre civile. Nous avons un certain nombre d’attentes à son sujet, attentes se nourrissant d’images héritées du passé : or ce qui se donne à voir ne leur correspond en rien, ou que très peu. Et donc nous en concluons que ce qui se donne à voir n’est « que » l’avant-guerre civile et non la guerre civile. Un jour ou l’autre, nous disons-nous, une frontière sera franchie, et l’on pourra alors parler de guerre civile. Mais pas avant. Sauf que ladite frontière ne sera peut-être jamais franchie ; ou tout simplement, même, n’existe pas. D’année en année, il est vrai, la violence intrasociale va s’accroissant, accroissement se reflétant, entre autres, dans les chiffres de la criminalité. Nous sommes dans un processus, et de temps à autre, même, ce processus s’accélère : comme, par exemple, tout récemment encore, à Crépol. On pourrait aussi citer la multiplication des home-jacking ou des agressions au couteau. Dans l’immédiat, les gens accusent le coup ; mais le premier moment de stupeur passé, l’événement est très vite ensuite intégré. Tout passe, tout coule, les gens en définitive s’adaptent. Crépol est presque aujourd’hui oublié. À partir de là, peu importe les mots qu’on utilise : guerre civile ou avant-guerre civile. C’est une avant-guerre civile, si l’on veut : mais sans après ; et donc, peut-être, pour l’éternité.
Cela étant, la distinction conserve une certaine fonctionnalité. Mais elle est politique. Considérons les dirigeants. En elle-même, on l’a dit, l’insécurité ne les gêne en rien, ils y sont même assez favorables. Ils l’instrumentalisent en permanence, en application du principe : diviser pour régner. Mais dans certaines limites seulement : autrement ils se mettraient eux-mêmes en danger. C’est là le point. Convenons donc de dire que les limites en question sont celles séparant l’avant-guerre civile de la guerre civile. L’avant-guerre civile désigne l’état de choses se situant en-deçà. Dans cette optique, l’avant-guerre civile est étroitement liée à l’après-démocratie. C’est de cette dernière, en fait, qu’elle tire sa signification. Mais l’inverse est vrai aussi. Le propre de l’après-démocratie (respectivement de la dictature) est d’entretenir un état de choses poussant à la guerre civile, mais encore une fois dans certaines limites. Quelles sont au juste ces limites et par où passent-elles, il revient aux dirigeants de le préciser. C’est une décision politique.
ÉLÉMENTS. L’État est dépositaire du monopole de la violence légitime. Soit. Mais s’il ne se sert pas de ce monopole pour protéger sa population, allant même à l’occasion jusqu’à se retourner contre elle (Gilets jaunes), que faire ? Comment défier l’État aujourd’hui, toujours plus suréquipé, surarmé ? Comment le faible peut-il mettre en échec le fort ; l’individu, l’État ?
ÉRIC WERNER. Il ne faut évidemment jamais le défier. C’est l’erreur à ne pas commettre. La guerre du faible au fort possède ses propres règles, dont la première, pour le faible, est de toujours, autant que possible, éviter la confrontation ouverte, ou si l’on préfère le face à face. Le but à rechercher n’est pas la bataille mais la non-bataille. La stratégie mise en œuvre est donc une stratégie défensive, celle, classique, de la retraite flexible : on échange du temps contre de l’espace. On essaye de gagner du temps, et pour cela on cède du terrain : par exemple, dans le cas qui nous occupe, on obéit (ou fait semblant d’obéir) aux lois existantes, alors même qu’on les estime injustes, voire criminelles. Ce qui ne signifie bien sûr pas qu’on reste complètement passif. « La forme défensive de la guerre n’est pas un simple bouclier mais un bouclier formé de coups habilement donnés », dit Clausewitz. Mais justement : « habilement donnés ». Autrement dit, donnés à certains endroits seulement : là où l’on sait qu’on ne prend soi-même aucun risque en les donnant. Concrètement, il faut avoir la certitude que quand on fait quelque chose d’illégal, on ne se fera pas prendre. Autrement cela n’en vaut pas la peine. Le modèle en arrière-plan est celui de la « petite guerre » (ou guerre de guérilla), telle qu’elle est décrite au chapitre 26 du Livre VI de l’ouvrage de Clausewitz, De la guerre : mais appliqué à un contexte particulier : non plus, comme chez Clausewitz, celui d’une guerre d’invasion, mais d’une guerre très particulière, celle de l’État contre sa propre population. L’État nous ayant désigné comme son ennemi, nous nous adaptons à cette réalité-là en le traitant lui aussi en ennemi. Mais comme nous ne disposons pas des mêmes moyens, nous ne pouvons pas mener la même guerre que lui. Nous en menons une autre, à la mesure de nos possibilités propres. C’est une guerre asymétrique. Concrètement, l’objectif ne saurait être de renverser l’État, un tel objectif est irréaliste. Si déjà l’on réussit à se mettre soi-même hors de portée de l’État, en faisant un certain nombre de choses sans être inquiété, on pourra déjà dire que l’État a été mis en échec. Davantage encore que la guerre de guérilla, le modèle, ici, est celui de la résistance paysanne dans les sociétés traditionnelles : sauf, évidemment, que nous ne vivons plus dans de telles sociétés. Un certain nombre de transpositions s’imposent donc.
ÉLÉMENTS. Sur la question de l’autodéfense : peut-on dire que, si l’État n’assure plus notre protection, c’est à nous de la prendre en charge ?
ÉRIC WERNER. On peut évidemment ne pas la prendre en charge. Mais alors nous mourons ! En ce sens, effectivement, la prendre en charge n’est pas seulement un droit mais un devoir. Nous avons le devoir de nous maintenir en vie et pour cela de nous défendre quand nous sommes attaqués, puisque c’est ainsi que nous nous maintenons en vie. C’est à nous de le faire ! Ajouterais-je que nous n’avons pas à en demander la permission à l’État. Car l’autodéfense est un droit naturel. Il ne se discute donc pas. Il n’y a pas non plus à passer par une loi pour le faire reconnaître. Bien entendu non plus aucune loi ne saurait l’interdire. Prendre les armes pour se défendre quand on est soi-même attaqué et que par ailleurs l’État ne nous défend plus (soit parce qu’il est dans l’incapacité de le faire, soit, comme maintenant, parce qu’il ne le veut pas) fait partie des droits imprescriptibles. Il est donc criminel de vouloir le remettre en cause. Le droit naturel l’emporte ici sur le droit positif. Je me place ici au plan des principes : ceux-là même, au demeurant, dont se réclament les adeptes des idées contractualistes, qui sont au fondement de la théorie moderne de l’État. Hobbes lui-même reconnaissait que quand l’État n’assure plus sa fonction de protection des individus, ces derniers se retrouvent sui juris, libres donc de prendre les mesures qu’ils estiment nécessaires pour se protéger eux-mêmes. Il faut en revenir ici à Hobbes.
ÉLÉMENTS. Objection : l’État châtie plus sévèrement ceux qui se défendent (autodéfense) que ceux qui agressent. Que répondre à cela ?
ÉRIC WERNER. C’est un autre débat. Il faut en effet distinguer entre ce qu’on a le droit de faire et ce qu’il est concrètement possible de faire. Effectivement, l’État applique les châtiments les plus sévères à ceux qui se défendent quand on les attaque. L’autodéfense est son obsession. Tout est donc mis en œuvre pour dissuader les victimes d’agressions d’y avoir recours. C’est normal. L’État est en guerre contre sa propre population. On le verrait mal, dès lors, lui reconnaître le droit à l’autodéfense. Imaginons ce qui se passerait si les victimes de home-jacking se mettaient à tirer sur leurs agresseurs, les contraignant ainsi à la fuite. Ou encore les employés de certains magasins quand ils se font braquer par des voleurs armés. Le régime n’y survivrait pas. Quand donc l’État châtie plus sévèrement ceux qui se défendent que ceux qui agressent, il est pleinement cohérent avec lui-même. Au point de vue logique au moins, on ne peut rien lui reprocher. De leur côté, ceux qui y ont recours savent les risques qu’ils prennent en le faisant. Ils ne pourront pas ensuite se plaindre. Cela étant, il existe une alternative à l’autodéfense : l’auto-justice. L’auto-justice n’est pas exactement l’autodéfense : c’est l’autodéfense différée. Dans l’autodéfense au sens strict, la défense est en lien direct avec l’attaque. Elle survient sur le moment même, en réponse à l’attaque. Là, au contraire, on attend pour agir qu’une occasion favorable se présente (en grec kairos). « Il faut traverser la vaste carrière du Temps pour arriver au centre de l’occasion », écrit Baltasar Gracian dans son Oraculo Manual y Arte de Prudençia. L’occasion vient ou ne vient pas. Mais en règle générale elle vient. Il suffit donc d’attendre. L’auto-justice, on le sait, est un des grands thèmes du cinéma américain. Citons entre autres La Nuit des juges de Peter Hyams, sorti en 1983. Ces phénomènes-là, effectivement, se produisent plutôt la nuit.
ÉLÉMENTS. L’avocat Thibault de Montbrial, bon connaisseur des questions d’autodéfense, fait remarquer : « S’il n’y a pas une reprise en main par la police et la justice, des bandes organisées vont se mettre en place pour protéger les fêtes, des gens avec leurs fusils. C’est le risque […] il faut tout faire pour l’éviter. » On n’en prend pas le chemin…
ÉRIC WERNER. Je ne crois pas du tout à ces choses. Jamais de telles bandes ne verront le jour. L’État les fera disparaître avant même qu’elles n’apparaissent. Empêcher qu’elles ne voient le jour est au reste sa préoccupation première. La police est là avant tout pour ça. Par ailleurs, la population dans son ensemble a complètement intériorisé l’idée selon laquelle il était interdit de se substituer à la police pour effectuer des tâches de maintien de l’ordre. Elle n’y est donc pas préparée du tout. Ces fêtes vont donc assez probablement disparaître. Elles appartiennent à un temps révolu. On retrouve ici les problèmes généraux de l’avant-guerre et/ou de la guerre civile. Étant en guerre avec sa propre population, l’État ne saurait en même temps la protéger, ni en conséquence non plus admettre qu’elle en vienne à se protéger elle-même. Pour autant, si l’État est bien outillé pour empêcher l’émergence de bandes organisées, il ne peut en revanche pas grand-chose contre les initiatives individuelles. Les individus n’empêcheront bien sûr pas les fêtes de disparaître. Mais ils rendront la vie difficile à ceux qui les auront fait disparaître. On pourrait évidemment aussi imaginer une disparition de l’État. À ce moment-là toutes les cartes seraient rebattues. Une éventuelle disparition de l’État n’est de prime abord pas à l’ordre du jour. Mais tout est possible. C’est en fait lui le problème.
ÉLÉMENTS. « Je me révolte donc nous sommes », dites-vous avec Albert Camus. Mais pourquoi si peu d’hommes se révoltent. Pourquoi autant choisissent-ils d’obéir ? La question hantait déjà La Boétie. Vous répondez : l’homme obéit parce qu’il aime ça, en tout cas la majorité. Qu’est-ce qui vous fait dire cela ? Vous reprenez à votre compte le poème d’Ivan Karamazov et sa « Légende du Grand Inquisiteur », géniale, mais terrible. Est-ce ainsi que vous voyez l’homme ? Il n’aime pas la liberté… Deux tiers des gens sont des consentants et des obéissants. Un peu comme dans l’expérience de Stanley Milgram sur la soumission à l’autorité.
ÉRIC WERNER. Entre 60 et 70 % des gens sont effectivement des obéissants, mais pas seulement des obéissants. En plus, ils pensent que les autorités ont toutes les vertus. Ce sont donc des obéissants convaincus, parfois même enthousiastes. La servitude volontaire prend ici toute sa signification. D’autres obéissent, mais sans pour autant penser que les autorités ont toutes les vertus. S’ils obéissent, ce n’est pas parce qu’ils respectent les autorités mais plutôt les craignent. Ils ne veulent pas de problèmes. Entre 30 et 40 % de la population, je dirais. Quant aux désobéissants, on peut évaluer leur nombre à plus ou moins 5 % de la population. Là aussi, c’est une évaluation personnelle. Encore faut-il s’entendre sur ce qu’on entend par désobéir. La gamme des actes possibles de désobéissance est très large. Il y a mille et une manières de désobéir. Prendre le maquis n’en est qu’une parmi d’autres. Quel est le pourcentage des gens prêts à prendre le maquis ? Entre 0,05 et 0,1 % de la population, peut-être. Il faut bien avoir en tête toutes ces distinctions quand on parle d’obéissance et de désobéissance. L’obéissance et la désobéissance sont des catégories très générales.
En arrière-plan, effectivement, on peut citer la Légende du Grand Inquisiteur. L’homme ne vit pas seulement de pain, dit Dostoïevski, reprenant à son compte une formule évangélique. Or une majorité des gens pensent le contraire, ils pensent que l’homme ne vit que de pain. Et donc cela leur est indifférent de renoncer à la liberté. Mieux encore, cela les soulage. Ils trouvent le fardeau de la liberté trop lourd. Le vrai problème est là, c’est l’asservissement aux biens matériels. Avant même d’être asservis à un maître (« Vive le maître quel qu’il soit »), les gens sont asservis à la matière. Le mot matière peut très bien être remplacé par le mot sécurité. Ce que dit en fait Dostoïevski, c’est que les êtres humains, dans leur très grande majorité, préfèrent la sécurité à la liberté. Lorsqu’ils ont à choisir entre l’une et l’autre, ils sont donc prompts à sacrifier la seconde à la première. Les despotes leur promettent souvent la sécurité en échange de la liberté. Ils acceptent donc cette offre. Sauf, le plus souvent, que les promesses de sécurité se révèlent être trompeuses. La sécurité n’est pas au rendez-vous. Et donc ils n’ont ni liberté, ni sécurité (en quelque acception qu’on l’entende). C’est un marché de dupes. Les hommes peuvent dès lors être tentés de se révolter. Mais alors se pose un autre problème, celui des risques encourus. Seul un très petit nombre d’obéissants sont prêts à prendre les risques qu’implique le fait de se révolter : risques souvent importants. On peut y laisser la vie. Une exception cependant : quand les obéissants ont faim. En ce cas-là ils n’ont alors plus rien à perdre. Mais c’est une situation exceptionnelle. Ils ne se révoltent d’ailleurs pas parce qu’ils veulent la liberté, mais parce qu’ils ont faim et qu’ils veulent pouvoir manger. C’est, à la lettre, ce que dit Dostoïevski.
ÉLÉMENTS. Aux fractures sociales, vous opposez d’autres lignes de fracture : entre autres, celle qui oppose ceux qui croient à ce qu’on leur dit dans les médias centraux et ceux qui n’y croient pas. C’est une ligne de fracture que la crise du Covid a creusée. Que s’est-il alors passé ?
ÉRIC WERNER. Tout simplement beaucoup de gens sont morts. C’est une première réponse. Ensuite il est relativement facile de mentir quand on parle de choses abstraites ou lointaines. Beaucoup moins en revanche des autres. Là, les gens peuvent vérifier si ce que vous leur racontez est vrai ou faux. Ils comparent le récit officiel à leur propre vécu personnel, à ce que leurs propres sens leur donnent à voir et à entendre. Il ne faut pas non plus prendre les gens pour des idiots. Quand on impose l’obligation du masque sanitaire et qu’en même temps on lit sur l’emballage que le port du masque n’empêche pas la propagation du virus, forcément les gens en viennent à se dire que la véritable motivation de l’obligation du port du masque n’est pas d’empêcher la propagation du virus, mais une autre. Même chose pour la vaccination, le confinement, la mise à banc des montagnes et des forêts, etc. Une fois qu’on en est venu à ne plus croire à ce que racontent les autorités, il est très difficile ensuite de recommencer à y croire. La confiance perdue ne se récupère que rarement. Entendons-nous bien. Ce n’est pas toute la population qui a arrêté d’y croire : ni même une majorité. On ne parle ici que d’une minorité : mais une minorité quand même importante (entre 30 et 40 %, on l’a dit). En ce sens, effectivement, une ligne de fracture s’est creusée. Il y a toujours eu des gens qui n’ont jamais vraiment cru à ce que leur racontaient les autorités : sauf, désormais, qu’ils n’y croient plus du tout. Là est la nouveauté. D’où, en retour, une certaine évolution du régime. Les autorités ont été amenées, sinon à moins mentir, du moins à moins croire qu’il leur était possible de résoudre tous les problèmes en simplement mentant. On pourrait aussi parler de rééquilibrage. Les autorités ont été amenées à revoir leur dispositif organigrammatique, dispositif jusqu’alors articulé sur les médias centraux. Les médias centraux restent bien sûr très importants, mais l’accent est désormais mis plutôt sur le monopole de la violence physique légitime. Mentir ou ne pas mentir, en fin de compte, quelle importance. Ce qui compte, ce n’est pas ce que pensent les gens, ce à quoi ils croient ou ne croient pas, c’est qu’ils fassent ce qu’on leur dit de faire, de gré ou de force. Personnellement, je pense que, de plus en plus, à l’avenir, les autorités vont être amenées à jouer cartes sur table. Elles mentiront encore, mais de plus en plus mal, et à la fin s’arrêteront même complètement de mentir. En revanche, les effectifs de la police et des services spéciaux vont très probablement s’accroître en proportion. C’est déjà en fait ce qui se passe. Ainsi, entre 2018 et 2023, la DGSI a vu ses effectifs augmenter de près de 20 %, passant de 4 200 agents à près de 5 000 (Le Figaro, 21 décembre 2023).
ÉLÉMENTS. Entre tous ces noms, lequel a vos faveurs ? Unabomber, Robin des bois, Henry David Thoreau ou Ernst Jünger ? Et pourquoi ?
ÉRIC WERNER. Il faut mettre à part les trois premiers noms. Chacun d’eux personnifie un mode opératoire particulier : assassinats ciblés pour le premier, grand banditisme pour le second, désobéissance civile pour le troisième. Le recours aux forêts chez Jünger est bien, si l’on veut, un mode opératoire particulier : en tant que variante de la « petite guerre ». Mais la « petite guerre » est un concept très général. Elle englobe toutes sortes de choses très différentes. Dans le Traité du rebelle, Jünger consacre quelques lignes à la figure du bandit sicilien Salvatore Giuliano, qui ressemble à certains égards à Robin des bois. Le Waldgänger n’est pas un bandit de grand chemin, mais il ne lui est pas non plus complètement étranger. Il y a évidemment aussi un lien avec la désobéissance civile. Sauf, justement, qu’en matière de désobéissance, Jünger va beaucoup plus loin que Thoreau. Thoreau reste un légitimiste, il ne conteste en aucune façon la légitimité de l’ordre légal existant : contestation, au contraire, qui est au cœur même de la démarche du Waldgänger. Lui, en effet, considère les institutions comme « suspectes » (Traité du rebelle, chapitre 30). Le cas d’Unabomber est plus délicat. Comme son nom l’indique, Unabomber fait exploser des bombes, ce qui à certains égards nous renvoie au tyrannicide. Jünger est opposé au tyrannicide. Il développe son point de vue dans les Falaises de marbre et aussi dans certaines pages de son Journal de guerre. Dans le Traité du rebelle, il n’aborde pas le problème. Mais on peut supposer qu’il n’a pas varié sur cette question.
Je prends les exemples que vous me donnez. Mais on pourrait en citer d’autres : Julian Assange, par exemple, qui a éclairé l’arrière-boutique morale de l’État occidental en rendant publiques un certain nombre de vérités ignorées ou occultées à son sujet. Dire la vérité, l’arracher aux fausses apparences de la propagande et de la désinformation est aussi une modalité possible du recours aux forêts.
Mais on n’épuise pas encore le sujet. Il revient à l’homme prudent de dire ce qu’il est préférable ou non de faire, quand, où, avec qui, en prenant quels risques, etc. C’est le niveau du mode opératoire. Mais le recours aux forêts est plus que simplement un mode opératoire. Le véritable enjeu ici n’est pas le comment mais le pourquoi : qu’est-ce qui me motive ? Qu’est-ce que je défends ? Le mot important, en l’espèce, est bien sûr le mot liberté. Ce qui caractérise au premier chef le recours aux forêts, c’est son rapport à la liberté. Jünger défend la liberté. Le reste, en définitive, est secondaire.
ÉLÉMENTS. Il y a peut-être deux façons de comprendre l’autodéfense : dans son sens courant, celui de se défendre contre des agresseurs éventuels ; mais il y a aussi un sens nettement moins courant, qui n’en est pas moins possible, celui se prémunir contre d’éventuelles agressions en aménageant des refuges (la forêt par exemple) ? C’est cette deuxième méthode que vous recommanderiez aujourd’hui ?
ÉRIC WERNER. Il faudrait, me semble-t-il, distinguer entre trois conceptions possibles de l’autodéfense : non pas deux mais trois. Trois conceptions correspondant à trois manières possibles de situer l’autodéfense par rapport à l’attaque. Il y a d’abord l’autodéfense au sens strict. L’autodéfense est ici concomitante à l’attaque (ou si l’on préfère immédiatement consécutive). On rend coup pour coup. Tout se passe dans l’instant présent. C’est la première conception de l’autodéfense. La seconde est l’auto-justice. J’en ai dit un mot tout à l’heure. C’est l’autodéfense différée. L’auto-justice ne prend donc pas place dans l’instant présent mais dans celui d’après. Après, ce peut-être le lendemain, mais aussi deux ans après. Cinq ans. On laisse passer un certain laps de temps, ensuite on agit. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on parfois. C’est la deuxième conception. Et maintenant la troisième. De même que l’autodéfense peut prendre place dans le moment d’après, elle peut aussi prendre place dans celui d’avant : l’autodéfense précédant ici l’attaque. On se prépare doncà ce qui va arriver, mais qui, justement parce qu’on s’y est préparé (et bien préparé), n’arrivera peut-être pas. C’est le recours aux forêts. Encore une fois, on est dans la fuite, l’évitement. Le but n’est pas ici de rendre coup pour coup, mais bien d’éviter les coups. L’accent est surtout mis ici sur la survie : on cherche à se maintenir soi-même en vie. Pour cela, on peut faire ce que vous dites : s’aménager des refuges en forêt. Mais il faut l’entendre au sens large. Dans la conception que s’en fait de Jünger, le recours aux forêts prend place aussi en ville ! Telles sont les trois manières de penser l’autodéfense : pendant l’attaque, après l’attaque et avant l’attaque. Cela étant, laquelle privilégier ? Tout dépend du rapport de force. Si l’on est le plus fort, éventuellement la première. Autrement, incontestablement la troisième. La deuxième, en complément éventuellement de la troisième.
ÉLÉMENTS. Diriez que Henry David Thoreau c’est la manière de prendre la tangente à gauche et Ernst Jünger à droite ?
ÉRIC WERNER. La désobéissance civile, effectivement, est plutôt de gauche. Pour autant, le recours aux forêts est-il de droite ? J’hésiterais personnellement à le dire. Il faut poser le problème autrement. L’opposition n’est pas ici entre la droite et la gauche mais entre deux attitudes contrastées à l’égard de la justice et plus fondamentalement encore de l’ordre légal existant. Dans la désobéissance civile, les gens ne contestent en aucune manière la légitimité des juges et de la police. Ils attendent tranquillement qu’on vienne les arrêter, sous l’œil des caméras et des observateurs des droits de l’homme. Certains se réjouissent même de passer par là. Cela leur fera de la publicité. Les condamnations, il est vrai, ne sont jamais très lourdes. On est presque dans la connivence, je ne sais d’ailleurs pas pourquoi je dis presque. Les rôles sont répartis d’avance, chacun son rôle. La désobéissance civile n’est en fait désobéissance à rien, ou à pas grand chose. Elle désobéit, certes, à une loi particulière, en revanche elle obéit à toutes les autres. C’est un rituel bien rodé. Il en va différemment du recours aux forêts. Dans l’optique du rebelle tel que l’entend Jünger, la légitimité n’est pas du côté de l’ordre légal existant, mais bien de son propre côté à lui : c’est lui qui est légitime, non l’ordre légal existant. Il ne voit dès lors pas pourquoi il accepterait de passer en justice. La désobéissance acquiert ici sa vraie dimension, elle est révolte contre toute espèce d’assujettissement, en particulier à l’Etat illégitime. La désobéissance civile relève encore de la servitude volontaire. Ce n’est en aucune manière le cas du recours aux forêts.
Propos recueillis par François Bousquet
Prendre le maquis avec Éric Werner (1/4) – L’État est-il notre ami ou notre ennemi ?
Prendre le maquis avec Éric Werner (2/4) – Vivons-nous en dictature ?


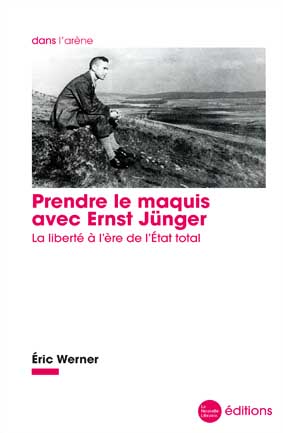



Une réponse
Série d’articles formidables !!
Vivement le dernier et merci beaucoup