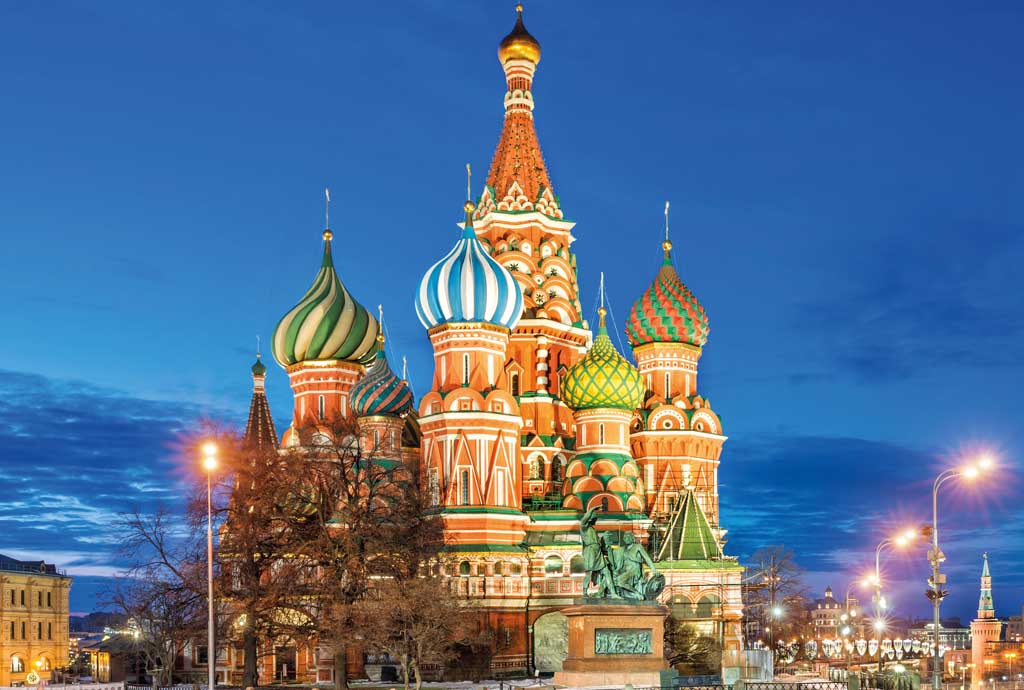OJIM. Après un premier hors-série sur le paganisme, Éléments en publie un second sous le titre « Notre Russie ». Ce numéro copieux reprend 24 articles de la « revue des idées » entre 1978 et 2022. En plein conflit russo-ukrainien ou américano-russe comme on voudra, vous ne donnez pas dans la provocation ?
FRANÇOIS BOUSQUET : L’anti-provocation plutôt. La provocation, c’est le bombardement médiatique intensif contre la Russie. Vue depuis Washington, Hollywood et Paris, sous-préfecture de l’Empire du bien, la Russie c’est l’Empire du mal ; Poutine, le chancelier Palpatine, le seigneur noir des Sith ; et le groupe Wagner, son armée de clones et de mercenaires. L’Amérique ne parvient pas à se défaire du récit manichéen qu’elle a créé et auquel elle a fini par croire. Sous l’URSS, elle ciblait déjà la Russie. Nous aussi, à ceci près qu’on ne l’ajuste pas avec la lunette d’un fusil ou d’un char, mais avec une paire de jumelles. Le plus frappant quand on lit ce hors-série consacré à la Russie, c’est la continuité éditoriale d’Éléments, d’abord à rebours du courant anticommuniste primaire, puis du courant néo-conservateur primaire, et aujourd’hui à rebours du courant occidentaliste primaire, je n’ose parler du courant huntingtonien primaire. Car Samuel Huntington était largement moins bête que ses émules français et européens. Français et Européens relevant ici plus de la clause de style que de la réalité, tant la formule d’Éric Besson sur les néoconservateurs américains à passeport français reste sur les plateaux TV dramatiquement d’actualité.
OJIM. Vous reprenez un débat endiablé de 1978 entre Jean Mabire (pro-Russie profonde) et François Dirksen (anti-soviétique et anti-russe), qu’est-ce qui a changé en quarante-cinq ans ?
FRANÇOIS BOUSQUET : C’est un débat que nous avions publié à l’occasion de la sortie du livre de Jean Cau, Discours de la décadence, sorti la même année que le discours d’Harvard de Soljenitsyne sur le courage. Ce qui a changé en quarante-cinq ans ? Pas grand-chose en vérité, si l’on veut bien admettre que le communisme n’a été qu’une parenthèse dans la longue histoire russe. Le plus amusant, c’est que Jean Cau – et Jean Mabire, qui se fait l’avocat de son livre – y développe un discours prorusse, que l’anticommunisme rendait alors quasiment inaudible à droite, mais à partir d’une grille de lecture racialiste et anti-universaliste, celle-là même qui a poussé certains identitaires à épouser aujourd’hui – dans tous les sens du mot, dont le sens matrimonial – la cause ukrainienne. À l’instar de Jean Cau, Jean Mabire voyait sous le vernis de la propagande soviétique les permanences de la Russie profonde. Je ne sais comment il aurait réagi, lui l’auteur des Éveilleurs de peuple, à la guerre russo-ukrainienne. Aurait-il défendu le peuple ukrainien ou le peuple russe ? Les deux sûrement, mais je veux croire qu’il aurait admis que la frontière entre les deux passe à l’intérieur même de l’Ukraine. Et soyons sûrs que les manœuvres américaines, britanniques ou polonaises l’auraient écœuré.
Quarante-cinq ans ou deux cent cinquante ans ? La vérité, c’est que la durée ne changera rien à l’affaire. La russophobie mobilise toujours les mêmes ressorts. Géographie asiatique, tradition despotique orientale héritée de l’occupation mongole, apathie inquiétante des masses, etc. Au lieu de lire la somme phénoménale de Leroy-Beaulieu sur L’empire des tsars et les Russes, on vit sur le legs brillant, étriqué et fielleux du marquis de Custine et de ses Lettres de Russie. C’est comme si, pour comprendre l’Amérique, on s’en remettait aux passages des Mémoires d’outre-tombe qui lui sont consacrés au lieu de lire Tocqueville. Or, Chateaubriand est en Amérique comme Custine en Russie : deux touristes qui voient des barbares partout. C’est un peu court.
OJIM. Un papier épatant de Pierre Gripari souligne la qualité d’une bonne partie du cinéma stalinien. Il y a là un paradoxe : l’art se porte-t-il mieux dans une société autoritaire, voire totalitaire, que dans une société libérale libertaire ?
FRANÇOIS BOUSQUET : Question épineuse. L’art, le vrai, l’authentique, non ! Sauf à considérer que les chefs‑d’œuvre de Soljenitsyne, de Varlan Chalamov, de Vassili Grossman, d’Aleksander Wat (côté polonais) sont les produits du communisme, alors qu’ils en sont la réaction et comme le contrepoison. La supériorité littéraire des dissidents est néanmoins évidente par rapport à la production occidentale sur la même période. C’est qu’il y avait de l’autre côté du mur encore une épopée à raconter, fût-elle celle de L’Archipel du Goulag et des Récits de la Kolyma. Difficile de trouver un matériau épique dans la société de consommation. Il en va différemment des arts populaires. C’est ce que nous dit Pierre Gripari, merveilleux critique – combien vous avez raison ! Quand il parle d’un auteur, il a tout lu de lui. Quand il évoque un cinéma national, il en a vu tous les films. Il se trouve en outre que Gripari avait été communiste dans sa jeunesse, qu’il lisait les grands auteurs russes dans le texte. Nul n’était mieux placé que lui pour aborder le cinéma soviétique, cinéma de propagande qui a souvent flirté avec le génie filmique. Certes, Gripari n’évoque pas qu’Eisenstein, mais enfin l’ombre du réalisateur d’Octobre, d’Alexandre Nevski, d’Ivan le terrible, plane sur le cinéma soviétique, tout comme celle de Leni Riefenstahl sur le cinéma nazi. Le cinéma, c’est le grand livre d’images à l’âge des masses. Sauf exceptions, il ne faut y chercher ni la profondeur psychologique ni l’épaisseur métaphysique des grands personnages de la littérature. En revanche, le cinéma de propagande peut accoucher de scénographies grandioses, de chansons de geste fabuleuses, de tableaux à rendre jaloux les peintres pompiers par la profusion des figurants, de scènes d’édification religieuse où le merveilleux le dispute au miraculeux. Sa beauté vient de là, il invente une mythologie pour l’âge des foules. Gripari en décrit les rouages de façon succulente.
OJIM. Une bonne partie du dossier porte sur la littérature, Gogol, Tolstoï, Limonov, Prilepine (victime récemment d’un attentat). Que nous apporte la grande littérature russe ?
FRANÇOIS BOUSQUET : Tout est surdimensionné en Russie, la littérature aussi. Drieu la Rochelle disait que les Russes avaient jeté en un demi-siècle littéraire ce que l’Europe occidentale avait mis cinq cents ans à édifier. La littérature épique, lyrique, comique, tragi-comique, satirique, etc. D’où l’impression de lire des fleuves en crue, chez Tolstoï et Dostoïevski, mais aussi chez des classiques moins connus en Occident, les Saltykov-Chtchedrine, les Gontcharov, les Leskov. S’y ajoute la philosophie. Il y a eu des philosophes de génie en Russie, mais ils sont venus après les grands romanciers qui se sont emparés des questions philosophiques en les incarnant dans des personnages inoubliables. Plus fondamentalement peut-être, la littérature russe a renouvelé notre vision du christianisme. Il y avait les Pères de l’Église ; avec la Russie, il y a eu pour ainsi dire les Frères de l’Église. Or, ces frères étaient des écrivains. Je n’ai toujours pas lu l’« Autobiographie » d’Avvakoum, le chef martyr des vieux croyants, au XVIIe siècle, mais Dostoïevski et Tosltoï la tenaient pour le premier grand texte de la littérature russe. Voyez combien cette dimension religieuse est structurante.
Sur la nouvelle littérature russe, c’est encore autre chose. Si la littérature russe de la fin du XIXe siècle est sortie du Manteau de Nicolas Gogol, comme le disait Dostoïevski, celle de la fin du XXe siècle et des débuts du XXIe siècle sort en grande partie des livres trash de Limonov. Ces écrivains, ce sont « les bâtards de Staline et de Limonov », disons-nous – soit le national-bolchevisme dans une version punk, un mélange de guérilla urbaine et de poésie déjantée sur fond de vodka et de tirs de Kalachnikov. Cela horrifiait Soljenitsyne qui traitait Limonov de « petit insecte qui écrit de la pornographie ». Qui n’aurait pas envie de lire – et d’aimer – un tel auteur ? Dostoïevski, entre tous le plus grand, réunit les deux : la Russie des saints et des possédés.
OJIM. Alain de Benoist explique dans un article de 1986 pourquoi il est anti-communiste et, dans un autre de 2022, il constate le retour du rideau de fer. Ce rideau de fer est-il simplement géopolitique ou bien est-il également idéologique, voire civilisationnel ?
FRANÇOIS BOUSQUET : C’est un tel imbroglio, indémêlable, inextricable, de géopolitique, d’idéologie, de religion encore plus que d’idéologie, de civilisation, qu’il est presque impossible de répondre à votre question. On ne peut pas détacher l’actuelle russophobie de l’arrière-plan géopolitique qui la conditionne, quand bien même elle sort de la guerre froide, laquelle plonge ses racines dans une opposition ancienne, qui remonte peut-être à la chute de Constantinople. Géopolitiquement, l’Amérique en est restée à la politique expansionniste de Zbigniew Brzezinski : encercler la Russie par le contrôle de ses régions frontalières, depuis la Baltique jusqu’à l’Asie centrale. Au fond, la version contemporaine de la doctrine Truman de l’endiguement. Ce qui est, très légitimement, inacceptable pour les Russes. Le premier Poutine, celui des années 2000, clairement occidentaliste, voulait ne pas y croire, du moins a‑t-il cru dans une capacité de résistance des Européens aux Américains, en vain. Faute d’être entendu, il en est revenu à un discours plus familier à l’oreille des Russes, singulièrement au courant slavophile, celui de l’« altérité russe », tournant le dos à l’Europe, pour le plus grand malheur de l’Europe – et de la Russie, si l’on veut bien admettre qu’en Russie, les ressources sont à l’Est, mais les hommes à l’Ouest.