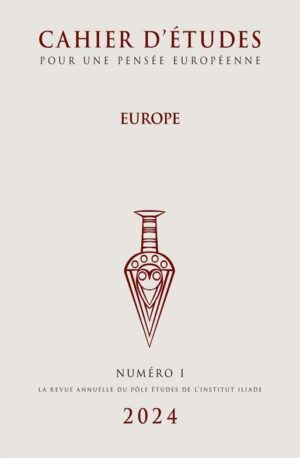ÉLÉMENTS : La question de l’Europe et de l’Occident agite, sinon même déchire, les milieux identitaires, souvent à partir d’une fracture générationnelle, les plus jeunes se réclamant généralement de l’occidentalisme. Aviez-vous en tête ce clivage lorsque vous vous êtes lancé dans la rédaction de cette étude ? Si oui, que vous inspire-t-il ? Plus largement, quels enjeux civilisationnels recouvre cette fracture ?
WALTER AUBRIG. Cet article forme à bien des égards le prolongement d’une réflexion déjà amorcée en 2022, alors que le contexte international que vous connaissez avait suscité un regain soudain des vieux réflexes atlantistes. Il faut néanmoins souligner que sous sa forme présente, ce travail, à dessein, n’a pas en premier lieu de visée géopolitique. Cette dimension a été traitée avec beaucoup d’acuité et de discernement par Max-Erwann Gastineau, dans le très vaste entretien du Cahier d’Études. Notre intention avec cet article est bien plutôt d’aborder la question fondamentale de l’identité. Car c’est aussi et peut-être surtout de cela qu’il s’agit, lorsqu’on parle aujourd’hui de l’Occident. Interroger cette terminologie, ce n’est pas se prononcer en faveur ou contre un choix stratégique. Il s’agit en fait, plus simplement, de se demander ce que les Européens ont encore à voir avec l’Europe. À travers ce dilemme, bien plus qu’une situation mondiale à laquelle il convient surtout de se confronter avec un pragmatisme froid, se répercute donc à bien des égards la crise d’identité d’une génération. Une génération qui cherche des réponses dans les motifs contradictoires mis à sa disposition, à travers les « contenus » les plus divers. Elle entretient avec ce questionnement un rapport complexe et composite, dans lequel la provocation semble aussi jouer un rôle important. Il y a donc indéniablement un enjeu ici, d’autant plus que l’hétérogénéité des prises de position laisse place à toutes les possibilités.
Bien entendu, il serait illusoire de penser qu’un article de revue soit de nature à intervenir dans ce débat, si tant est qu’il y ait un débat. Affaire de registre, affaire de style aussi. Il n’est pas impossible que, pour nous, cette réflexion ait d’abord été l’occasion de nous confronter à notre manière à une préoccupation qui fait partie intégrante de l’époque et à laquelle, au moins à ce titre, nous ne pouvons échapper entièrement. Que le lecteur puisse trouver dans ce cheminement de pensée une voie praticable, à défaut de certitudes prêtes à l’emploi, c’est donc ce que nous pouvons espérer de mieux.
ÉLÉMENTS : Qu’est-ce que l’Occident d’une part ? Et l’occidentalisme d’autre part ? Les deux termes ne devraient-ils pas être distingués ?
WALTER AUBRIG. Je dirais que non seulement il faut distinguer l’Occident de l’occidentalisme – j’y viens –, mais il est indispensable de mettre en lumière la polysémie de la notion d’Occident elle-même, sans quoi on s’exposerait nécessairement à des malentendus. La langue française, pourtant si riche en nuances et subtilités, ne nous aide guère à nous y retrouver. Mais un petit détour par l’allemand nous permet d’y voir plus clair : ce qui a longtemps été l’acception commune de l’Occident, c’est ce qu’outre-Rhin, on appelle Abendland, le pays du couchant. Le mot porte en lui toute la charge romantique d’un temps où le monde était divisé en deux moitiés – l’Occident chrétien d’une part, héritier de l’Empire romain du même nom, et l’Orient d’autre part, qui commençait à Byzance et dont les dimensions ne trouvaient leurs limites que dans le souvenir mythique des conquêtes d’Alexandre, ou dans les merveilles rapportées par le récit de Marco Polo. Cependant, cet Occident s’est peu à peu effacé au profit de l’idée d’Europe avec l’entrée dans la modernité, à la Renaissance. C’était l’âge des grandes découvertes, le début du nomos de la terre, pour parler en schmittien. Dès lors, les Européens se sont défini non plus par rapport à un axe est-ouest, mais par rapport à un territoire : le continent européen dans sa confrontation avec le reste du monde. Ce n’est qu’au cours du XXe siècle, et singulièrement dans le face-à-face des grands blocs durant la guerre froide, que le terme d’Occident a été remobilisé pour désigner une réalité aux implications toutes différentes : le grand Ouest, the Western World. Et il est bien entendu que lorsque Dominique Vener intitulait son livre-testament Un samouraï d’Occident, c’est à l’antique Hespérie bien plus qu’à l’organisation atlantique qu’il songeait.
Venons-en donc à l’occidentalisme. Nous ne sommes plus au temps d’Henri Massis, qui s’est opposé dans sa Défense de l’Occident au traditionalisme d’un René Guénon, défenseur de la tradition métaphysique orientale, ni même de Denis de Rougemont, lorsqu’il retraçait la geste spirituelle de l’Aventure occidentale de l’homme. L’occidentalisme, aujourd’hui, c’est la réduction de l’européanité en tant qu’identité à un nombre relativement limité de communs dénominateurs propres au monde occidental, et qui devraient impérativement être revendiqués et défendus. Parmi ces critères récurrents, un ensemble de valeurs orientées par l’idéal de l’émancipation et de droits individuels (notamment pour les minorités), la démocratie parlementaire, le progrès technologique qui va volontiers de pair avec le développement d’une économie fondée sur l’accès le plus large possible à la consommation, et ainsi de suite. Pour les plus essentialistes, cet Occident se caractérise également par la couleur de peau, et se superpose dès lors avec l’idée de « monde blanc », répondant ainsi de manière quasi mimétique aux nouveaux discours indigénistes et décoloniaux. Parfois, et c’est particulièrement le cas dans le contexte actuel, l’Occident est aussi assimilé à l’idée d’un monde judéo-chrétien, avec une acception cependant très variable au regard de la grande diversité des Églises chrétiennes.
Faire la critique de cet occidentalisme n’équivaut pas, bien entendu, à nier le fait qu’un certain nombre de ces marqueurs caractérisent effectivement l’Europe aujourd’hui, ni même à les rejeter en bloc, quoique leur légitimité, au moins pour partie, soit plus que contestable. Il s’agit bien plutôt de dire qu’une réflexion sur l’identité qui se fonde sur une telle rhétorique est condamnée à plus ou moins long terme, car elle passe à côté de ce qui fait une identité collective capable de se projeter dans l’histoire.
ÉLÉMENTS : Vous vous appuyez dans votre analyse sur l’anthropologie culturelle et sur l’écologie culturelle. Si la première est connue des lecteurs de la Révolution conservatrice, sans parler des familiers de l’œuvre d’Arnold Gehlen, la seconde un peu moins. En quoi consiste-t-elle et quel est son apport ici ?
WALTER AUBRIG. L’écologie culturelle, qui s’est développé à partir des années 1950 dans le sillage de l’anthropologue américain Julian Steward, est à bien des égards une réponse aux thèmes centraux de l’anthropologie culturelle, ou plus précisément leur développement conséquent, dans une démarche disciplinaire sensiblement différente. L’approche singulière de l’anthropologie culturelle, telle que nous pouvons la mobiliser pour notre sujet, consiste à dire que la nature des hommes se fixe à travers leur mise en forme culturelle. Historiquement, elle s’est construite dans un rapport critique au réductionnisme, sans pour autant nier l’existence de données innées. Il s’agissait plutôt de formuler de manière nouvelle le rapport entre le biologique et le culturel. La conséquence de cette approche, qui trouve de très nombreux points de contact avec les noms qui ont marqué l’anthropologie comme discipline scientifique, est donc de concevoir toute identité, individuelle ou collective, comme une expression d’un devenir historique singulier. L’apport non négligeable de l’écologie culturelle a été de montrer que ce destin historique est toujours lié à un espace, celui au contact duquel la collectivité a émergé, et qu’elle a progressivement transformé, dans un développement créateur propre. À la différence des espèces animales, qui sont naturellement intégrées dans un milieu défini une fois pour toutes, les hommes lient leur destin à un espace donné en s’y projetant. Ils génèrent, en quelque sorte, le biotope dans lequel leur manière d’exister prend forme, et ce biotope a donc nécessairement toujours un temps et un lieu. On pourrait ici emprunter à Michel Maffesoli le concept d’enracinement dynamique.
Alors qu’est-ce que cela a à voir avec notre question ? Une pensée exclusivement réductionniste tendrait par exemple à croire que tels les greffons d’un arbre, les groupes d’émigrés européens partis s’installer dans le Nouveau Monde n’ont fait que poursuivre sur un sol différent une aventure qui reste essentiellement celle des Européens. Les ruptures géographiques et historiques seraient des données négligeables. Partant de là, la culture américaine, par exemple, serait une expression parmi d’autres d’une civilisation commune, au même titre que la culture allemande et la culture française. Or, contrairement à ce qu’on pourrait penser de premier abord, il ne s’agit pas d’évaluer par l’observation empirique le degré de différence de ces cultures pour mesurer une forme de déviation par rapport à un fond commun – là encore, ce serait raisonner exclusivement par l’essence, et ignorer le poids des dynamiques collectives, et donc in fine à la fois l’orientation par le politique et les tendances lourdes du développement anthropologique. Car de fait, de par son apparence et de par la manifestation quotidienne de son héritage culturel, un Napolitain a de très fortes chances d’avoir plus de similarités avec un Italo-Américain qu’avec un Suédois. Mais ce qui fait de lui un Napolitain, un Italien, et donc un Européen, n’engage pas moins toute son existence culturelle dans un destin qui, à chaque niveau d’appartenance qui le définit, diffère et parfois s’oppose à celui de son cousin éloigné. C’est donc une compréhension plus fine et plus différentiée de ces facteurs dynamiques, essentiels pour la définition des enjeux qui s’imposent à nous, que permettent à la fois l’anthropologie et l’écologie culturelle.
ÉLÉMENTS : Vous pointez non sans raison la tentation – et l’impasse – universaliste de l’occidentalisme. Mais sa matrice n’est-elle pas à chercher en Europe ?
WALTER AUBRIG. À certains égards, c’est tout à fait exact. Car l’aspiration à l’universel a été partie intégrante de la projection de l’Europe dans le monde. C’est tout particulièrement dans les grandes révolutions atlantiques, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, que l’occidentalisme des valeurs puise ses racines. Le colonialisme civilisateur n’en a été qu’un avatar passager, lointaine préfiguration de l’humanitarisme stratégique que nous observons toujours dans les prises de décision occidentales. Cet universalisme semble aujourd’hui définitivement condamné par l’histoire.
On voit cependant s’imposer une autre forme d’universalisme en négatif, bien plus ambiguë et paradoxale, à plus forte raison qu’elle se construit essentiellement sur un discours anti-universaliste. Celui d’une conception identitaire affranchie de toute forme de coexistence historique et de tout espace propre, qui se reconnaît dans des assignations aussi absolues et régressives que la couleur de peau ou le genre. De telles conceptions peuvent par exemple conduire leurs tenants, tous bords confondus, à résumer les enjeux de l’époque à l’affrontement des peuples, déterminés par leur seule essence. Ici, la fonction matricielle de l’Europe devient en revanche beaucoup moins certaine.
Cela mérite quelques explications. On aurait en effet beau jeu de nous reprocher d’évacuer, dans notre réflexion, l’importance de la question ethnique. Et c’est bien là que nous touchons au point le plus sensible – pour beaucoup sans doute le point essentiel. Il nous semble en effet, en application rigoureuse de notre conception propre du monde et de l’existence des sociétés humaines, qu’il n’y a pas de fait ethnique qui ne soit, par définition, un fait ethnoculturel, engagé en tant que tel dans un devenir historique, c’est-à-dire politique. La méconnaissance de cette réalité forme un élément important de la question occidentale, sur lequel nous souhaitons attirer l’attention. La lecture qui tend à choisir, pour les peuples européens, l’assignation identitaire à un « monde blanc », est en tant que telle la manifestation d’une influence sans précédent de thématiques intrinsèquement étrangères : celles de la société américaine. Et leur inflation dans les sphères identitaires, qu’elles soient de gauche ou de droite, ne peut être décorrélée de l’audience croissante des discours anglo-saxons, notamment via les réseaux d’influence.
Les sociétés européennes se sont toutes construites sur une cohérence ethnique fondamentale, ce qu’aucune étude historique sérieuse ne saurait démentir. Au contraire, pour les États-Unis, de par l’hétérogénéité intrinsèque de leur développement démographique, la multiethnicité s’est imposée comme un thème décisif, générateur d’une conflictualité irréductible. Et cette réalité s’applique à vrai dire à la plupart des pays du monde occidental non-européen. C’est pourquoi, outre-Atlantique, le fait d’être noir ou d’être blanc a été, dès la période coloniale, un enjeu d’identité déterminant, largement distinct d’ailleurs du fait d’être un Américain. Vouloir dissoudre dans ce même paradigme la question de l’identité pour les peuples d’Europe, fût-ce dans le souci de leur survie, c’est donc dès l’abord raisonner en non-Européen. C’est décréter a priori qu’un mode d’existence alliant l’ethnos et la polis, inhérent à l’européanité, ne peut être valable. C’est oublier que la substance de nos peuples ne peut être assurée que si elle projette son action créatrice dans l’espace qui lui appartient : celui d’un continent multiple avec ses enjeux propres. Et c’est à ce titre, plus peut-être qu’à aucun autre, que la question identitaire de l’Europe, à nous yeux, ne peut trouver sa résolution que dans l’affirmation de son existence civilisationnelle, au moyen de prises de décision politiques qui tiennent compte des réalités historiques en perpétuel changement.
Lire aussi :
Quelles langues pour l’Europe ? (1/3) : Entretien avec Armand Berger
Quelles langues pour l’Europe ? (2/3) : Entretien avec Olivier Eichenlaub