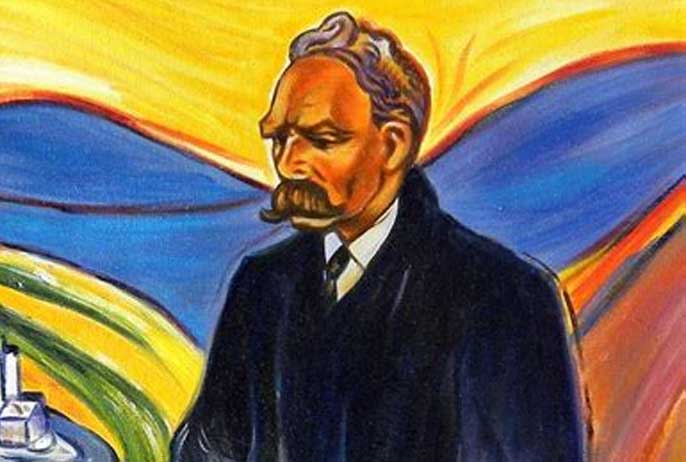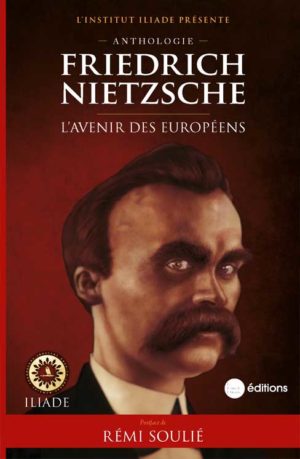Le terme de « valeur » a été défiguré par l’usage contemporain de la notion frelatée de « valeurs de la République ». Il est toutefois bien difficile de na pas l’utiliser quand il est question du philosophe Friedrich Nietzsche. Parlera-t-on plutôt d’idéaux ? Idéaux aristocratiques face aux idéaux « démocratiques » ou « égalitaristes » ? Mais la notion d’idéal est dualiste. Elle implique un écart entre le réel et un devoir-être. Elle implique un dualisme. Une notion pas très nietzschéenne. Si valeur veut dire « ce qui vaut » : ce qui vaut la peine que l’on prenne des risques, ce qui vaut la peine que l’on risque sa vie, ce qui vaut la peine que l’on crée une esthétique, le mot doit être réhabilité. Si quelque chose vaut la peine que l’on se sacrifie, c’est aussi qu’il n’y a pas « rien » comme valeur. C’est une critique du nihilisme des valeurs comme quoi rien ne vaut la peine que l’homme fasse effort sur lui-même.
Pour Nietzsche, le nihilisme, c’est de dire qu’aucun effort d’élévation n’a de valeur. En d’autres termes, c’est le triomphe des valeurs les plus basses car, de fait, si tous les hommes sont égaux, à quoi bon vouloir se dépasser, et ainsi s’élever au-dessus des médiocrités communes ? Le nihilisme selon Nietzsche, c’est aussi vouloir faire primer la recherche de ce qui est vrai sur ce qui est haut. Au lieu d’agir, de créer, de se donner des défis, on cherche la nature du vrai. Pour quoi faire ? Pour se rassurer ou pour se donner le sentiment de la vanité de toutes choses. Confortable sentiment ! Si l’effort n’est qu’illusion, à quoi bon en faire ? Si l’honneur n’est qu’illusion, ou puérile vanité, à quoi bon le défendre ? Soyons modestes, soyons médiocres, et nous vivrons heureux (et longtemps !). Mieux vaut dix ans de vie de chameau qu’un an de vie de lion. C’est la formule de Mussolini, mais à l’envers. C’est pourquoi pour Nietzsche, Socrate, c’est le nihilisme, avec sa recherche pataude de la « vérité », avec sa critique niaise de la religion (celle des Grecs), qui, vraie ou fausse (qu’importe !), pousse les hommes vers la vertu, vers le haut, vers le beau. Socrate le « fatigué de la vie ». Eh bien, qu’il n’en dégoûte pas les autres et laisse la place à ceux qui aiment la vie plus que les ratiocinations. Et le christianisme ? Qu’en attendre ? « Rien », nous dit Nietzsche. Il n’est ni dionysiaque : la force, la guerre, la fureur et la joie ; ni apollinien : la sérénité, la mise en ordre des passions. Surtout pas le christianisme, dit Nietzsche : il nie les valeurs esthétiques, à savoir que ce qui vaut, c’est ce qui est beau, au profit des valeurs morales, à savoir que ce qui est bien, c’est ce qui est gentil. Dans le christianisme, le bien n’est plus d’abord le beau. Il n’est plus d’abord le fort.
Oublions la vérité
Nietzsche veut libérer l’homme de la quête mortifère de la vérité. Vous voulez savoir ce qui est vrai ? Ce qui est vrai est devant vous. C’est l’énergie. Soit vous lui dites « oui », soit vous reculez devant la vie, comme un crabe baveux, eût dit Céline. « Au lieu de dire naïvement : “Je n’ai plus aucune valeur”, le mensonge moral dit par la bouche du décadent : “rien n’a aucune valeur, la VIE n’a aucune valeur”… » (Le crépuscule des idoles). Si vous ne voulez pas vouloir, vous allez dire que la vie ne vaut rien. Trop facile. Si vous subordonnez l’énergie à une vérité, vous êtes nihiliste. Cela ne veut pas dire qu’il vous faut aimer le mensonge, cela veut dire que vous ne trouverez jamais rien de plus vrai que la croyance en la vertu de votre énergie. « Nous avons aboli le monde vrai », écrit Nietzsche dans Le crépuscule des idoles. Le vrai n’est plus le critère. « Non, ce mauvais goût, cette volonté de vérité, de la “vérité à tout prix”, ce délire juvénile dans l’amour de la vérité – nous l’avons désormais en exécration : nous sommes trop aguerris, trop graves, trop joyeux, trop éprouvés par le jeu, trop profonds pour cela… Nous ne croyons plus que la vérité soit encore la vérité dès qu’on lui retire son voile : nous avons trop vécu pour croire cela. » (Par-delà le bien et le mal). Voici le temps des pures énergies. Ce qui vaut, c’est l’énergie.
Mais Nietzsche n’en reste pas là. Il est certes vitaliste. Mais ce n’est pas un pur vitalisme, et c’est moins encore un darwinisme social. Le plus fort n’est pas le meilleur à n’importe quelles conditions. Le meilleur est celui qui abat les valeurs qui doivent tomber au profit des valeurs qui doivent monter. La question que nous devons nous poser est donc : quelle est la valeur des valeurs ? Exemples : moins de charité, plus de générosité, moins de tempérance, plus de force de vivre, moins de goût pour la quantité, plus de goût pour la qualité, etc. Les valeurs qui ne valent rien sont les valeurs qui provoquent la fatigue, l’impuissance à aimer et à vouloir, l’excès de compassion. Ce sont les valeurs chrétiennes, dit Nietzsche. Il exagère ? Peut-être. Il est injuste par rapport au christianisme médiéval ? C’est bien possible. Mais la question de Nietzsche n’est pas la vérité. La question est : qu’est-ce qui vaut quelque chose.
Le temps du nihilisme totalitaire
Ce que nous idolâtrons à tort doit être balayé. « Les valeurs de déclin, les valeurs nihilistes règnent sous les noms les plus sacrés » (Le crépuscule des idoles). Telle est le fruit vénéneux du christianisme. Abattre ces valeurs est le bon nihilisme. Nier ce qui rend faible : voilà notre travail. Le mauvais nihilisme, c’est au contraire celui qui ferait subsister ces valeurs de faiblesse et abattrait les valeurs de force, de fierté, d’orgueil. Le nihilisme passif, c’est celui qui laisse subsister les valeurs de faiblesse. Il se contente de conserver ce qui est médiocre. Mais c’est déjà beaucoup. Et c’est trop. Cela suffit pour nous maintenir dans un océan de médiocrité.
Mais est venu le temps du nihilisme dur. Pas de quartier pour ce qui différencie. Pas de quartier pour ce qui ennoblit. Pas de quartier pour ce qui élève. Plutôt tout le monde vers le bas que quelques-uns vers le haut. Le nihilisme mou et fatigué est devenu dur et totalitaire. C’est l’idéologie de la déconstruction. Il s’agit de faire passer en force les valeurs de faiblesse, tandis que, dans le même temps, on exalte les anti-esthétiques : la laideur, la culture de la culpabilité, de l’excuse, etc. Abolir le sens du beau va avec l’abolition du sens du noble. C’est un tout et l’un ne peut aller sans l’autre. Les nihilistes déconstructeurs mènent en ce sens une guerre cohérente contre tout ce qui élève et pour tout ce qui rabaisse. Que faire face à cela ? Nier le nihilisme et tourner nos regards vers ce qui est beau, bien, noble.
Le refus des mondes de substitution
Se réfugier dans la quête de la vérité, et notamment la vérité des religions institutionnalisées, fait partie du nihilisme. Pour Nietzsche, cette quête a souvent consisté à imaginer un monde derrière le monde, un arrière-monde, un monde plus vrai que le monde qui apparaît. C’est là de la tromperie, de la faiblesse, de la fuite devant la vie. N’existe selon Nietzsche que ce qui est là, et ce qui existe est pleinement là à l’exclusion de tout autre monde, de toute cause du monde extérieure au monde lui-même. Le refus de la métaphysique par Nietzsche, c’est le refus de toute connaissance a priori par la raison pure, et sur ce point, son refus ne sera pas éloigné de celui que manifestera Heidegger, malgré les différences considérables entre les deux penseurs, notamment du fait de la définition du nihilisme et de la métaphysique par Heidegger comme engloutissement dans la sphère de la puissance. L’époque moderne, réduite à la recherche de la puissance, est ainsi selon Heidegger « l’époque de la plus parfaite absence de sens ».
Pour Nietzsche, la puissance comme seul telos n’est pas le danger. C’est la vérité qui est le danger. « Mais l’on aura déjà compris à quoi j’en veux venir, à savoir que c’est encore et toujours une croyance métaphysique sur quoi repose notre croyance en la science – et que nous autres qui cherchons aujourd’hui la connaissance, nous autres sans dieu et antimétaphysiciens, nous puisons encore notre feu à l’incendie qu’une croyance millénaire a enflammé, cette croyance chrétienne qui était aussi celle de Platon, la croyance que Dieu est la vérité, que la vérité est divine… » (Le Gai savoir). Nous avons trop longtemps cru à un monde-Dieu, un monde-science, un monde-vérité, qui serait plus vrai que le monde qui apparait. Notre dernière religion, nous dit Nietzsche, c’est la religion de la science, et aussi la religion du progrès continue des connaissances. Non pas que les connaissances soient inutiles, non pas qu’il n’y ait une certaine noblesse à être des hommes de connaissance. Mais connaître ne résout pas la question du sens. Notons toutefois que dans la critique du monde-vérité, il y a une critique du darwinisme politique et social. Ce qui triomphe n’est pas plus vrai que ce qui ne triomphe pas, et quand bien même serait-il plus vrai, la vérité n’a aucune valeur en soi.
Des forces et des volontés
Avec le refus d’un monde-vérité, la vérité de nous-mêmes est aussi mise en question. Le sujet n’est pas pleinement sujet de soi. Il est avant tout sujet de la volonté de puissance. Le sujet est au centre d’un jeu de forces et de relations. Gilbert Durand insistera justement là-dessus : c’est le rôle éminent des imaginaires. En ce sens, ce que l’homme croit décider se décide souvent indépendamment de lui, ou en tout cas au-delà de sa volonté. Nietzsche inaugure ainsi une philosophie du soupçon. Marx et surtout Freud lui donneront d’autres contours et d’autres développements. Quand je décide, qui décide en moi ? Qu’est-ce qui parle en moi quand je dis « Je » ? Pour Nietzsche, ce sont des forces et des volontés. Des volontés parfois inconscientes : des énergies. Le monde est ainsi une constante mise en perspective de soi, à partir de la volonté, et ce perspectivisme est un anti-nihilisme. Cette mise en perspective fait qu’il n’y a plus de place pour les valeurs extérieures à l’homme lui-même, les « valeurs » de la société, qui ne sont que des idoles. À ces valeurs, il faut opposer la vie et l’échelle de ses exigences. Les valeurs, même aristocratiques, et surtout elles, se vivent, et ne s’admirent pas de l’extérieur. Elles n’ont de sens, nous dit Nietzsche, que transformées en un « grand style ». Celui-ci consiste à tout regarder d’en haut, et à détourner son regard de ce qui est bas. Refuser le nihilisme, c’est pour Nietzsche avant tout refuser le dualisme. Il s’agit de refuser le « doublement » du monde sensible par un monde suprasensible. Il s’agit de refuser ce que les Anciens appelaient la coexistence d’un monde sublunaire (le nôtre), fluctuant, et d’un monde supralunaire, celui des dieux et des astres, immobile et éternel, plus vrai que l’autre en tant qu’il ne change pas. Ce qui est vrai pour Nietzsche, c’est au contraire ce qui peut se métamorphoser et ne cesse de le faire.
C’est pourquoi la mort de Dieu est une bonne nouvelle car elle invalide un monde faux (d’autant plus faux qu’il est incapable de se métamorphoser). Mais la mort de Dieu est aussi un défi. Elle nous oblige à rendre beau le seul monde qui existe, celui d’ici et de maintenant. La mort de Dieu nous oblige au perspectivisme, car il n’y a dès lors plus de point de vue surplombant sur le monde. Nous sommes jetés dans le monde. La mort de Dieu a ainsi amené à la mort d’un monde des idées séparé de la vie et séparé du corps. La mort de Dieu a amené à la fin du dualisme. La recherche de vérité, en se concentrant sur ce qui est certain, n’a trouvé que des certitudes provisoires et éphémères, les certitudes d’une science qui s’accélère, mais aussi qui s’abolit dans la technique. La fin de la métaphysique dualiste (à partir des monothéismes, hommes et Dieu constituent deux mondes séparés) ouvre par ailleurs la voie à d’autres nihilismes comme le nihilisme de l’homme. En effet, si le dualisme est en soi un nihilisme, il n’est pas le seul. Le monisme peut s’affaisser sur lui-même. Le monisme de la seule croyance en l’homme peut se transformer en dualisme homme/structures, en un sociologisme desséchant et incapacitant. Il peut ramener le monde, et ses ressources d’images, d’énergie, de beauté, à la faiblesse de l’homme, et à sa fatigue. L’homme ne serait alors plus en mesure de donner une quelconque perspective au monde. Il serait balloté au gré des vents, au gré des opinions, sans foi en lui-même, ni foi en ce qui le dépasse.
Reste l’amor fati
La seule croyance en l’homme peut être une version basse, minimaliste de l’humanisme. Elle peut nous ramener au nihilisme, si elle ne nous met pas au défi de créer du beau et du fort. Toute la difficulté que pose Nietzsche est qu’il refuse le nihilisme tout en abandonnant des points d’appui essentiels. Nietzsche abandonne la téléologie : le monde n’est pas ordonné en fonction d’un but final. Nietzsche abandonne la mécanique du monde : il n’obéit pas à une logique, qu’elle soit la raison pure ou la raison historique. Enfin, le monde n’obéit pas au critère de la vérité. « Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont » (Vérité et mensonge au sens extramoral). Le monde est incertain, il est aussi éclaté et sans but. Il ne subsiste qu’un possible « oui » au monde, un « oui » qui concentre en lui toute l’éternité. C’est l’amor fati. C’est l’acceptation sans saut de recul de son destin. C’est la volonté de lui donner une certaine couleur, une certaine forme. Sur une corde tendue entre l’animal et le surhomme, voilà l’homme. Au-dessus de l’abîme, le voici qui se tient debout, et qui avance, et qui parfois danse avec grâce. C’est déjà beaucoup. Et en tout cas, ce n’est pas rien.
Derniers ouvrages de l’auteur :
Pierre LE VIGAN, Avez-vous compris les philosophes ? Éditions La Barque d’or, 216 p., 5,55 €.