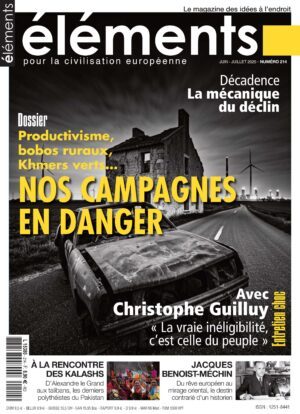Ni reliques, ni Rolex… Mais qu’est-ce au juste qu’un Cabinet d’art et de de curiosités ? Si les livres rares trouvèrent vite leur place dans de somptueuses bibliothèques, où pouvait-on regrouper des instruments scientifiques, des spécimens étonnants rapportés par des voyageurs ou offerts par des ambassadeurs, des échantillons de productions exotiques susceptibles d’être copiées ? Dans un Cabinet de curiosités, un Kunstkammer, lieu idéal où préserver et collectionner. Avec sans doute aussi un effet de snobisme, ces cabinets étant voués tout autant à la recherche qu’à l’exhibition de la richesse de ses mécènes. « Tous les curieux ne sont pas des connaisseurs », remarquait déjà Furetière dans son Dictionnaire universel (1690), et Lamarck de surenchérir, deux siècles plus tard, disant de ces cabinets de curiosités mettant en avant la rareté plus que l’intérêt scientifique qu’ils n’étaient bon qu’à servir d’« amusement aux personnes oisives ». Quelle chance, cette oisiveté aussi bien comprise !

Le Cabinet d’art entre la relique et le musée
Côté « reliques », on admirera une corne de licorne – en fait, une dent de narval ; ou encore un bézoard revêtu de filigrane d’or : ces conglomérats de substances non digérées (eh oui !) étaient réputés être des antidotes vendus à prix d’or. Avec des vertus magiques à peu près semblables à celles des dents de lait ou des métatarses de tel ou tel saint inconnu – l’important étant en effet la mise en abyme de l’objet vénéré, par profusion d’or, d’encens et de pierreries.
Côté Rolex, certains chefs-d’œuvre de joaillerie et d’orfèvrerie confinent, il faut le reconnaître, au bling-bling et au m’as-tu-vu, tel ce pot en escargots de mer, où différentes coquilles empilées sont reliées par de l’argent doré ; ou cette statuette au plateau d’émeraudes de près de 6 kilos bon poids, montrant un indigène (horreur, cachez ce stéréotype que je ne saurais voir !) offrant ses pierres précieuses comme d’autres des petits pains.
Le Cabinet d’art peut aussi être compris comme le chaînon manquant entre le trésor religieux et le musée à vocation scientifique. Les collections témoignent de l’émerveillement naïf qui régnait alors quand des voyageurs rapportaient à la cour d’étranges objets venus du bout du monde : noix des Seychelles, turbo, nautile ou lambi… mis en valeur par des artisans d’art germaniques. La curiosité et l’enthousiasme se manifestaient aussi face aux subtilités d’une créativité technique mise au service d’objets utiles ou futiles. Utile, cette sublime horloge de table astronomique, avec ses cadrans, son réveil, son astrolabe et son calendrier. Plus futile, ce centre de table conçu à Nuremberg entre 1603 et 1609 : un nautile monté sur roues devient la coque d’un bateau sur lequel se meuvent de délicieuses statuettes en argent doré.

Chinoiseries et turqueries à la sauce woke
Mais quand arrivent de Chine ou du Japon de magnifiques porcelaines achetées à prix d’or, l’intérêt devient aussi technique qu’économique, voire politique : percer les secrets de la porcelaine, c’est au XVIIIe siècle le grand défi des Européens – et voilà que des carrières de kaolin sont découvertes en Saxe, près de Meissen, qui vont assurer la célébrité de la manufacture royale sous le règne d’Auguste le Fort. Aux vases et cruches chinois destinés au marché européen ou ottoman répondent des statuettes de Bouddha venues de Meissen : curieusement, quand les échanges technologiques et artistiques sont réciproques, plus personne n’évoque l’appropriation culturelle.
La dernière salle de l’exposition présente un échantillon de sabres, d’épées et de fusils venus de la Salle d’armes et du Cabinet turc. À l’exception d’une lame japonaise, ces armes proviennent de l’Empire ottoman. Quelques prises de guerre et beaucoup d’achats et de cadeaux diplomatiques. La mode des turqueries avait en effet atteint Dresde, et Auguste le Fort organisa des fêtes sur des thèmes ottomans, allant jusqu’à se costumer en sultan. Si l’on en croit les cartels pédagogiques, comme cela relèverait de la diplomatie et du sens de la fête, ce ne serait pas aussi « affreux vilain méchant » que d’avoir collectionné dans un but ethnologique des massues à tête d’assiette des Tupinambas brésiliens, allez comprendre pourquoi…
Cédant à un déplorable effet de mode, l’exposition regroupe les objets selon des thématiques qui invitent insidieusement à une lecture idéologique bien conforme – d’autant plus que chaque thème donne lieu à l’intervention d’un artiste contemporain, avec le laïus 100 % woke de rigueur. Pourquoi diantre devrions-nous aller, comme le précise en son jargon le communiqué de presse, à la « quête de réponses aux questions contemporaines relatives à la compréhension du monde » ? Ce qui nous intéresse, n’est-ce pas justement d’essayer de comprendre dans quel monde vivaient les princes électeurs de Saxe, d’Auguste Ier de Saxe (1526-1586) à Auguste le Fort (1670-1733) ? Pourquoi devoir en passer par une relecture woke qui voit partout « symboles de domination », « culture des stéréotypes », remise en question de « la conviction qu’avaient les Européens de leur supériorité culturelle » ? La moraline, meilleure médication contre une esthétique qui ne répond pas aux canons idéologiques de notre XXIe siècle ?
Les objets, présentés seuls ou par très petits groupes, souffrent un peu d’un isolement quasi hygiénique. Ce légitime souci de bonne gestion des foules, qui pourront mieux circuler devant chaque vitrine, efface l’effet de profusion baroque qui impressionne les visiteurs des musées de Dresde. Disons que ce sont des exempla, la quintessence des collections, et prenons le temps de les admirer. Nonobstant cette tendance au ridicule et le peu d’objets présentés, l’exposition permet de voir, ou de revoir, quelques chefs-d’œuvre et de nombreuses curiosités rarement exposés en France. Elle peut se visiter en famille, à la recherche des éléphants, des cornes de licorne et autres gardes d’épée en forme de dragon.
© Photo d’ouverture : Bézoard revêtu de filigrane d’or XVIe siècle or, pierre bézoard l. © Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden / Carlo Böttger