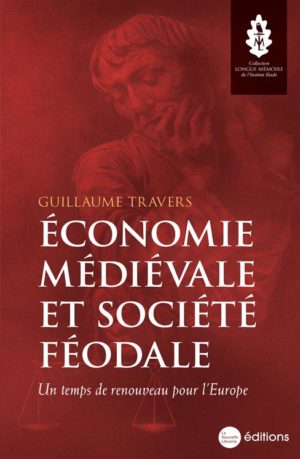FRONT POPULAIRE. Vous expliquez dans votre ouvrage que l’explosion du marché de la revente de cadeaux de noël est un bon exemple de la marchandisation du monde. En quoi cette démarche est-elle significative ?
GUILLAUME TRAVERS : C’est un exemple parmi des centaines d’autres, mais il est très significatif. Dans les sociétés prémodernes, la majorité des biens ne sont pas de pures marchandises, valorisées en fonction de l’offre et de la demande. La circulation des biens, les relations des hommes aux choses, sont entourées d’un grand nombre de rites, de symboles, qui donnent du sens aux échanges. Pour reprendre l’exemple ci-dessus, un cadeau de Noël n’était donc pas interchangeable avec d’autres. C’était un bien dont on gardait le souvenir qu’il avait été reçu de telle personne, dans telles ou telles circonstances, ce qui lui conférait un caractère qualitatif particulier, un sens. À l’heure de la revente des cadeaux de Noël, tout cela est terminé : le cadeau n’est plus qu’un bien, convertible en une quantité d’argent auprès de n’importe quel inconnu. Autrement dit, une marchandise. Les significations traditionnelles se sont évanouies. Ce processus de transformation du monde en marchandise, qui a affecté historiquement un grand nombre de biens, est au cœur du capitalisme : tout ne doit valoir qu’en fonction de l’offre et de la demande, en fonction du prix.
FRONT POPULAIRE. Vous considérez que le capitalisme a progressivement vampirisé tous les champs de la vie sociale. Diriez-vous que notre être social a été reprogrammé par la marchandise ? A cette aune, la gratuité est-elle est encore possible ?
GUILLAUME TRAVERS : La logique du capitalisme tend à tout transformer en marchandise, et à faire de tout homme un consommateur. C’est une tendance très lourde. Nombre de nos contemporains ne savent plus se comporter dans le monde que comme des consommateurs : vis-à-vis de toute chose, ils ne voient que leur utilité immédiate, leur petit plaisir, leur confort personnel. Mais cela ne veut pas dire qu’il soit impossible de résister à cette tendance. Tout d’abord, il y a, si l’on peut dire, une résistance inconsciente : l’homme a du mal à se satisfaire de n’être qu’un consommateur, il a besoin de donner du sens à sa vie. Dans le mal-être contemporain (la consommation de masse est aussi celle des antidépresseurs et autres gadgets pour passer les névroses), il y a avant tout une quête de sens. Ensuite, il y a évidemment la résistance active à la consommation, qui passe par une éthique personnelle : nous pouvons tous faire le choix de n’être pas des consommateurs passifs, mais de donner du sens à nos actes, de renouer avec des traditions, avec des usages communautaires qui relèvent du don. Donner, dans un sens traditionnel, c’est placer l’intérêt collectif avant son propre intérêt individuel. Ce choix appartient à chacun d’entre nous, tous les jours. Concrètement, il est possible de fabriquer certains cadeaux de Noël de ses mains, ou de se les procurer chez un artisan traditionnel, plutôt que d’acheter des biens standardisés dans une grande surface.
FRONT POPULAIRE. Vous vous appuyez sur l’analyse de l’économiste socialiste Karl Polanyi, lequel voit dans le capitalisme moderne un phénomène de « désencastrement » de l’économie par rapport au monde social. Est-ce à dire que l’économie s’est peu à peu autonomisée ?
GUILLAUME TRAVERS : Oui, la thèse de Polanyi sur le « désencastrement » me semble très juste. Dans les sociétés précapitalistes (en gros, jusqu’au XVIIIe siècle), il n’y avait pas de « sphère économique » distincte d’une « sphère » sociale, politique ou religieuse. Un exemple permet de l’illustrer : le travail n’était pas régulé de manière générale par un « marché du travail » sur lequel se forme un prix (le salaire). Au contraire, l’organisation du travail était régulée par les corporations, qui jouaient certes un rôle économique (restrictions de la concurrence), mais aussi politique (représentation au sein des communes), religieux (célébrations d’un saint patron), et qui étaient des communautés de vie quotidienne. Depuis, l’économie a acquis une autonomie considérable.
FRONT POPULAIRE. Pourquoi voyez-vous dans l’avènement de la « société anonyme » un exemple emblématique, bien que souterrain, de l’abstraction du capitalisme contemporain ?
GUILLAUME TRAVERS : Dans « capitalisme », il y a « capital ». On ne peut pas pleinement comprendre l’un sans l’autre. Dans un sens très large, toute activité économique a toujours requis du « capital », à savoir un apport en argent ou en autres biens. Mais traditionnellement, jusqu’au XIXe siècle (sauf quelques exceptions), une personne qui investissait dans une entreprise s’engageait très fortement vis-à-vis de cette entreprise, mettait sa réputation en jeu et s’impliquait dans sa gestion. Il existait donc des capitaux (provenant de millions d’épargnants), mais rien de tel que « le » capital, entendu comme totalité abstraite. Avec la généralisation de la société anonyme, au milieu du XIXe siècle, les choses changent radicalement : il devient possible pour tout le monde d’investir dans toute entreprise, même sans rien y connaître. Un investisseur se contente d’apporter des fonds, sans rien d’autre ; son identité peut changer sans arrêt, et il est en cela « anonyme ». C’est une révolution considérable : l’épargnant anonyme ne juge un investissement qu’en vertu de son rendement (quantitatif), là où l’épargnant traditionnel avait toujours une contribution qualitative. Cela a été un accélérateur du processus de marchandisation évoqué plus haut : l’épargnant anonyme ne voit le monde que sous le prisme d’un chiffre, le taux de rendement.
FRONT POPULAIRE. Vous montrez que l’individu abstrait issu des Lumières – sans attaches, libre de ses propres déterminations – a été laissé seul face au marché, face à la technique et la publicité qui ont peu à peu rempli le vide laissé par les anciennes verticalités. Faut-il pour autant prêcher pour un retour aux communautés intégrées ?
GUILLAUME TRAVERS : Il me semble évident qu’il y a aujourd’hui des aspirations de plus en plus vives à recréer des communautés. L’absence de communautés organiques fortes est la source du malaise identitaire. Ceci dit, il est absurde d’espérer un retour pur et simple au passé ; ce qui me semble souhaitable est de s’inspirer des idéaux communautaires passés pour construire des modèles alternatifs au seul marché. Ce que l’on nomme localisme, circuits courts, permaculture, etc. obéit tout à fait à cette logique : à chaque fois, il s’agit de rendre de petites entités politiques relativement autonomes, enracinées dans un substrat naturel et culturel.
FRONT POPULAIRE. Vous expliquez qu’on ne peut pas être anticapitaliste et « progressiste ». Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Vous voulez dire que quiconque valide les présupposés de la modernité doit composer avec le capitalisme qui en est l’émanation ?
GUILLAUME TRAVERS : Le cœur du capitalisme, c’est l’individualisme, c’est-à-dire l’idée selon laquelle l’individu est antérieur à toute appartenance familiale, communautaire, civilisationnelle, etc. Dire que l’homme est avant tout un individu, c’est in fine réduire la valeur de toute chose au jugement des individus, donc au jeu de l’offre et de la demande. L’individualisme mène tout droit à la marchandisation. Il est donc absurde de chérir l’individualisme, les droits absolus de l’individu, tout en condamnant le capitalisme. Ce qui a toujours fait obstacle au capitalisme a au contraire été les institutions traditionnelles. En s’attaquant à celles-ci, nombre de ceux qui se veulent « anticapitalistes » sont en fait les meilleurs alliés du capitalisme. Un exemple ? Tant que les écoliers portaient l’uniforme, il n’existait pas ou presque de marché pour les vêtements de marque à destination des enfants. En mettant fin à cet héritage traditionnel au nom d’une « liberté individuelle » supposée, on a fait des enfants les jouets des marques et de la publicité.