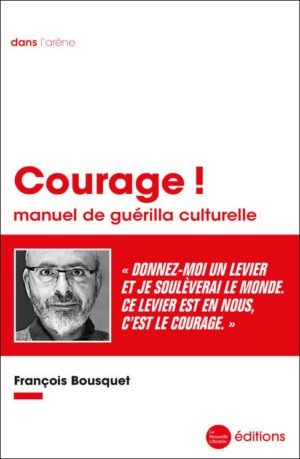Si la comtesse Sofia Andreïevna Tolstoï n’avait pas épousé son Léon de mari, elle aurait sûrement gagné la fosse commune de l’histoire, là où la plupart d’entre nous finiront. C’eût été dommage. Voilà un écrivain. En témoigne son autobiographie fleuve, Ma Vie. Hegel disait qu’il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Ça vaut aussi pour les épouses. La preuve par celle de Tolstoï. C’est la petite souris qui se glisse sous la table et voit tout. Elle connaît son mari à l’endroit, à l’envers et de travers. On lui pardonnera. Il était insupportable. Elle aussi. Un couple parfaitement assorti. Ils finiront par se haïr. Une histoire somme toute banale, qui se réglerait aujourd’hui devant le juge aux affaires familiales. Espèce alors inconnue. On ne s’en plaindra pas. Ça nous vaut ces deux livres stupéfiants, le Journal de Tolstoï (trois volumes en « Pléiade ») et Ma Vie de Sofia. Mille trois cents pages où se répartissent à parts égales les moments d’attendrissement, d’exaspération et de répulsion.
Sofia lisait le journal de son mari, qui lisait le sien, si bien que ce dernier a fini par tenir un journal parallèle, en secret. Trop de haines recuites et bouillies dans l’intimité de la chambre à coucher. Cette chambre à coucher, où le soir venu, Monsieur le comte honorait la comtesse comme un animal en rut, tout en se déshonorant au regard de ses principes puritains, avant de se couvrir de honte dans son Journal. Un cas d’école de dédoublement clinique. Comme le note Dominique Fernandez dans son « Tolstoï », l’auteur de La Sonate à Kreutzer ne voyait même pas dans la sexualité une sorte de viol, non, c’était un crime à ses yeux. L’homme dépèce littéralement la femme, le prédateur sexuel consomme sa proie. Et Dieu sait si des proies, notre prédateur en a consommé, de la tsigane volage à la paysanne peu farouche. Que restait-il alors à Sofia ? Le venin de la jalousie. Elle n’en fut pas économe. Tolstoï en fit les frais. Doublement. Car Sofia lui répondit aussi sous la forme d’un texte romancé, À qui la faute ?
Le pouvoir aux moujiks et les femmes sur le bûcher
Il y a toujours une part de comédie chez le grand homme, celle-là même que débusquent en premier le valet de chambre et l’épouse. Comment vivre au quotidien à côté de la statue de bronze suscitée par l’admiration des disciples, les tolstoïens ? Sofia s’est donc prise de jalousie pour tous ces importuns qui venaient lui voler son mari. Ils le lui voleront si bien que Tolstoï lui interdira, à elle et elle seule, la porte de sa chambre de mourant dans la gare d’Astapovo. L’humiliation absolue. Quarante-huit ans de vie commune, seize grossesses, treize enfants, une vie de dévouement, et finir comme ça, abandonnée par son mari, comme la dernière des étrangères. Pauvre Sofia, hystérique, mais on le serait à moins, hypocondriaque et chichiteuse, elle qui avait le tort d’incarner aux yeux de Tolstoï l’égoïsme sacré de la famille. Pas celui de l’humanité et des nuées. Ces nuées qui rendaient malade Sofia. Car elle n’a rien compris à la conversion de son mari. Comment aurait-elle pu ? Il y a quelque chose de désespérément ennuyeux dans ce sermon en noir et blanc qui occupe le dernier tiers de la vie de Tolstoï. C’est Savonarole, non plus sous les Borgia et les Médicis, mais sous les Nicolas et les Alexandre. Le pouvoir aux moujiks et les femmes sur le bûcher, Madame la comtesse en tête. Ma vie, le vrai roman des Tolstoï, vient réparer une injustice et tirer Sofia de l’oubli. En toute justice.
Vie, mort et résurrection de Léon Tolstoï (1/3)
Les terreurs « rouges, blanches, carrées » de Tolstoï (2/3)