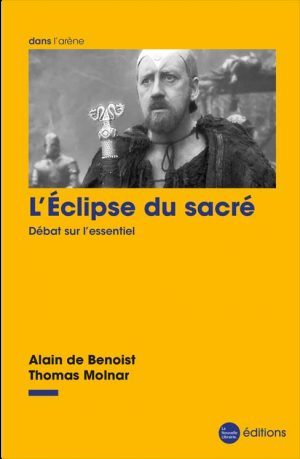ÉLEMENTS : Dans votre avant-propos, vous rappelez que Thomas Molnar avait « eu la joie » de retrouver sa véritable patrie qu’était la Hongrie. La patrie prise dans son acception de terre des pères, celle où les hommes prennent leur force comme le titan Antée que vous mentionnez. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce lien, qui semble à vos yeux capital pour l’homme, entre l’attachement terrien au sein d’une communauté et le sacré ?
ALAIN DE BENOIST. Le lieu fait lien, c’est bien connu. Et ce lien est d’autant plus fort que le lieu renvoie à un paysage familier ou à une terre natale. C’est ce que j’ai voulu dire en évoquant le retour en Hongrie de mon ami Thomas Molnar après plusieurs décennies d’« exil » aux États-Unis d’Amérique. La civilisation occidentale est par ailleurs une civilisation de l’espace plus qu’une civilisation du temps : c’est si vrai que nous parlons d’un « espace de temps ! » Mais elle est aussi une civilisation où la vue est plus importante que l’écoute. Le mot grec pour « idole » est éidôlon, qui signifie exactement « ce qui se donne à voir ». Carl Schmitt, enfin, a bien montré que l’homme est avant tout un terrien. C’est pour cela que notre planète s’appelle la Terre, et non pas la Mer, alors que les mers et les océans occupent la plus grande partie de sa surface.
ÉLEMENTS : À de nombreuses reprises vous fustigez les droits de l’homme, le mythe du progrès, la doctrine de l’unité de l’humanité, l’arraisonnement technicien ou encore le choix de l’égalité comme boussole de la justice. Or, ce processus, moteur selon vous de la modernité, vous le faites remonter directement aux sources du christianisme. Pourquoi cela ?
ALAIN DE BENOIST. Vaste question, à laquelle je réponds en détail dans L’éclipse du sacré. Mais essayons d’aller à l’essentiel au risque de paraître sommaire. La doctrine de l’unité de l’humanité est impliquée par le monothéisme : s’il n’y a qu’un Dieu unique, et que tous les hommes sont appelés à l’adorer, il faut qu’ils ne forment qu’une grande famille et qu’ils soient égaux au regard de Dieu. Le peuple de Dieu, en d’autres termes, ne connaît pas de frontières. C’est ce que dit saint Paul dans un passage bien connu de l’épître aux Galates : « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ » (Ga 3, 28).
L’idéologie des droits de l’homme résulte de la substitution du droit naturel moderne au droit naturel des Anciens, qui était totalement différent. Ce dernier était extérieur aux individus et visait à établir objectivement un rapport d’équité fondé sur la claire perception de ce qui doit revenir à chacun. Le premier se construit sur l’idée que les individus détiennent des droits subjectifs, inhérents à leur nature au seul motif qu’ils sont des hommes possédant tous dès le départ la même dignité.
L’idéologie du progrès est une simple sécularisation de la conception biblique de l’histoire, qui la conçoit de manière linéaire, vectorielle, avec un début absolu (le Jardin d’Eden) et une fin absolue (la Parousie). C’est une histoire orientée dans une direction nécessaire, pourvue d’un sens et intéressant l’humanité tout entière. On en trouve déjà les rudiments chez saint Augustin.
Enfin, l’arraisonnement technicien est la conséquence naturelle de la désacralisation du monde, de son « désenchantement » (Entzauberung), disait Max Weber, qui a conduit à considérer le monde comme une simple objet dont l’homme serait le sujet. La désacralisation consiste à vider le monde de sa dimension de sacré : il n’y a plus de lieux sacrés, de sources sacrées, de forêts sacrées, etc. Il n’y a plus désormais que du « saint » : le Saint des Saints, le Saint-Père, l’histoire sainte, la Ville sainte… Le saint est une notion morale, le sacré ne l’est pas. C’est parce que le monde a été vidé de sa dimension de sacré que l’homme a pu s’en proclamer le propriétaire et le maître souverain. La technique moderne poursuit et achève le processus : la « faisance » (Machenschaft) permet la soumission générale du monde au principe de calcul et au principe de raison (Gestell). Comme le dit Heidegger, la technique n’est en fin de compte qu’une métaphysique réalisée.
ÉLEMENTS : Une chose nous marque aussi à la lecture de ce livre, c’est la préoccupation conjointe de vous deux pour le sort du « Tiers monde ». Possible vivier du retour à une tradition perdue pour nos terres « froides » en relations humaines et « saccagées » par le prométhéisme technicien ; le « Tiers monde » pourrait se faire l’électrochoc capable de réanimer un corps – en l’occurrence le corps occidental – inanimé. Quelles seraient vos positions, à ce jour, vis-à-vis de ces relations ? Pensez-vous qu’il faille nécessairement que les Européens se tournent vers l’extérieur afin de rallumer la flamme du sacré ?
ALAIN DE BENOIST. Je ne crois pas avoir jamais écrit que le Tiers monde pourrait « réanimer le corps occidental » ! J’ai simplement voulu rappeler que toutes les sociétés ont d’abord été des sociétés traditionnelles. La nôtre a quasiment cessé de l’être à l’issue du long processus de mise en place de la modernité. Dans le Tiers monde, il subsiste en revanche des sociétés qui ont conservé de nombreux traits traditionnels, notamment dans les rapports sociaux. On le voit bien quand on se promène un peu au Proche-Orient. Il ne faut bien sûr pas idéaliser, car ce sont aussi des sociétés qui sont aujourd’hui confrontées à une modernité qui séduit autant qu’elle révulse. Il reste que cette permanence est une bonne chose. Elle montre que les sociétés existant aujourd’hui dans le monde ne sont « contemporaines » qu’en apparence. Nous pouvons avoir des ennemis dans le Tiers monde, mais le Tiers monde en tant que tel n’est pas un ennemi. Cela dit, j’admets bien sûr que ces considérations intéressent surtout les ethnographes, et que n’est pas en se tournant vers l’extérieur que les Européens pourront « ranimer la flamme du sacré ». Il n’en reste pas moins que bien des sociétés non européennes témoignent en quelque sorte de ce que nous avons été.
ÉLEMENTS : La constatation du cataclysme que représente la société industrielle pour les communautés humaines est une chose partagée par vous et Molnar. Chez vous, cette critique s’approfondit d’une dimension heideggérienne comme si vous aviez décidé de « marcher dans les pas », comme le disait Paul Celan, du philosophe allemand. Considérez-vous Heidegger comme la porte de sortie salutaire à une philosophie nietzschéenne dorénavant incapable de saisir notre époque dans sa totalité ?
ALAIN DE BENOIST. J’avais commencé à lire sérieusement Heidegger lorsque j’ai rédigé L’éclipse du sacré, ce qui n’était pas le cas lorsque j’écrivais Comment peut-on être païen ? Je pense en effet que Heidegger est beaucoup plus important que Nietzsche – ce qui ne veut évidemment pas dire qu’il ne faille pas fréquenter la pensée de ce dernier ! Mais Heidegger va plus loin. L’explication qu’il donne de l’ensemble de l’histoire de la pensée occidentale, la distinction décisive qu’il établit entre l’ontologie et la métaphysique, l’Être et l’étant, est à mes yeux sans équivalent, y compris pour comprendre ce qui se déroule sous nos yeux.
ÉLEMENTS : Dans ce texte, vous affirmez que « les dieux à venir ne sont pas encore nés ». À cette absence, il paraît se dessiner dans votre pensée une solution tierce. Je m’explique. Louis Jouvet, lors d’une tournée en Amérique du Sud, expliquait que c’était sa rencontre avec un jeune homme qui lui avait permis de trouver sa définition du théâtre. En effet, bien que ne comprenant pas un mot de français, le jeune homme affirmait venir à toutes les représentations de la troupe. Devant cette bizarrerie, Jouvet lui demanda la raison de cette obstination. À cette question, le jeune homme répliqua qu’il allait tous les dimanches à la messe pour « sentir » même s’il ne comprenait pas un seul mot de latin. Cette notion du « sentir » devint le point de bascule qui permit à Jouvet de saisir l’essence de son art. Chez vous, point de volonté d’attendre une révélation ou une confirmation extérieure. Et encore moins celle de bâtir une nouvelle Église ou d’édicter un dogme inédit. Au contraire de ces deux solutions, vous semblez plutôt postuler cette solution de la sensation, ou même de la perception, que l’homme pourrait retrouver grâce à sa communion au sein d’un peuple ancré, d’une terre habitée, de rites reçus des ancêtres et par un émerveillement face au mystère de l’être. Concernant le cas des futurs peuples européens, serait-ce cette voie que vous privilégierez pour une régénérescence du sacré ?
ALAIN DE BENOIST. L’idée que « les anciens dieux sont morts tandis que les dieux à venir ne sont pas encore nés » se retrouve chez Ernst Jünger, selon qui nous vivons aujourd’hui sous la domination des Titans. Vous connaissez en outre l’énigmatique propos de Heidegger selon lequel « seul un dieu peut nous sauver ». Nous vivons aujourd’hui dans une époque de transition – un « entre-deux » – où la disparition du sacré est particulièrement frappante. Comment y remédier ? Il n’y a malheureusement pas de recette toute faite ! Le problème majeur est que cela ne dépend pas seulement de nous. Le volontarisme a ses limites, surtout dans ce domaine, et il ne suffit pas de bâtir un temple pour voir les dieux s’y installer. N’oubliez pas non plus que le sacré implique une cité, c’est-à-dire une dimension collective. Dans l’immédiat, tout me paraît être affaire de disposition d’esprit et de travail sur soi. Le contraire du sacré, c’est le profane. Nous vivons dans un monde totalement profane (et profané). Comment les Anciens vivaient-ils dans un monde où il y avait encore du sacré ? Qu’avaient-ils que nous avons perdu ? Par quoi se manifeste l’appétence au sacré, l’ouverture au sacré, la disponibilité au sacré ? Répondre sérieusement à ces questions prend forcément du temps. Sinon, on retombe dans le spectacle ou dans le simulacre.
Propos recueillis par Rodolphe Cart
Photo : Alain de Benoist, de profil, Dominique Venner et Thomas Molnar, le 12 janvier 1973, à Turin, lors d’un grand colloque organisé par le Congrès international pour la défense de la culture (CIDAS).