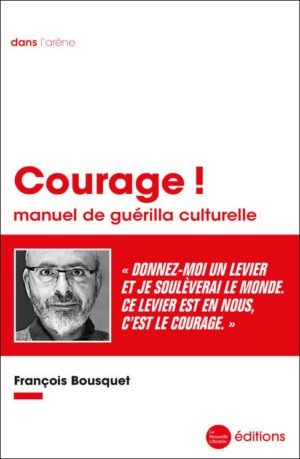Jean Baudrillard disait de la démocratie que c’est la ménopause des sociétés occidentales. Je ne sais pourquoi, cette remarque me fait penser aux livres d’Annie Ernaux, la nouvelle coqueluche de la gauche, nobélisée à 82 ans pour une œuvre aussi épaisse qu’un tract féministe. Par le passé, le prix Nobel a souvent récompensé des écrivains de troisième catégorie, à commencer par Sully Prudhomme, poète du genre onctueux, premier Nobel de littérature, ayant étrenné la longue liste d’auteurs français lauréats du prix, tous mâles. Manquait au tableau une femme : la suffragette tricolore. Prénom : Annie ; nom : Ernaux.
Le propre du comité suédois, c’est d’être en parfaite adéquation trigonométrique avec l’esprit du temps, comme un baromètre qui mesurerait avec une rigueur nordique et luthérienne la pression atmosphérique. Cette année, le fond de l’air est chiant, féministe et bégueule. Le portrait craché d’Annie Ernaux, joli brin de femme au demeurant, fort bien conservée en dépit des flétrissures du temps, à part les lèvres dédaigneuses qui ont longtemps recueilli le fruit vénéneux d’une amertume qui n’a plus lieu d’être.
Une purge et une punition
Annie Ernaux mérite notre reconnaissance. C’est le sédatif et le laxatif le plus puissant de la littérature contemporaine. La lire, c’est faire l’expérience d’un voyage au bout de l’ennui jusqu’à Cergy-Pontoise, ville nouvelle pompidolienne où elle s’est installée il y a des lustres en vigie du progressisme. Le rythme de sa prose rappelle aux plus vieux d’entre nous le balancement lancinant des tortillards de banlieue du temps naguère qui donnaient le mal de mer et prédisposaient à la somnolence du voyageur.
Faites-en l’expérience. Commencez la lecture d’un de ses livres dans le bas-ventre de Paris, comme l’appelle le diable en personne, Richard Millet, par exemple sur le quai du RER A à Châtelet-Les Halles ; et terminez-le en gare de Cergy, dans ce Luna Park universitaire prématurément vieilli qu’Annie met un point d’honneur à ne pas quitter. Vous sortirez de l’expérience exsangue. Si Cergy-Pontoise est une ville-dortoir, Annie Ernaux en est la traduction pharmaceutique, j’ai nommé : son somnifère, plus littéral que littéraire, cela va de soi.
Cergy-Pontoise, c’est pour elle le centre du monde. Elle en arpente depuis 40 ans les allées, les rues piétonnes, les bosquets entre deux plans d’eau, les commerces, dont l’hypermarché Auchan, qu’elle décrit avec l’entrain d’un huissier de justice débutant et l’application d’un chef de rayon d’Auchan tenant à jour son inventaire. Annie a toujours fait des listes. C’est son truc, les listes. Elle en a même dressé une en 2012 pour envoyer à l’échafaud Richard Millet qui venait de sortir son Éloge littéraire d’Anders Breivik chez Pierre-Guillaume de Roux, précédé de sa magnifique Langue fantôme. Comme au bon vieux temps de l’Union des écrivains soviétiques, elle a lancé une pétition dans Le Monde contre ce « pamphlet fasciste ». 128 chiens et chiennes de garde s’empressèrent de la signer, des caniches et des chihuahuas de la pire espèce qui sont venus à bout du lion rugissant. Liste Otto en 1940, liste Ernaux en 2012. D’une occupation à l’autre.
Cosette n’est pas Colette
Au pays de Stieg Larsson et de sa saga antifa Millénium, le Nobel ne pouvait qu’échoir à Annie Ernaux. Mais s’il fallait à tout prendre lui remettre un prix sur la base de ses seules qualités littéraires, ce serait plutôt celui du syndicat des tricoteuses de Normandie ou celui des fabricants de bonnets de nuit d’Yvetot, en Seine-Maritime, où elle est née il y a 82 ans, dans le café-épicerie familial, où commence son roman des origines – noir, cruel, terriblement injuste. Depuis, elle nous joue en alternance les malheurs de Calimero et les malheurs de Cosette. Or voilà que Cosette est élevée par la critique au rang de Colette, alors qu’elle se contente d’écrire avec sa brosse à cheveux des bluettes féministes qui retracent des vies maussades guettées par la dépression et le ressentiment.
On a l’impression de parcourir une de ces lettres d’auditrice que Menie Grégoire lisait sur les ondes de RTL dans les années 1970. Vous vous rappelez : le cultissime « Allô, Menie ! » Le courrier du cœur radiophonique. Tout y passait : les hommes qui ne comprennent rien aux femmes, les rêveries sentimentales, le sort injuste. Menie Grégoire et Annie Ernaux, c’est la voix off du bovarysme sentimental à l’âge des foules féministes. Une exégèse exhaustive des lieux communs, mais pas au sens où Léon Bloy l’entendait, comme un monument de bêtise. Non ! Chez Annie Ernaux, c’est un monument de dévotion néo-sulpicienne et de bien-pensance gauchiste. Car entre Menie Grégoire et elle, est venu se glisser la sociologie de Pierre Bourdieu : le misérabilisme savant accouplé à l’esprit de lourdeur sociologique. Annie Ernaux, c’est le courrier du cœur de Menie Grégoire dans le format d’un cours de socio à la faculté de Jussieu. Nulle littérature ici. Degré zéro du style, le prix Nobel 2022 revendique une écriture plate, indigente, atone, qui ne fait que retranscrire la banalité du quotidien d’une féministe sans jamais la transfigurer, comme la bouleversante Virginia Woolf a su le faire.
Osez le misérabilisme
Le mariage ou l’avortement, c’est ainsi qu’elle résumait le dilemme des jeunes filles au seuil des années 1960. Elle aura expérimenté les deux, sans rien nous épargner de son martyre. Son CV est un chemin de croix dont elle égrène les stations en gémissant. Il y avait jadis la figure de la Mater dolorosa chrétienne ; aujourd’hui, c’est le #MeToo dolorosa et ses glandes lacrymales hypertrophiées. La vie des femmes est une vallée de larmes. Annie les essuie.
La victimologie est un métier. Pleurer aussi. C’est même l’un des plus vieux métiers du monde, à en croire les découvertes des archéologues qui ont mis en évidence des pleureuses sur les bas-reliefs égyptiens. La déesse Isis elle-même est parfois représentée en pleureuse. Les riches familles payaient des pleureuses à gages pour feindre le chagrin, aussi bien chez les pharaons qu’en Mésopotamie. À Rome, il y avait un chœur de pleureuses avec à sa tête une meneuse qui entonnait les lamentations en se frappant la poitrine. Le deuil n’en était que plus théâtral, sonore, démonstratif. Les dernières pleureuses ont logiquement disparu quand les féministes sont apparues, dans les années 1960. Annie en est l’héritière. Sa littérature, qui se présente à la manière d’un dépliant électoral, n’est pas engagée, mais encartée. À LFI, pour être précis.
Quand les dames patronnesses lisent Télérama
Ses livres sont comme la preuve empirique de l’incapacité des concepts sociologiques à se transformer en littérature. Annie a beau les mettre en musique, ils restent désespérément monocordes. Si Pierre Bourdieu lui a procuré le mode d’emploi de sa vision du monde, c’est Didier Eribon, autre sociologue, qui lui a fourni ses papiers d’identité en faisant d’elle une « transfuge de classe ». Un transfuge de classe, c’est quelqu’un d’un peu plouc qui parvient à devenir très chic. Un nouveau riche au fond, comme Annie Ernaux. Elle qui appartient à la gauche caviar nous rappelle en permanence que, dans son enfance malheureuse, elle ne mangeait que des bouts de morue, poisson du pauvre. Tout transfuge de classe est condamné à contrefaire sa culture d’origine et à se spécialiser dans le nombrilisme sociologique.
Une remarque pour finir. La sociologie bourdieusienne est la continuation de l’œuvre des dames patronnesses d’antan, qui ont été les premiers travailleurs sociaux. Annie Ernaux est une dame patronnesse. Elle veut restituer le quotidien du peuple, alors qu’elle en a perdu la trace depuis un bon demi-siècle. Jamais elle ne trouve la bonne distance. Son indignation est celle d’une lectrice de Télérama déambulant dans un musée Grévin du monde ouvrier où aucune pièce n’est d’origine. Pourquoi y a-t-il des dominés ? Pourquoi y a-t-il des salauds de droite ? Pourquoi les catégories populaires ont-elles préféré Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon ? On tremble devant d’aussi insondables questionnements qui ringardisent les interrogations de Platon, de Pascal et de Leibniz ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, hein ? Pourquoi y a-t-il rien plutôt qu’Annie Ernaux, hein ? Pourquoi y a-t-il Annie Ernaux plutôt que la littérature, hein ? Vertigineux, n’est-ce pas !