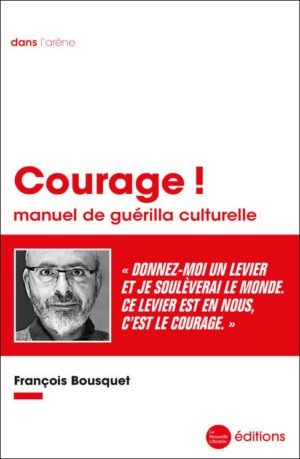Polémiquer, c’est d’abord une question de tempérament. On aime ou on n’aime pas, un peu comme les liqueurs amères, les sports extrêmes et les exécutions capitales. Dans sa Monographie de la presse parisienne, Balzac dit de la polémique qu’elle « est le sarcasme à l’état de boulet de canon ».
Le polémiste est le soldat de la littérature. Il n’est pas venu apporter la paix, mais l’épée, conforté en cela par l’étymologie : du grec polemos, la « guerre ». Cavalier, artilleur et plus souvent franc-tireur, c’est un spécialiste de l’escarmouche et de la guerre-éclair. David terrassant Goliath dans un corps à corps homérique ou l’abattant froidement comme un sniper. « Dans le pamphlétaire de bon aloi, assurait Léon Daudet, il y a du chien dressé à sauter à la gorge du faux. »
Un bon polémiste ignore l’art de la nuance. C’est un maximaliste déchaîné. Tout ou rien. Il tire orgueil de son mépris des convenances et s’enorgueillit de sa seule maîtrise de la grammaire et de la balistique.
« La couille lui manque, il n’a jamais pissé que de l’eau claire »
N’en déplaise à Péguy, trop preux chevalier en ces matières, qui voulait qu’on dise « bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste », le polémiste grossit, déforme, amplifie. S’il dit, pour sûr, la vérité, il choisit toujours de la dire de façon piquante et outrancière, en l’assortissant de formules assassines, de celles qui relèvent les plats et laisse des cicatrices profondes.
Athènes et Rome ne manquaient pas de ces rudes guerriers qui envoyaient ad patres leurs adversaires, des Philippiques de Démosthène aux Catilinaires de Cicéron. Satiristes, libellistes, publicistes, les meilleurs d’entre eux ont traversé le temps. Juvénal, le grand Rabelais, les si curieux Ligueurs de la Satire Ménippée qui haïssaient encore plus la couronne espagnole que la Réforme, les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné. Et que dire des mazarinades qu’on placardait un peu partout, de Pascal détroussant les jésuites ou des épigrammes salées de Voltaire. Et Saint-Simon ? Qui a égalé le duc dans le portrait-charge ?
Le lecteur n’a ici que l’embarras du choix, car il y a encore dans la masse d’écrits polémiques les journaux, mémoires et autres correspondances d’écrivains, inépuisable coulée de fiel mélangée d’un peu d’arsenic. Le Journal des frères Goncourt, de Jules Renard, de Léon Bloy, de Léautaud, les souvenirs de Léon Daudet, la correspondance de Flaubert. De Théophile Gautier, les Goncourt disaient que c’est « une intelligence échouée dans un tonneau de matière, une lassitude d’hippopotame ». Quant au verbe de Zola (ou ce qui en tenait lieu), il faisait sur Bloy un effet pareil à « la masturbation d’un cadavre ». Et le pauvre Lamartine étrillé par l’ermite de Croisset : « C’est un esprit eunuque, la couille lui manque, il n’a jamais pissé que de l’eau claire ».
Ah, l’infini de la Bêtise
« Il n’y a de vraies haines que les haines littéraires. Les haines politiques ne sont rien », lâchait, plein de dépit, Victor Hugo, vieux lion raillé par ses confrères. Le critique Sainte-Beuve, unanimement rebaptisé Sainte-Bave, brouillé à mort avec l’exilé de Guernesey, voyait en lui un « grand tapageur pindarique » et les Goncourt lui trouvaient une allure de « saint Jean dans l’île du Pathos ».
Le XIXe siècle est sans conteste l’âge d’or de la polémique. Il y a des polémistes avant, en abondance, mais ils ne constituent pas une famille en soi. Il y en a quelques-uns après, mais ce sont des orphelins et des parents pauvres. Au XIXe siècle, ils forment une redoutable armée de métier en butte aux pharisiens progressistes et aux bourgeois triomphants arborant fièrement cette « Bêtise au front de taureau » qui accablait tant Baudelaire et dans laquelle Renan voyait « la seule chose qui donne une idée de l’infini ».
En vérité, la parole pamphlétaire se glisse partout, elle n’a que faire des genres littéraires, elle emprunte tour à tour les voies du roman, de la poésie et de l’article. Tout lui est bon, le papier-bible et le papier journal, la prose, les vers et jusqu’au dessin de presse. Si l’habit fait souvent le moine, le genre ne fait jamais le pamphlet. C’est le style et lui seul qui lui donne son inimitable cachet. Sans grand style, pas de bonne polémique. Et quelle meilleure définition de l’art d’écrire que la leçon de français que nous a léguée Montaigne, ce « parler succulent et hardi tel sur le papier qu’à la bouche, non point tant délicat et peigné comme véhément et brusque… et que le Gascon y aille, si le Français n’y peut aller. »
La polémique, c’est l’alcool de la prose
Autre point : un bon polémiste fait toujours des personnalités, comme se plaisait à les appeler Péguy, sauf à considérer que les idées sont désincarnées et énoncées par des ectoplasmes. Léon Daudet formule ainsi la loi de l’éreintement : « Les polémiques ad principia ont leur autorité et leur prix. Mais elles ne deviennent percutantes qu’en s’incarnant, en devenant polémiques ad personnas, du moins quant aux vivants. »
Par définition et par nature, le polémiste se situe résolument dans l’opposition. Il n’est bon que dans le maniement du fouet, pas de l’encensoir. Qui fait l’ange fait la bête. Qui fait la louange devient bête. Il appartient à la minorité tapageuse ralliée à la majorité silencieuse. Son objectif : l’efficacité. Balzac disait de la Monarchie de Juillet qu’elle ne tiendrait pas contre trois pamphlets. Et Louis XVIII reconnut que le De Buonaparte et des Bourbons de Chateaubriand lui avait été « plus précieux que cent mille hommes ».
« Résumons-nous, concluait Léon Daudet : la polémique, c’est l’alcool de la prose. Sans elle, la prose s’étiolerait. » Et le lecteur bâillerait d’ennui.
Prochain épisode : Royauté de la droite, misère de la gauche (2/5)
Illustration : La bataille d’Hernani est le nom donné à la polémique et aux chahuts qui entourèrent en 1830 les représentations de la pièce Hernani, drame romantique de Victor Hugo.