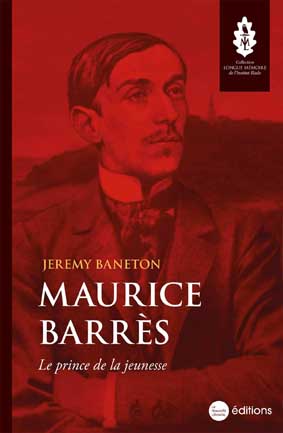« Le secret de notre dégoût est dans la niaiserie des buts proposés à notre activité. »
Si nous plaçons cette citation de Barrès en tête de cet article, c’est qu’elle semble résumer à elle seule la finalité de son œuvre : proposer un horizon nouveau à la jeunesse française. Celui qui fut romancier, journaliste, député et penseur politique, rassemble ainsi toutes ses facettes dans la volonté profonde d’éduquer la jeunesse, d’en renouveler l’esprit. « Rien de neuf sans des hommes nouveaux », écrit Barrès. Rien de neuf sans révolte de l’Esprit, sans révolte de la jeunesse contre une société étouffante.
Cette « atmosphère renouvelée », à l’apparition de laquelle il voue son œuvre, est le plus intime devoir « de toute jeunesse réellement soucieuse que l’histoire ne stationne pas ». La jeunesse est ainsi requise au combat contre les lois du ventre, de la matière, de la pesanteur, qui n’ont cessés d’embourber l’histoire, la Révolution et l’esprit révolutionnaire. En effet, 1789 était alors un idéal – peu importe qu’il soit ici jugé comme bon ou mauvais – qui énergisait les individus. Puis, sous l’effet de pesanteur, sous l’effet d’appauvrissement de l’esprit, de son remplacement par la matière, l’argent, l’usure et l’électoralisme, la Révolution devient une conservation de caste. Elle accouche d’un clan plus lourd encore que l’ancienne aristocratie : la classe des parlementaires.
Celle-ci incarne les maux de l’époque, de l’électoralisme à la corruption, de la bêtise à l’absence de morale, les parlementaires sont les ennemis à abattre que cible Barrès. Ils ont appauvri la France, l’ont jetée dans la décadence, ont déraciné et décérébré sa jeunesse. Tout est donc à refaire et il faut construire « cette éthique nouvelle » qui soit la première impulsion d’une génération ressaisie. La question est donc lancée : vers quel avenir se tourner ?
Le premier problème barrésien est, comme l’a d’ailleurs si bien compris son disciple, disciple critique, Drieu La Rochelle, celui du mouvement, du renouvellement, du réveil de la France. Pointons ici le rôle qu’eu la défaite de 1870 dans la prise de conscience de Barrès. Cette débâcle, ainsi que l’écrivait déjà Renan1, est symptomatique d’un affaiblissement de la vitalité française. La France n’était alors plus infusée par un idéal – thème qui tient une grande place dans l’œuvre de Barrès – et n’ayant plus d’idée directrice, de mythe dirait Sorel, elle se laisse aller au matérialisme et se rend incapable de répondre avec énergie aux événements. Incapable de motiver les forces de son peuple, la France perd sa substance vitale, son pilier intégrateur qui, comme un axe, incorporait les individus au projet national. Voilà l’émiettement dont parle abondamment Barrès.
Le déracinement comme maladie
Et puis voyons aussi que l’émiettement, c’est la fin de la liberté, de l’expansion des individus, des grandes personnalités. Ceux-ci, laissés pour compte, et ne trouvant dans la société aucun parti assez fort pour proposer une éthique commune, sont des déracinés. Le déracinement, plus qu’un problème politique, est également philosophique et religieux, il procède de la dissipation des familles morales du pays. Sans famille morale qui conditionne les individus à une tenue, à une manière d’être, ceux-ci courent ici ou là assoiffés, le désir gros et chargé sans jamais trouver de repos, de foyer spirituel. C’est la maladie des romantiques, maladie de la vie qui est ici pointée et dont Barrès a lui-même souffert. « Nihilisme douloureux », insatisfait et demandant plus au monde que les besoins du ventre. Au-dessus de lui, remettre l’esprit, c’est l’appel que lance le tout jeune Barrès.
Déracinés, décérébrés, sans énergie mais courant à la moindre doctrine en espérant y trouver un idéal, tel est l’état de la jeunesse que Barrès souhaite redresser. « Mais quel foyer saurait ranimer ces ardeurs endormies ? Quelle passion refera l’unité de ces énergies déliées ? À quel souci se dévouer et sur quelle idée se grouper ? » Si toute la question de son œuvre sera de revitaliser la France et sa jeunesse, cela passera nécessairement par une réflexion à trois focales, qui mêlera tour à tour la philosophie, la religion et la politique.
Ce triptyque barrésien était ainsi posé dès le tout début du Culte du Moi : « Toi seul, ô mon maître, m’ayant fortifié dans cette agitation souvent douloureuse d’où je t’implore, tu saurais m’en entretenir le bienfait, et je te supplie que par une suprême tutelle, tu me choisisses le sentier où s’accomplira ma destinée. Toi seul, ô maître, si tu existes quelque part, axiome, religion ou prince des hommes.2 » C’est tout un programme de renouvellement spirituel donc. Programme d’un enthousiaste réellement amoureux de la vie qui par insatisfaction se dresse contre l’ordre bourgeois qui l’appauvrit.
Cet amour, cette compréhension du fond spirituel qui gît en chaque chose, à la fois chant d’allégresse pour le Moi et ordre universel, entraîne Barrès à développer une pensée polyphonique. Comme Proudhon, Barrès pense les antinomies qui s’entremêlent chaque fois dans la vie. L’uniformité est ici rejetée au profit de la complexité des rapports entretenus entre les êtres, leurs sensibilités, leurs idéaux, la mort… Et si nous imaginions que ces antinomies ; individu-collectivité, liberté-autorité, christianisme-paganisme, sont des moments de flottement, de balancement et d’indécision, nous nous tromperons. C’est plutôt pluralité qu’il faut voir. Celle-ci reflète tantôt la vie du Moi et ses rapports à la collectivité, tantôt la vie nationale faite de régions, tantôt encore la vie religieuse pétrie de sensibilités enracinées. La pluralité, c’est l’ordre vital qui relance l’esprit.
***
1 – Axiome
« Il fallait exister d’abord et exister viable. »
Dans ce bel article dédié à Richard Wagner, Le regard sur la prairie, Barrès évoque son attachement à l’œuvre du compositeur allemand. Intérêt pour cet « effréné individualiste » venu de l’auteur tout jeune du Culte du Moi. Reconnaissance entre deux êtres qui partagent ce même goût de l’absolu, du sacrifice et de la régénération de l’homme par cette « éthique nouvelle » que Barrès préfigure lui aussi, comme Wagner, dans ses premiers romans. Une nouvelle religion y est née, Dieu est remplacé par le Moi : « Il ne faut pas subordonner notre propre nature à aucune autre. » Toutes les jouissances, les exigences extérieures, la masse des autres, la matière, l’argent, etc… doivent être sacrifiées au Moi. Est-ce cependant une nouvelle idole ? Est-ce du Moi des individualistes jouisseurs et anarchiques dont Barrès se ferait ici défenseur ? Non. Sans diminuer son idéal individualiste, la culture du Moi est une exigence : « Il ne faut point contenter nos aspirations avec aucun objet indigne. » Hauteur de vue et aristocratisme donc. Pour cette nouvelle religion, éloignement de la jouissance facile, mystique et exercices spirituels sont les valeurs que portent le Moi barrésien : « Le secret des forts, écrit-il, est de se contraindre sans répit. »
Mais pourquoi une telle insistance sur le Moi, pourquoi un choix si radicalement individualiste ? Les raisons ne sont pas anodines car elles sont profondément enracinées dans la compréhension philosophique de Barrès. Dans un chapitre célèbre des Déracinés, « L’arbre de Monsieur Taine », Barrès met en scène le philosophe, Taine, et un de ces jeunes lorrains partis à Paris, philosophe de nouvelle génération : Roemerspacher. Au vieux philosophe, qui l’interroge sur l’esprit de la jeunesse, le jeune homme répond que la grande affaire de l’époque de Taine, ce fut le passage de l’absolu au relatif. Entendons ici la mise à bas des grandes traditions – religieuse, politique, morale – et la projection des hommes dans la vie subjective. Et qu’en est-il donc de cette jeunesse ? A-t-elle réussi à vivre de ce relatif ? A-t-elle été victorieuse dans son subjectivisme ? S’est-elle passée de Dieu avec sourire et joie ? Est-ce que le matérialisme d’un Taine ou Renan, est-ce que la science et ses découvertes la dotèrent d’enthousiasmes assez forts pour qu’elle conduise avec bonheur sa vie ? Non. Tout le constat est là : il est difficile « de se passer d’un absolu moral ». Le siècle de Taine, le siècle de la science et de la raison n’a pas abouti à des « professions de foi décidées ». Plus encore, la raison appauvrit le cœur des individus et les a jetés dans ces fameuses « eaux glacées du calcul égoïstes ».
Le Moi ne suffit pas
C’est ainsi que le kantisme est fustigé. Philosophie de la Troisième République, il n’en est pas moins incapable de mythologie et de conduire la vie. Les parlementaires, les professeurs de philosophie – Bouteiller3 dans Les Déracinés – sont corrompus et tous attirés par un crasseux matérialisme, le justifiant par une idée abâtardie du devoir kantien. Bouteiller, de la belle loi philosophique, glisse à la compromission permanente. C’est tantôt le Panama, tantôt les partis et leur copinage de caste, tantôt les manipulations d’opinion et l’électoralisme qui font la seule morale des élites de la République.
Barrès, quant à lui, refuse cet ordre. Comme de nombreux jeunes gens, il sent profondément le manque d’un absolu moral. Mais ne pouvant se tourner vers la religion, n’en ressentant plus l’effectivité pratique, il cherche à joindre les exigences politiques et spirituelles dont il hérite : l’individu et la collectivité, la liberté et l’absolu.
Le Culte du Moi, l’individualisme, barrésien est donc tout à la fois méthode d’analyse et chemin vers des nouveaux horizons qui guideraient la sensibilité éthique et métaphysique des individus. Profession de foi d’un insatisfait, profession de foi d’un nouveau genre qui commence par une œuvre de révolté. Révolution d’un métaphysicien qui ne s’y retrouve plus dans les orgies philosophiques du xixe siècle, qui enquêtera sur les perspectives nouvelles à donner à l’individu, sur l’idéal à retrouver.
Il commence par bannir la raison, elle a trop pourri dans l’homme, et elle est jugée bien incapable de mythifier la sensibilité individuelle. L’intelligence, c’est en effet cette toute petite chose, cette chose qui n’est que surface. Or, lui, le révolté, appelle à plus d’infini, à une révolution spirituelle profonde : « Nulle réforme, écrit-il, n’y suffira qui sera une parole, une chose cérébrale. Seules nous mènent les vérités qui nous font pleurer. »
Le Moi trouve ainsi le chemin de la sensibilité, de la parfaite expression pure de son individualité. Il y ainsi le Moi et puis les autres, les autres ce sont les barbares. Ceux-ci ne comprennent rien au Moi, ils sont sourds, lourds, vulgaires. Le Moi est le civilisé. Le Moi s’élève, le barbare est le satisfait qui détruit et qui pèse. Le Moi a pour lui la discipline, le barbare la violence stérile. Mais le Moi est aussi celui qui manque d’énergie, celui qui n’a pas encore élevé assez haut son enthousiasme. Ainsi le barbare dépasse le Moi, par son caractère brut il est le plus vital et le plus élémentaire des êtres.
La race spirituelle des ancêtres
Cet espace de l’élémentaire, du mythe, de l’idéal, de l’enthousiasme, comme dirait Barrès, est à conquérir pour le Moi. Il lui faut cet enthousiasme qui jaillit de sa sensibilité afin de vivre mieux, de retrouver un sens à l’existence : « La vie est insupportable à qui n’a pas à toute heure sous la main un enthousiasme. » L’enthousiasme, chez Barrès, comme le mythe sorélien, unit les différentes facultés de l’âme en un tout et dirige la vie vers une unité plus grande et plus spirituelle. L’enthousiasme barrésien est la réponse au matérialisme nihiliste.
Et puis, voici que, comme de l’effusion spontanée du Moi revenu à l’élémentarité du sentiment, rejaillit la tradition. Ainsi qu’il l’écrit : « Un candidat au nihilisme poursuit son apprentissage, et, d’analyse en analyse, il éprouve le néant du Moi, jusqu’à prendre le sens social. La tradition retrouvée par l’analyse du moi, c’est la moralité que renfermait l’Homme libre, que Bourget réclamait et qu’allait prouver le Roman de l’Énergie nationale. » Articulant ainsi l’individu au collectif, Barrès retrouve du même coup l’harmonie entre quête de l’absolu et de liberté. Le Moi retourne au social, il y trouve la tradition de ses pères, s’en fait un socle libérateur et jaillit renouvelé par cette énergie chtonienne. L’enracinement vainc le nihilisme. La terre et les morts, la race spirituelle des ancêtres donne sens à la vie du Moi. Plus libre qu’avant car éloigné du matérialisme, profondément lui-même car tout entier pétri de sa sensibilité, héritée des actions passées qui le forgent, le Moi est tout entier lui-même et tout entier avec les autres, totalement libre et totalement enchaîné au tout. Il est un point qui se dessine sur l’axe du temps, il renouvelle en même temps, par sa propre force, l’énergie des actions passées. Bref, voici son socle et son enthousiasme qui lui sont donnés côte-à-côte.
Raciné de cette manière, le Moi n’est plus le déraciné qui se cherche une figure tutélaire, un héros à reconnaître pour s’échauffer soi-même. Ce n’est plus Napoléon qui le motive, quoiqu’il reconnaisse à cette figure sa capacité à cristalliser des énergies, mais sa tradition. Il a vaincu tour à tour le romantisme et le rationalisme, il les a dépassés par l’appel de la Terre et des Morts. Enraciné dans sa tradition, il sait ce qu’il doit être.
***
2 – Religion
« Il est des lieux où souffle l’esprit. »
Dans son œuvre, Barrès noue très intiment l’enracinement et la spiritualité, ce qui ne peut manquer de nous rappeler le culte romain des lares et des pénates. Ce culte du foyer4, dont la flamme perpétue l’existence des pères, dévoile si bien le lien qui existe entre racination et spiritualité. La prière est faite devant le foyer, et avoir un foyer, un feu sacré, c’est déjà prier. Le foyer, ce sont les pères, la tradition, la porte de l’esprit. Signalons ici le poète allemand Hebel5. Dans la lecture qu’en produit Heidegger, le poète est dit Ami de la maison – du foyer. Ainsi, cette poésie, par sa localité, redévoile pour l’homme, devenu sourd dans le siècle de l’uniformité et des machines, la nécessité spirituelle de l’enracinement. Le foyer est la voie vers ce qu’il a de plus essentiel. En retournant à la nature, l’homme retourne donc à l’esprit. Enraciné, il est spiritualisé. Le foyer est garant de la présence des dieux. Il recèle du trésor du monde spirituel, de l’humanitas authentique. Avoir un foyer, c’est communier avec l’Esprit.
Aussi Barrès ne peut-il plonger totalement et sans retenue dans le christianisme et son universalisme. Bien que celui-ci incarne l’ordre, l’auteur lorrain reste trop attaché à la polyphonie de la terre. Une terre qui, chaque fois, de ses régions, de ses multiples « collines de Sion » pousse des chants différents : « Il est de par le monde infiniment de ces points spirituels qui ne sont pas encore révélés, pareils à ces âmes voilées dont nul n’a reconnu la grandeur. Combien de fois, au hasard d’une heureuse et profonde journée, n’avons-nous pas rencontré la lisière d’un bois, un sommet, une source, une simple prairie, qui nous commandaient de taire nos pensées et d’écouter plus profond que notre cœur ! Silence ! Les dieux sont ici. »
Penché ainsi entre enracinement, paganisme et christianisme, Barrès balance l’universalité chrétienne par la cosmographie païenne. C’est la nature et l’amour chrétien qui sont joués sur la même partition de la foi du Moi. C’est ainsi que se conjuguent le double intérêt de Barrès pour une figure telle que Louis Ménard, ce dernier apôtre de l’hellénisme, un véritable païen mystique fondamentalement amoureux des dieux, et les prises de position barrésiennes en faveur de l’Église de France.
Le paganisme, comme loi de l’enracinement, c’est le terreau et la vitalité du Moi. Le christianisme, c’est la loi ordonnée du sentiment religieux. L’un rappelle la liberté et les volontés anarchiques de la vie, l’autre, l’ordre et le calme de la loi. Ces deux dimensions sont nécessaires à l’expérience du Moi. Toutes deux sont sa vitalité, son antinomie essentielle. C’est Jeanne d’Arc, si importante pour Barrès, qui, comme figure d’intercession religieuse, montre cette ambigüité entre paganisme et christianisme : « En Jeanne nous voyons agir, à son insu, les vieilles imaginations celtiques. Le paganisme supporte et entoure cette sainte chrétienne. La Pucelle honore les saints, mais d’instinct elle préfère ceux qui abritent sous leurs vocable les fontaines fées. Les diverses puissances religieuses éparses dans cette vallée meusienne, Jeanne les ramasse et les accorde, dût-elle en mourir par un effet de sa noblesse naturelle… Fontaines druidiques, ruines latines et vieilles églises romanes forment un concert. […] Autant que nous aurons un cœur celtique et chrétien, nous ne cesserons d’aimer cette fée dont nous avons fait une sainte. » Jeanne est l’union parfaite du christianisme et du paganisme. Elle sainte chrétienne mais toute pleine des sentiments de sa race. Jeanne d’Arc est une sainte rhénane, elle incarne tant l’attachement terrien que la bravoure et la dévotion chrétienne.
Citons aussi La colline inspirée. Ce roman est un drame qui dévoile le fond de l’interrogation barrésienne sur la terre et l’esprit. Celle-ci est la vitalité du cœur humain, elle est parcourue par les énergies cachées de la race, et, par-dessus elle, grandit la tranquillité sereine de Dieu. Partagé par ce dilemme entre paganisme et christianisme, Barrès clôt, par ce chef-d’œuvre romanesque, le développement entrepris des années plus tôt dans Le Culte du Moi. Ici, de retour au pays natal, le Moi apaise son agitation douloureuse et trouve la tutelle où s’accomplir dans la joie d’être d’un foyer. L’Esprit retrouvé par la terre dans le respect de la loi religieuse, c’est la leçon de la religion de Barrès. Un dynamisme permanent entre ces deux pôles : Prairie et Église.
***
3 – Prince des hommes
« Nous sommes le produit d’une collectivité qui parle en nous. Que l’influence des ancêtres soit permanente, et les fils seront énergiques et droits, la nation une. »
L’enracinement pose également la question des rapports qu’entretiennent le Moi et la collectivité, et plus généralement ceux de la liberté et de l’autorité. Ces deux antinomies sont au fondement de la pensée politique de Barrès. Suite à la Révolution, le Moi est séparé des structures traditionnelles et il court à sa perte sans ordre social. C’était la leçon d’Un homme libre : le Moi est un point sur la ligne infinie de l’action des ancêtres. Au plus intime de lui-même, il y a la collectivité. Or, où en est la société française au tournant de 1890 ? Barrès répond : émiettée.
La société n’a plus la force de générer un enthousiasme dans la jeune génération afin que ceux-ci s’y trouvent une place et répondent aux nécessités de leur Moi. La société est émiettée car elle est sans idéal. Toute la force révolutionnaire de Barrès réside dans ce mot. Pas de société sans mythologie, sans tronc qui motive les énergies à l’action et qui les rassemble autour d’elle. La dissipation de l’énergie française est par excellence le grand problème politique de Barrès. Avant Drieu la Rochelle qui, dans Mesure de la France, évoquait déjà l’absence de vitalité française, Barrès notait également la baisse de la démographie, l’absence de morale, la fin de l’éthique commune et partout la désunion : désunion des individus, désunion des familles spirituelles, désunion des partis, désunion de la foi et de la société…
Or, si la décadence réside dans la désagrégation, très logiquement la vitalité réside dans l’intégration. Mais comment la faire ? Est-elle une unité jacobine ? Est-elle une unité plurielle ? Comment tenir la double exigence de liberté et d’autorité ? Barrès répond à cela : socialisme fédératif. Mais socialisme, dira-t-on, n’est-ce pas Marx ? N’est-ce pas le retour de la matière alors même que nous attendions ici plus d’esprit ? Pour Barrès, c’est loin d’être le cas. Socialisme veut dire peuple, veut dire enracinement, énergie, fédéralisme et surtout nationalisme. Mais qu’est-ce à dire, comment combiner tous ces éléments que d’instinct l’on sentirait opposés ?
Reprenons. Si le Moi disait : « Penser solitairement, c’est s’acheminer à penser solidairement », c’est parce que la tradition est comme ce grand et éternel ordre architectural que l’on perfectionne par l’action individuelle. La tradition est une unité dynamique qui reçoit sans cesse polissage et force de ses héritiers – pourvu qu’ils s’en soucient. Or, ce souci de la tradition, nous l’avons dit, est tout à la fois vitalité et spiritualité du Moi. Bref, la tradition le dote d’une unité, d’une colonne. Mais cette tradition n’est pas un bloc monolithique imposé, elle est retrouvée et composée par le Moi. L’unité de sa vie, c’est la composition désirée entre son être et celui de ses pères.
L’unité est ainsi toujours plurielle, c’est un réseau de sens qui la couve et l’abrite. Ainsi, dans son rapport à la collectivité, c’est le Moi qui, par amour, reforge son unité avec le groupe : « Ce mot unique qui supprimerait nos scrupules, qui referait l’unité dans ces consciences en désarroi devant la vie, il faut le chercher à la même source où nous avons pris notre besoin d’agir, et comme c’est l’amour seul qui nous pousse à sortir de notre individualité, c’est l’amour aussi qui présidera à notre action sociale. » Individualité et collectivité sont réunies ensemble par l’amour, par le sentiment de pitié. Il y a du Rousseau dans cette équation. Une philosophie de la pitié non étendue à l’ensemble du monde – il n’y a pas d’humanitarisme chez Barrès – mais cadenassée par la nation. En un trait donc : le socialisme est le seul vrai nationalisme. Par l’amour, ce sentiment social, Barrès aboutit ainsi à son fameux socialisme national.
Le fédéralisme, condition du nationalisme
C’est parfois très en détail qu’il en construira le programme6, notamment à travers l’aventure boulangiste. Dans cette dernière, il perçoit enfin la double chance de révolutionner la société en mettant à bas la classe des parlementaires, tout en réveillant l’énergie nationale par une politique sociale, de masse, incarnée et tenue par le général Boulanger. De courte durée cependant, l’aventure ne sera pas moins une vraie tentative de coup d’État planifiée par Barrès et son camp. Après le boulangiste, ce sera dans La Cocarde, journal qu’il dirige de 1894 à 1895, et véritable laboratoire d’idées dans lequel se retrouve les personnalités les plus diverses et avant-gardistes, que Barrès pensera son socialisme national. L’objectif du journal ? La création d’une idéologique politique sociale, nationaliste, antiparlementaire et fédéraliste.
Ce dernier est l’autre étage du socialisme barrésien. En cela complètement héritier de Proudhon, Barrès voit dans le fédéralisme la seule possibilité de maintenir l’antinomie de la politique : liberté et autorité. De la même manière que le Moi participait à l’unité plurielle de la tradition, de la même manière les régions participeront de l’unité nationale. C’est, en effet, par l’enracinement local qu’il estime que la France retrouvera son énergie politique et sa capacité d’action politique. La France nationaliste de Barrès est une fédération de régions qui choisissent chacune, par amour de la France, par intérêt pour l’existence française, la voie du nationalisme. Faisons en sorte que les régions soient plus enracinées que jamais et la France sera elle-même plus heureuse et puissante. Voilà la leçon de Barrès.
Face à une Allemagne grandissante, il estime ainsi que la vie locale favorisera l’énergie française. Le fédéralisme en sera le revigorant, le médicament, qui guérira des maux engendrés par le jacobinisme révolutionnaire. En cela, Barrès croise la route de Mistral, d’Amouretti, de Proudhon et de Maurras. Tous luttent contre cette égalité uniformisante de l’empire et de la république pour une reconnaissance des différences régionales qui s’intègreront à la nation.
En effet, cette quête de l’énergie, si elle aboutit naturellement à l’enracinement, exige une politique fédéraliste qui compose la France comme une totalité plurielle. La France intègre donc des sensibilités diverses, des familles spirituelles étrangères, mais toutes intéressées à son existence et qui la renforceront. Le fédéralisme aboutira donc nécessairement au nationalisme.
Comme remède au déracinement, la décentralisation régénèrera la patrie française, toutes ces vies locales activées ensembles couleront leur énergie dans la France. Une synthèse de sensibilités, d’enracinements qui cadrent les individus, voilà tout le « méchant » nationalisme barrésien. Un cadre souple qui retient les Moi divers dans une communauté destinale. Barrès écrivait que le nationalisme était comme l’acception d’un déterminisme. Celui-ci est toujours enraciné et biographique, mais, dans le plus profond de l’enracinement régional, on retrouve toujours la France. C’est tout l’espoir de Barrès : la fondation d’un nationalisme qui donne un droit d’existence à chaque français, qui les dote d’un tronc par l’enracinement local. Et donc plus libre chacun, plus forts ensembles, ils participeront tous de l’œuvre française : « Les systèmes, les discours, tout cela, c’est des feuillages et des branchages ; mais la vraie vie, c’est les profondes racines. C’est d’en bas que doit monter la vie, pour s’épanouir en raison dans quelques-uns. La vie pour notre pays, nous l’attendons de la résurrection des régions, des villes. Ne sont-elles pas ce grand Empire du silence ? » Et le silence n’est-il pas le lieu où souffle le plus l’Esprit duquel nous renaîtrons ?
1. Renan (Ernest), La réforme intellectuelle et morale, parue en 1871.
2. Barrès (Maurice), Sous l’œil des barbares, T. 1 Culte du Moi, Oraison.
3. Personnage qui représente Auguste Burdeau dont Barrès a suivi la classe de philosophie à Nancy.
4. Le mot « foyer » a le double sens du feu qui brûle dans la maison et par extension de la maison comme telle.