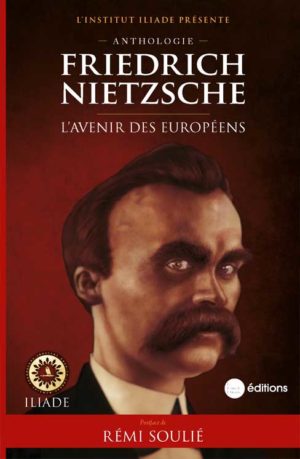Il y a toujours, dans la géographie, une dimension poétique, et dans la poésie, une dimension géographique. L’ouest, c’est la direction de la mer, et du Couchant, l’est, c’est le grand continent eurasiatique, et c’est le Levant. Le Nord, c’est là où tout se resserre pour atteindre le pôle. Le Sud, c’est aller vers le soleil plus haut et plus fort. Exemple avec Nietzsche, philosophe, voyageur et poète.
Chacun sait qu’il y a chez Nietzsche une opposition entre le dionysiaque et l’apollinien. Ce que l’on sait moins, c’est que cette opposition peut avoir une traduction géographique. Mais il ne s’agit pas d’assigner de manière mécanique un état d’esprit à une région. Il s’agit bien plutôt d’une géopoétique. Dionysos, c’est la force, et même la violence, c’est la brutalité, l’énergie, l’obstination. C’est un mélange d’énergie positive et d’un acharnement qui peut être un excès. Apollon, c’est l’équilibre, la douceur, la Méditerranée, la capacité à lâcher-prise. C’est moins d’historicité et plus de présence à soi, aux paysages, au féminin. C’est plus d’attention au monde et moins de possession du monde. Les deux tendances, les deux polarités, les deux orientations sont nécessaires. Mais nous savons bien que Nietzsche a privilégié la recherche du versant apollinien. Peut-être parce que l’on privilégie toujours ce qui nous manque, et ce qui manquait à Nietzsche, c’est la sérénité. Et le sens du combat ? Mais que l’on oublie Nietzsche si on n’a pas compris que toute sa vie est un combat ! Recherche du manque : l’homme du Nord recherche le Sud. L’Allemand recherche l’Italie, Le Russe se fait construire des palais par des architectes Italiens.
« Nous avons besoin du sud à tout prix, d’accents limpides, innocents, joyeux, heureux et délicats », écrit Nietzsche (Dans le sud). « Perché sur un courbe rameau,/ Me balançant tant je suis là,/ Me voici l’hôte d’un oiseau,/ C’est un nid, j’y prends du repos./ Où suis-je donc ? Loin ! Loin, hélas !/ La mer somnole, blanche, étale ;/ Purpurine, s’y dresse une voile./ Rochers, figuiers, havre, beffroi,/ Idylles alentour, moutons mêlant leurs voix,/ – Sud innocent, accueille-moi !/ Mais aller pas à pas, ce n’est pas une vie,/ Pied à pied, cela rend germanique et lourdaud,/ J’ai demandé au vent de m’élever bien haut,/ J’ai appris à voguer aux côtés des oiseaux,/ – vers la sud, sur la mer, j’ai volé moi aussi. » Le sud, c’est Mozart, « sa politesse qui part du cœur, son goût de la grâce, de la tendresse et de la danse ». Mozart plutôt que Wagner. La légèreté plutôt que la pesanteur tragique. Le sud, c’est vouloir se perdre, c’est vouloir s’oublier. « Les uns voyagent parce qu’ils se cherchent, les autres parce qu’ils voudraient se perdre. » Mener une vie de Fugitivus errans (Lettre à Paul Rée, juillet 1879), tel est le programme de Nietzsche. Nietzsche voudrait oublier son côté nordique, germanique. D’où ses voyages vers la lumière. D’où son goût pour Nice, entre 1883 et 1888. S’oublier, c’est aussi chercher à être oublié. « Tout penseur profond craint plus d’être compris que d’être mal compris. » (Par-delà bien et mal, par. 290). Si Nietzsche veut s’oublier, c’est pour être plus attentif au monde lui-même, à ses tressaillements.
Vertu du voyage et de la marche
Pour mieux écouter le monde, les bons outils sont les plus simples : la marche, les changements de lieux, les hôtels, les petites auberges. On peut ainsi donner à ses pensées « du silence et du terreau frais ». Vertu de la marche. « Je suis au moins huit heures par jour sur les chemins : c’est à ce prix que je supporte la vie. » Chaque nouveau territoire est une « nouvelle hypothèse de vie » (Pierre Parlant, Les courtes habitudes. Nietzsche à Nice, Nous, 2014). Le but est de « ne plus connaître son adresse », pour mieux écouter le monde. Voyager, déménager : voilà qui est une ascèse nécessaire pour vivre vraiment. « On ne va nulle part, autrement dit, on danse », disait Aby Warburg. Voyager, c’est refuser le confort de la fixité. C’est « demeurer sensible aux variations. » C’est « l’aventure d’une vie rendue par éclairs à elle-même. » (Pierre Parlant, op. cit.).
Nietzsche a un nom pour cela : « Courtes habitudes. — J’aime les courtes habitudes et je les tiens pour des moyens inappréciables d’apprendre à connaître beaucoup de choses et des conditions variées, pour voir jusqu’au fond de leur douceur et de leur amertume ; ma nature est entièrement organisée pour les courtes habitudes, même dans les besoins de sa santé physique, et, en général, aussi loin que je puis voir : du plus bas au plus haut. Toujours, je m’imagine que telle chose me satisfera d’une façon durable — la courte habitude, elle aussi, a cette foi de la passion, cette foi en l’éternité — je crois être enviable de l’avoir trouvée et reconnue : — et maintenant je m’en nourris ; le soir comme le matin, un doux contentement m’entoure et me pénètre, en sorte que je n’ai pas envie d’autre chose, sans avoir besoin de comparer, de mépriser ou de haïr. Et un jour, c’en est fait, la courte habitude a eu son temps : la bonne cause prend congé de moi, non pas comme quelque chose qui m’inspire maintenant du dégoût — mais paisiblement, rassasiée de moi, comme moi d’elle, et comme si nous devions être reconnaissants l’un à l’autre, nous serrant ainsi la main en guise d’adieu. » (Le Gai savoir, par. 295).
Dans le voyage, il s’agit, dit Pierre Parlant, de « chercher les signes pour rendre compte », de chercher les « excédents d’état d’âme », qui sont de précieuses raretés. Une vie se comprend par ses éclairs et ses coups de tonnerre, par ses sautes d’humeur, et par ce que l’on recherche tout autant que par ce que l’on a. « Ici [dans le Sud], je crois au soleil, comme la plante y croit », dit Nietzsche. S’oublier, c’est avant tout oublier l’intellectuel en soi. C’est se retrouver en marchant. C’est retrouver l’homme sensitif, animal. « Quitter à intervalles réguliers la position assise de l’intellectuel pour arpenter les chemins environnants fait partie de mon hygiène de vie : comment pourrais-je demeurer assis à ma table de travail pendant des heures sans être assailli par les plus terrifiantes migraines. » (Nice, 5 janvier 1884). Nietzsche poursuit : « Mes plus belles pensées ont toujours surgi inopinément au cours de mes marches solitaires, un peu comme si l’effort physique stimulait mon cerveau et lui donnait accès à des dimensions que je recherchais sans pouvoir les atteindre alors que j’étais assis à mon bureau. » Mais ailleurs, Nietzsche envisage l’hypothèse que ce soit la découverte de nouvelles perspectives sur la vie qui décuplent ses forces. Quoi qu’il en soit, c’est bien une unité corps et âme (un monisme) qui est à l’œuvre.
Se libérer de la lourdeur
C’est au cours d’une promenade à Eze, près de Nice, que Nietzsche aperçoit ce que peuvent être les nouvelles valeurs. La première d’entre elles consiste à se libérer de la lourdeur et de la stagnation. Dans la promenade, ce n’est pas la santé du corps qui fait penser plus haut et plus fort, c’est la richesse de la pensée qui fait oublier la fatigue. C’est ici, à Eze, que le premier éclair de Zarathoustra est apparu à Nietzsche. « L’agilité des muscles a toujours été chez moi d’autant plus vive que la force créatrice débordait avec plus d’impétuosité » (Ecce homo, 4). Le corps connaît la force par la joie de l’esprit. « C’est le corps qui connaît l’enthousiasme : laissons ‘’l’âme’’ hors de tout cela. »
Le goût du Sud, c’est le goût de la douceur. Mais ce n’est pas que de la douceur. « Du calme, de la grandeur, du soleil », dit Nietzsche à propos des villes d’Italie – et Nice est en partie une ville d’Italie. Il appelle cela « la grande trinité de la joie ». C’est le Grand Midi dont parle Albert Camus dans L’été. Où trouver ce bonheur ? A Turin, à Nice, plutôt qu’à Gênes (et pourtant… cette ville est « débordante de force vitale ») ou à Venise. Pas à Rome en tout cas (« Rome n’est pas un endroit pour moi »). Turin, décidément, c’est la ville où des marchands de légumes choisissent pour Nietzsche les meilleurs raisins. « Voilà jusqu’où doit aller la philosophie… ». Peu de temps avant de s’effondrer, après avoir vu, dit-on, un cheval martyrisé par son maître, Nietzsche avait rêvé d’une scène semblable. Il en avait parlé, le 3 janvier 1889, dans un courrier adressé à son ami Reinhart von Seydlitz. Le cheval malmené avait supporté, dans le rêve de Nietzsche, stoïquement que son maitre le prive d’eau. Amor fati. Acquiescement au monde, tel qu’il est, et sans rien en ôter. Encore une leçon apollinienne. A nouveau, le Sud.
Lire aussi : Nietzsche en perspectives par Pierre Le Vigan
Friedrich Nietzsche, (1899) peinture de Hans Olde.