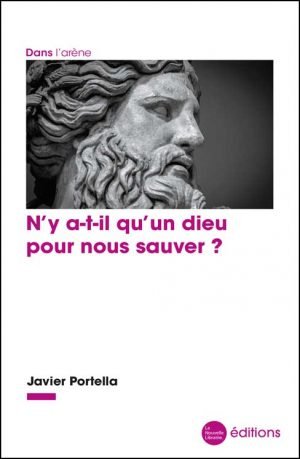L’article de David L’Épée, publié récemment ici même sous le titre « Éric Zemmour : les métamorphoses d’un antilibéral », me paraît d’une très haute importance. Je suis, on le verra, profondément en désaccord avec lui, mais une chose n’exclut évidemment pas l’autre. L’article reproche à Zemmour de délaisser les intérêts du prolétariat au profit de ceux de la bourgeoisie, la défense de l’identité nationale entreprise par Zemmour étant comprise comme une sorte de paravent voué à camoufler (ou à ne pas combattre) l’oppression capitaliste. L’importance de l’article ne tient pas seulement au débat avec Zemmour. Elle découle surtout de ce qui est en jeu dans un débat où il y a quand même un point sur lequel nous sommes tous d’accord. Face à ceux qui prétendent dissoudre l’identité nationale (et au point où en sont les choses, il faut y ajouter l’identité sexuelle, voire anthropologique), il est clair que c’est de toutes nos forces qu’il faut défendre l’identité. Là-dessus, point de désaccord. La question est : dans le cadre de quel Système, de quelle vision du monde faut-il entreprendre une telle défense identitaire ?
Qu’est-ce que le socialisme, qu’est-ce que le capitalisme ?
Il serait grand temps d’en finir avec l’image qu’on se fait couramment du capitalisme. Non, le capitalisme n’est pas (ou pas seulement, pas avant tout) l’inégalité et l’injustice sociale, ou le libre marché, ou la propriété privée des moyens de production, ou la convoitise de la grande bourgeoisie, ou l’exploitation de l’homme par l’homme. Mais voyons, grands dieux ! Toute l’histoire, toutes les époques, tous les régimes en sont bien remplis – chacun à leur façon –, la grande différence étant que le capitalisme pousse tout cela à l’extrême. Seul un régime, seul le socialisme a prétendu abolir la propriété privée et le marché, avec le résultat de porter la misère (pour ne pas parler de ses autres crimes) à l’extrême.
Le capitalisme (qui, compte tenu de sa dimension politique et sociale, coïncide bien sûr avec le libéralisme), c’est certes l’inégalité sociale et économique, accompagnée de tout le reste, mais placée dans le cadre de quelque chose d’absolument nouveau, jamais vu.
Ce qui n’avait jamais été vu, c’est la réduction de l’esprit à la matière, c’est « le matérialisme abject » dont parlait Lamartine, c’est la compréhension du monde dans des termes essentiellement matérialistes, utilitaires, mécaniques. C’est, pour le dire d’un mot, la désacralisation du monde.
En finir pour de bon avec Homo œconomicus
C’est là le noyau. Mais il y a évidemment bien d’autres traits dont l’intérêt compris comme moteur premier de l’action des hommes. Il y a, autrement dit, la convoitise, celle que le monde a toujours connue, mais qui, facilitée par le développement prodigieux de la technique, devient une convoitise folle, effrénée, plongée dans l’hybris que les Grecs craignaient par-dessus tout.
Et il y a l’hypocrisie, également exacerbée : l’hypocrisie d’une prétention égalitaire et démocratique que les faits s’entêtent à démentir sans arrêt. Et il y a l’atomisme:le morcellement qui s’attaque à la personnalité des individus soumis au règne des foules grégaires et à l’emprise des marchandises devenues les fétiches dont parlait Marx. On le voit, ce n’est pas sur le plan économique que prennent place les grands enjeux du capitalisme. L’Homo œconomicus est pourtant son homme, son modèle, cette chose petite et minable que le monde moderne prend pour son héros. Certes, mais comme tous les paradigmes qui portent le monde (comme tous les mythèmes, dirait Giorgio Locchi), l’Homo œconomicus n’est pas une création de l’économie : c’est une création de l’esprit. Loin d’être un fait économique, c’est un fait spirituel.
« L’économie n’est pas le destin »
Détrôner un tel pantin, le déloger du cœur du monde, voilà l’enjeu, le défi pour quiconque veut en finir vraiment avec le capitalisme. Or, rien n’est plus éloigné de cela que la vision socialiste, marxiste ou « marxisante » du monde. Pour elle, l’économie est le destin.
C’est bien cela qu’affirme Jean-Yves Le Gallou dans son article « L’économie n’est pas le destin ! » [qui fait l’objet d’une réfutation par David L’Épée, NDLR]. Or, l’avènement d’un nouveau destin qui romprait avec le capitalisme en tant que règne de l’Homo œconomicus, voilà qui ne devrait entraîner ni la rupture avec la propriété privée des moyens de production, ni avec les lois du marché, ni avec l’âpreté au gain, ni avec les inégalités qui nécessairement en découlent.
Et pourtant… C’est vrai ! Il ne s’agit pas du tout « d’évacuer la question sociale ». Il s’agit, tout au contraire, de la prendre à bras le corps (aussi bien pour des raisons de justice que d’opportunité : ce n’est qu’ainsi que les braves gens pourront être vraiment de la partie). Les lois du marché, on ne peut ni on ne doit les abolir. Mais ces lois, il faut les dompter, c’est évident ; cette âpreté au gain, il faut l’entraver, la canaliser, pour qu’elle ne tombe plus dans la folle démesure qu’on connaît ; ces inégalités et ces injustices, il faut bien sûr les limiter dans toute la mesure du possible. Comment, par quelles voies, par quels moyens politiques, économiques ? Ce n’est pas là l’objet de cet article qui ne fait que poser des questions de fond et ne prétend pas entrer dans le détail d’un programme économique.
Le « bifteck » vu par Louis-Ferdinand Céline
Un mot, quand même, sur des mesures économiques qui devraient s’en prendre essentiellement à la haute spéculation financière (aux « usuriers » dont parlait Ezra Pound) ; des mesures économiques qui devraient s’attaquer aux grands oligopoles internationaux bien plutôt qu’aux entreprises petites, moyennes et même grandes mais circonscrites à l’échelle nationale. Or, quelles que soient les mesures économiques qu’un jour on pourrait prendre, il s’agira toujours de mesures de nature « réformiste », jamais révolutionnaire. La révolution, le renversement profond de l’ordre du monde, c’est à un autre niveau qu’il faut l’envisager.
Un tel renversement, il est exclu qu’un Éric Zemmour, s’il devait être élu président, puisse envisager de l’entreprendre. Ces choses-là se jouent, non pas au niveau de la politique menée au grand jour, mais dans les tréfonds obscurs et avec la lenteur propre à la vie des peuples. Il n’en reste pas moins qu’il serait d’une importance cruciale de voir surgir à la tête de l’État quelqu’un susceptible d’opérer un tel renversement – et de mettre les choses de l’économie, du « bifteck », comme disait Céline, à la place qui est la leur : une place essentielle, décisive, aussi importante que l’on voudra, mais subordonnée. Les choses du monde, de l’identité et de l’esprit, au centre, au cœur : là où, jusqu’à la désacralisation du monde (1), jusqu’à l’avènement du nihilisme accompli, elles ont toujours été.
1. Désacralisation dont il est notamment question dans mon livre N’y a-t-il qu’un dieu pour nous sauver ? récemment paru aux Éditions de la Nouvelle Librairie.