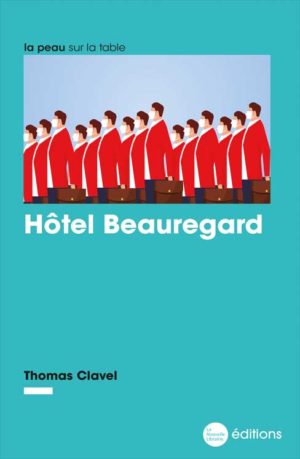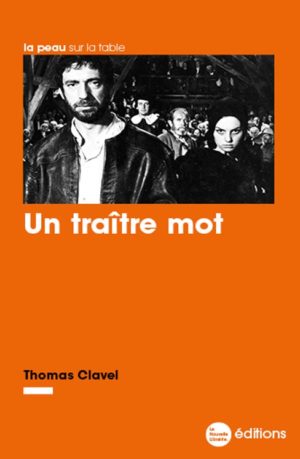Il y a des romans qu’on peut commencer par la dernière phrase pour en remonter le fil, le cœur déchiré. C’est le cas de cet Hôtel Beauregard que Thomas Clavel a réquisitionné sur la corniche niçoise et qui s’achève par ces mots : « Sur ses lèvres à elle se dessina un sourire. Il était le premier de son nouveau visage. » Ce visage, c’est celui d’Axelle, sauvagement défiguré à l’acide pour avoir omis d’enfiler son masque à l’occasion d’une photo de groupe postée sur Instagram. Harcelée par la meute sans visage des réseaux sociaux, elle voit sa vie de doctorante en biologie marine basculer dans un cauchemar éveillé. Elle qui vivait jusque-là en apnée parmi les méduses, dans le monde ouaté et silencieux des abysses, est brutalement projetée à la surface, parmi ces autres méduses, redoutablement plus venimeuses, que sont les hommes.
Une influenceuse née dans les quartiers nord de Nice, Nahama, star des réseaux sociaux, mandatée par le nouvel ordre sanitaire promu par le gouvernement, va livrer Axelle en pâture à une espèce mutante, rameau numérique de la hyène dactylographe chère à la propagande soviétique : la hyène tactilographe, celle qui « annule » (cancel) par écran interposé en jouant de son clavier tactile. Dès lors, les hashtags #cancelAxelle fleurissent viralement, comme des fatwas contagieuses. Aucune échappatoire possible. Ainsi va le monde : il tient désormais tout entier dans le rectangle plat d’un smartphone, et non plus dans un visage (ils sont masqués), encore moins dans un livre, quand bien même c’est un livre, celui de Thomas Clavel, qui nous l’apprend. N’en déplaise à Sartre, l’enfer, ce n’est plus les autres ; c’est la disparition des autres derrière leurs masques, leurs écrans, leur « annulation » programmée de la mémoire des ordinateurs.
Bas les masques obligatoires
Hôtel Beauregard nous plonge dans un quatrième reconfinement, et Thomas Clavel nous sidère une nouvelle fois par sa faculté à mettre en scène les dérives ou plutôt les délires caractéristiques de notre temps. Avec ce second roman, magnifique de bout en bout, sa personnalité romanesque s’affirme un peu plus. On sait qu’elle le porte à l’analyse dystopique de notre monde et à l’exploration des dissidences possibles qui s’offrent à nous.
Port du masque obligatoire. Que serait un monde sans visage ? Un monde masqué, qui se déroberait au regard, à l’appréhension, à la vision, à la connaissance de soi et à la reconnaissance des autres, retranché derrière des bâillons chirurgicaux, débarrassé de la face humaine. Le masque, c’est l’homme indifférencié, signature anonyme de notre temps. « Les gens portent ce masque par passion pour l’égalité », fait d’ailleurs dire Thomas Clavel à l’un de ses personnages les plus attachants, le peintre Jean-Baptiste Monceau.
Égalité, ressentiment, effacement. La cancel culture, parabole de notre temps ? Du moins donne-t-elle raison à un siècle de distance au programme expéditif du jeune Aragon dans son Traité du style : « Certains jours, j’ai rêvé d’une gomme à effacer l’immondice humaine », fanfaronnait le jeune surréaliste qui s’apprêtait à rejoindre les soviets et à chanter le Guépéou. Aujourd’hui, c’est l’immondice humaine qui « annule » la face humaine sous une avalanche de masques et de hashtags.
Il y a un siècle, le visage disparaissait des tableaux. Cette éclipse totale – c’est le mot – de la figuration préfigurait-elle la défiguration des visages ? Auquel cas le port du masque en aura parachevé le processus. Que reste-t-il de l’homme sans son visage ? Un tronc doublé d’un tube digestif ! Table rase, visage escamoté, disparition du sujet : quand le nouvel impératif catégorique sanitaire rejoint la cancel culture, la culture de l’effacement…
Chaque homme dans sa nuit
Pour dépeindre cet univers désenchanté, Clavel dispose d’une palette – et d’un antidote – incomparable : sa langue, d’une netteté lustrale, belle, éminemment pure et précise, sans fausse note, sans bavure. Il y a toujours des éclaircies dans ses livres. La ligne claire de son écriture mélodique n’y est pas étrangère. Elle aménage des puits de lumière qui viennent rompre l’obscurité : des sanctuaires de beauté préservés de l’enlaidissement, des retraites pour l’âme. Ici un poème, là un tableau, ailleurs une vieille chapelle, ailleurs encore des visages.
Dans un monde en butte au Gros Animal des réseaux sociaux et à son intarissable grésillement salivaire, uniformément dominé par les instincts grégaires, les passions tristes, les névroses égalitaires, les réflexes conditionnés, le narcissisme des petites différences, Clavel comble notre soif de beauté. Ses romans ont quelque chose en plus – la poésie. Par-delà la satire sociale incisive, par-delà la critique sanitaire réjouissante, ils sont pareils à des balises. Comme le sourire d’Axelle dans la plénitude de son visage défigurée.
Dans l’art sacré, il y a des chemins de lumière, comme à Vézelay, où le soleil au zénith du solstice d’été trace sur les dalles de la basilique, à l’intersection du christianisme et du paganisme, une bande lumineuse. Les romans de Thomas Clavel sont des chemins de lumière. C’est ce que je préfère en eux, par-delà leurs qualités romanesques – et Hôtel Beauregard fait étalage d’une maîtrise formelle au moins égale à celle d’Un traître mot. Vient un moment où le romancier déleste ses personnages de la gangue de laideur qui les entoure : ils sourient intérieurement. C’est le sourire qui transfigure les visages ; c’est lui qui transfigure le lecteur. Ces sourires de femmes ou d’anges, chacun de nous en conserve dans l’album photos de sa mémoire, fixés à jamais, qui ne jaunissent pas, qui ne se ternissent pas. Chacun a les siens. Moi, c’est celui de l’Ange au sourire de la cathédrale de Reims, inaltérablement rayonnant. C’est celui d’Anne Alvaro dans Le goût des autres quand, à la fin d’une pièce d’Ibsen, elle aperçoit au fond de la salle Jean-Pierre Bacri. C’est celui, illuminé, d’Axelle, qui appartient à la famille rimbaldienne des illuminations, définitivement.
-
 Hôtel Beauregard14,90€
Hôtel Beauregard14,90€ -
 Un traître mot14,90€Noté 5.00 sur 5 basé sur 1 notation client
Un traître mot14,90€Noté 5.00 sur 5 basé sur 1 notation client