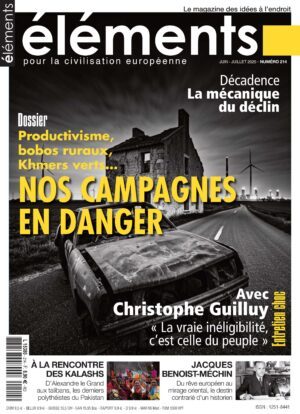Après avoir regardé cette série à l’adolescence, la redécouvrir avec les yeux de la maturité fut vraiment une expérience extraordinaire. D’abord parce que je ne me souvenais de rien, à part du fameux cadavre de Laura Palmer et de la troublante Audrey Horne. Ensuite, parce que le bon David Lynch arrive à vous plonger dans une atmosphère, dans un monde, dont il est ensuite difficile de ressortir. Peut-être à cause la musique opiacée de Badalamenti, peut-être à cause de cette nature aussi maléfique que fascinante, ou encore de la mise en scène habile et complexe de Lynch, de ses monstres, de son ironie grotesque habitant aussi bien les lieux réels qu’imaginaires. Mais quoi qu’il en soit, quand on regarde une telle série, le reste apparaît forcément bien fade et médiocre…
Pas seulement Twin Peaks…
La mort de Lynch – qui avait déjà disparu artistiquement depuis des décennies à cause de cet establishment qui le pleure tant aujourd’hui – m’a alors incité à revisiter l’ensemble de son œuvre. En commençant par Eraserhead, en passant par Rebelle au cœur, Mullholland Drive, Fire walk with me, mais surtout The Elephant Man. On peut le dire, son chef-d’œuvre, et son seul film « normal » avec The Straight Story (l’alpha et l’oméga de sa carrière) ; « normal » doit être compris dans le sens de « réaliste », puisque toute la filmographie du maestro se concentrant sur deux plans, celui de l’onirique/symbolique et celui du réel/concret. Une antinomie que l’on retrouve dans son exploration des catégories du bien et du mal, du positif et du négatif, du bon et du mauvais, du pur et du corrompu, du courageux et du lâche. Comme lorsque le chirurgien de The Elephant Man, interprété par un jeune Antony Hopkins, demande à sa femme s’il est un homme bon : « Suis-je un homme bon ? ». Elephant Man axe son propos précisément sur la recherche du bien et du beau. Dans le cas du pauvre John Merrick, infirme de nature, c’est une beauté qui s’exprime par sa délicatesse allant de son admiration pour la cathédrale qu’il observe depuis la fenêtre de sa chambre d’hôpital (et qu’il reconstitue à partir de bouts de carton) à la façon dont il parvient à décorer son petit environnement, le conservant sacré malgré les agressions extérieures. La beauté de John Merrick, c’est ce qui nous parvient à travers son regard. L’émerveillement intérieur et extérieur pour vaincre sa némésis, exprimée par une humanité sous-humaine, brutalisée par le travail répétitif et les réjouissances nocturnes.
Une critique de la société industrielle
Et voici un autre thème que l’on retrouve dans toutes les œuvres de Lynch : la critique féroce de la société industrielle, de son bruit, de sa saleté, de l’action précisément répétitive de l’homme-machine, insensible à la beauté et à la bonté. En cage, toujours en cage. Dans The Elephant Man, il y a une scène qui pourrait sembler n’avoir aucun rapport avec le récit, mais qui est en fait tout à fait pertinente. Il s’agit de celle des travailleurs de nuit souillés par le charbon, pratiquement attachés aux machines, une scène qui répond à celle dans laquelle nous trouvons M. Merrick prisonnier dans une cage. L’homme moderne devient le véritable monstre. Sa présence hante chacun des films de Lynch, comme elle hante la vie des grandes villes, mais aussi celle de la petite ville de Twin Peaks.
Ce n’est pas une coïncidence si Lynch, originaire du Montana et ayant déménagé à Philadelphie avec sa famille lorsqu’il était enfant, décrit la ville où il a grandi comme un enfer d’insécurité, de violence, de drogue et de décadence. Et qu’elle a représenté, comme il l’a lui-même répété dans diverses interviews, le point d’appui de toute sa création artistique. Et c’est aussi la drogue qui domine toutes ses histoires de morts violentes, de crimes sauvages. Aussi bien dans la petite banlieue américaine, si rose et calme, du moins en apparence, que dans la barbarie des grands centres urbains.
Merci maître (et pas seulement pour Twin Peaks)
Dégoûté par Hollywood (de manière flagrante dans Mullholland Drive, film sur les désillusions d’une jeune aspirante actrice et sa descente dans un gouffre inexorable), Lynch lui tourne définitivement le dos en 2006. L’année de la sortie du difficile Inland Empire, son film le plus ardu et le plus eschatologique, il poursuit son chemin avec des documentaires et des courts métrages, dans la liberté artistique qui lui a toujours été chère.
Nous le retrouvons en 2017, comme promis (le cryptique « see you in 25 years » de Laura Palmer dans Black Lodge). Nous sommes dans la troisième et dernière saison de Twin Peaks, un coup de pied au visage des temps modernes qui veulent tout et tout de suite, de la société de l’éphémère et des canons hollywoodiens. Tout cela traité en 18 épisodes, dans lesquels – selon les critères des imbéciles – il ne se passe absolument rien. Sauf le rêve, le cauchemar, la poésie, l’horreur, l’Autre… Il est vraiment grand temps de revoir toute l’œuvre de David Lynch. Merci pour tout, maestro, à bientôt dans la loge blanche.
Article initialement paru en italien sur : https://www.ilprimatonazionale.it/