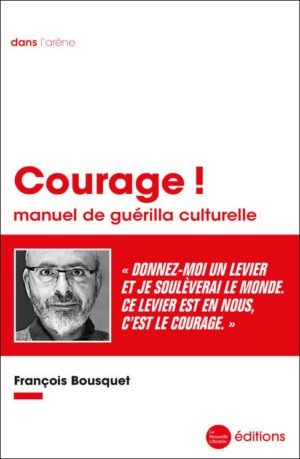Quel tableau que La Comédie humaine ! Un demi-siècle d’histoire nationale, de la Révolution à l’Empire, de la Restauration à la Monarchie de Juillet. C’est un fait social total, pour reprendre l’expression que forgeront plus tard les pères de la sociologie française, Émile Durkheim et Marcel Mauss. Il n’y manque rien, ni les institutions, ni les métiers, ni la religion, ni la politique, ni la vie, ni la mort. Balzac peint, cartographie, explore la société de bas en haut, et inversement. Son sujet, c’est la réalité dans toutes ses dimensions. « Tous ses livres ne forment qu’un livre, livre vivant, lumineux, profond, où l’on voit aller et venir et marcher et se mouvoir, avec je ne sais quoi d’effaré et de terrible mêlé au réel, toute notre civilisation contemporaine », dira Victor Hugo, qui porta le cercueil de Balzac jusqu’à sa dernière demeure – le Père-Lachaise.
Pas de Marx sans Balzac
Balzac voulut accomplir avec la société ce que Buffon avait entrepris de faire au siècle précédent avec le monde animal et végétal. La Comédie humaine sera son Jardin des plantes : elle rassemblera l’ensemble des espèces, des types, des caractères. En démiurge infatigable, il ne défia pas seulement l’état civil, mais la création. Ayant trop d’énergie pour se contenter d’une vie, il en créa des milliers, en les faisant revenir d’un roman à l’autre à partir du Père Goriot, chef-d’œuvre qui offre en raccourci tous les grands thèmes balzaciens. Grâce à quoi, La Comédie humaine fait société.
2 500 personnages, dont 573 qui reviennent au moins une fois. Des « lions » – ces grands carnassiers qui sont à la Restauration ce que les colonels d’Empire furent à l’époque précédente – aux grands manipulateurs du réel, à l’instar de Vautrin, le forçat devenu chef de la Sûreté, comme Vidocq avant lui, en passant par les boutiquiers et les banquiers, les femmes abandonnées et les filles à marier, les bourgeois enrichis par la vente des biens nationaux et « le milliard aux émigrés ». Rien n’est oublié, ni les secrets d’alcôve, ni les ténébreuses affaires, ni les hôtels du faubourg Saint-Germain, ni les pensions sordides de la montagne Sainte-Geneviève.
Si la Révolution est bien, comme l’a analysé Taine, une « translation de propriété », Balzac est celui qui en a décrit avec le plus de précision les mécanismes cachés. La Révolution a redistribué à grande échelle les cartes du jeu social. Balzac s’empare de cette immense transformation pour en faire le levain de son œuvre. Il était comme un buvard rempli d’encre : il l’a pressé, en est sortie La Comédie humaine. C’est en la lisant que Marx développa sa théorie de l’aliénation. Friedrich Engels avoua qu’il a plus appris dans ces livres que dans tous les manuels d’économie.
« Notre père à tous »
Balzac créa son monde en six jours. Le septième, il l’a laissé à ses successeurs. Vautrin, dans Les Illusions perdues et Splendeurs et misères des courtisanes, préfigure le Jean Valjean des Misérables. La Terre de Zola a poussé sur le fumier des Paysans. L’Otage de Claudel procède d’Une ténébreuse affaire. Rubempré et Vautrin annoncent Charlus et Morel. Les Célibataires de Montherlant s’inscrit dans la série des « parents pauvres » balzaciens. Ainsi de Barbey, Vallès, Barrès, du Nouveau Roman, etc. « C’est notre père à tous », disait Henry James.
Balzac fut au roman ce que Napoléon fut la guerre. « Ce qu’il a entrepris par l’épée, écrit-il en référence à l’Empereur, je l’accomplirai par la plume ». Un mot le résume : la profusion. C’était un homme pléthorique. On retrouve chez lui la vitalité plébéienne d’un Mirabeau ou d’un Danton. Tous les soirs à minuit, il enfilait sa robe de chambre et s’installait à sa table d’écrivain jusqu’au petit matin, emporté par son énergie titanesque, Vulcain dans sa forge engloutissant des litres de café. Là, il concevait tous les destins du monde. Son bureau s’élargissait aux dimensions de l’univers. « Alors, dit Théophile Gautier, commençait une lutte plus terrible que la lutte de Jacob avec l’ange, celle de la forme et de l’idée ». À huit heures du matin, il déjeunait, avant de se glisser longuement dans sa baignoire, comme Napoléon. À neuf heures, il corrigeait les épreuves, annotant, amendant, réécrivant, une fois, dix fois. À midi, légère collation. Après quoi, il reprenait ses corrections et rédigeait son interminable correspondance. Le soir, épuisé, il réclamait quelques heures de sommeil à son œuvre, avant d’enchaîner sur une nouvelle nuit de travail. Tel fut Prométhée ou la vie de Balzac, comme l’appela André Maurois dans sa biographie.
À nous deux !
C’était un ogre rabelaisien, boulimique et sensuel, un moine bénédictin qui avait l’appétit de Falstaff, un alchimiste qui transformait le plomb des existences individuelles en lettres d’or. Le philosophe Alain assurait qu’il était aussi naïf qu’Homère. Tout génial qu’il était, il restait sentimental en amour, crédule en affaires et fanfaron en société. Il courait après les succès faciles, l’Académie, la fortune, rêvant de particules, de fiacres et de duchesses, s’exhibant à l’Opéra ou aux Bouffes dans des tenues baroques et ridicules, couvert de boutons en or massif, avec sa canne à pommeau turquoise, ses dents abîmées, qu’il curait avec un couteau, ses ongles sales et son rire « hénaurme ». « Il était impossible de n’être pas gai avec lui ; un enfantillage réjoui, c’était le caractère de cette figure », témoigna Lamartine. Il promenait ses rondeurs dans les salons littéraires, où il côtoyait Vigny, Musset, Hugo, qui ne cessa de l’admirer, Sainte-Beuve, qui ne cessa de le dénigrer, Chateaubriand, Benjamin Constant. C’est lui qui fut à l’initiative de la Société des gens de lettres.
C’est à lui seul la France en miniature, un garçon de province parti défier les gens de la capitale, comme Rastignac. « À nous deux maintenant ! » Son père, Bernard-François Balssa, fils de laboureurs installés à la frontière de l’Albigeois et du Rouergue, avait pu quitter la ferme. Il était fournisseur aux armées quand Honoré naquit en 1799, à Tours. C’est le père qui transforma le nom et ajouta la particule. Sevré d’amour maternel, le fils trouva refuge auprès de femmes mûres. Son premier amour, Mme de Berny, de vingt-deux ans son aînée, demeura « la Dilecta », l’élue, qu’il dépeignit sous les traits de Mme de Mortsauf dans Le lys dans la vallée. Ensuite, il y eut la duchesse d’Abrantès, puis la duchesse de Castries et enfin Evelyne Hanska, qu’il épousa juste avant de mourir.
Effondrement de l’Empire, grand paradigme balzacien
Mais avant d’en arriver là, le jeune Honoré fit ses gammes d’écrivain. Après une brève expérience chez un avoué, dont il tira la saisissante figure de maître Derville, il s’installa, seul, à dix-huit ans, dans une mansarde, sous les toits de Paris, comme dans La Peau de chagrin, son premier chef-d’œuvre, génie solitaire mettant à profit ces années de réclusion pour écrire de mauvais livres sous des noms d’emprunt et dans le plus parfait anonymat. En 1825, lassé par l’insuccès, le jeune homme se lança dans l’édition, l’imprimerie et la « fonteréotypie », procédé d’impression révolutionnaire. Trois projets, autant de banqueroutes, qui laissèrent à la famille 100 000 francs de dettes.
En 1829, « l’homme aux faillites mythologiques, aux entreprises hyperboliques et fantasmagoriques » (Baudelaire) a trente ans, des dettes, des maîtresses et une carrière de nègre obscur. Inspiré par la vogue des romans historiques, il fit alors paraître sous son nom Le Dernier Chouan ou la Bretagne en 1800, qui intégrera plus tard La Comédie humaine sous le titre des Chouans. Le livre passa à peu près inaperçu, mais il sera suivi de la Physiologie du mariage, qui rencontra le succès. Balzac venait de trouver son public, spécialement cette Femme de trente ans, incomprise et délaissée, qui sera sa première lectrice. Il n’en fallait pas plus pour lancer celui qui n’attendait qu’un signe du destin pour que sa prodigieuse fécondité trouve enfin de quoi s’employer. Et quelle fécondité, une centaine de romans, vingt à trente chefs-d’œuvre, dont l’énumération triomphale évoque les victoires de Bonaparte en Italie. Même si en vieillissant, Balzac s’affichera légitimiste, Napoléon restera le premier modèle (et le rival). Son énergie irrigue La Comédie humaine, elle est à l’origine de quantité de fortunes et peut-être plus encore d’infortunes. Car le grand paradigme balzacien, c’est l’effondrement de l’Empire (Cent-Jours, Waterloo).
Balzac ne décrit pas seulement son temps, il décrit le passage d’un monde héroïque à un monde prosaïque à la manière d’un chemin de croix. « Je fais partie de l’opposition qui s’appelle la vie », martèle-t-il. La société n’est souvent chez lui qu’une coalition d’intérêts, de desseins médiocres, d’ambitions étriquées. Et le tombeau des illusions pour les âmes bien nées : le colonel Chabert, enterré vivant à Eylau, trahi par sa femme, ancienne prostituée devenue la comtesse Ferraud ; le cousin Pons, dépouillé de son fabuleux héritage ; César Birotteau, le parfumeur ruiné. Si ces personnages sont si déchirants, c’est que leur créateur y a jeté sa somme de rêves enfouis, d’espoirs déçus, de chimères inabouties. Il n’y a pas chez Balzac de réussites innocentes. « Le secret de ceux qui réussissent est un crime oublié parce qu’il a été proprement fait », clame Vautrin. C’est la raison pour laquelle on croise autant de prêtres, de médecins et d’hommes de loi dans La Comédie humaine : il revient aux hommes en robe noire de confesser la part sombre de l’humanité et d’en recueillir les débris.
L’homme enceint de ses livres
Balzac voyait tout, le visible et l’invisible, le naturel et le surnaturel. Baudelaire le tenait pour un « visionnaire passionné ». Le réalisme n’est chez lui qu’un prétexte, un préambule plutôt. Balzac ne plante pas le décor, c’est le décor qui plante les personnages. L’extérieur préfigure l’intérieur. D’où son attachement à la physiognomonie, « science » d’après laquelle les traits du visage donnent un aperçu de notre caractère.
Il croyait aux forces occultes et aux puissances de l’esprit, comme il croyait aux sociétés secrètes (L’Histoire des treize), par goût des choses cachées. De Louis Lambert à Séraphîta, jamais il ne renonça à sa veine illuministe. Grâce à elle, il s’imaginait pouvoir accéder à l’unité secrète du monde. Dans La Recherche de l’absolu, Bernard Palissy caresse le fol espoir de découvrir le principe de l’univers, sacrifiant les siens à sa recherche, comme le peintre Frenhofer dans Le Chef-d’œuvre inconnu poursuivant la beauté idéale.
La querelle autour de son style, entretenue par les puristes (« Quel homme eût été Balzac, s’il eût su écrire », se lamentait Flaubert), ne tient pas. Ce qui occupe Balzac, c’est la représentation de la vie dans sa totalité, non de faire valoir une certaine conception de l’art, comme les Romantiques. Le phénomène de création est chez lui pareil à une éruption volcanique. C’est l’homme enceint de ses livres tel que l’a sculpté Rodin. Sa fécondité est inépuisable. Elle emporte tout, jusqu’aux considérations stylistiques.
Non pas changer le monde, mais le sauver
André Gide disait, non sans témérité, qu’on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. Preuve qu’il avait lu de travers Balzac. Si l’auteur de La Comédie humaine fut sans nul doute l’un des plus prodigieux greffiers de « l’humaine comédie », le secret de son œuvre, son noyau, est à chercher ailleurs. L’auteur de La Cousine Bette ne voulait pas changer le monde, il aspirait à le sauver. C’est ce qui fonde la grandeur vertigineuse de son œuvre, cette grandeur des vaincus qui rachète la laideur sociale. S’il n’y a guère plus de place pour la grandeur et la bonté dans le siècle de fer que la révolution industrielle ouvrait, il serait faux de croire qu’elles sont pour autant vouées à disparaître. En vérité, elles travaillent dans le secret des cœurs, comme dans L’Envers de l’histoire contemporaine, roman-clé de La Comédie humaine. Hors du monde, il y a ainsi des gens qui prient pour le salut du monde, exactement comme des ordres religieux. Ainsi fut Balzac, dont la vie fut un tourbillon et qui se voyait vivre centenaire. « Quatre-vingts ans, c’est la fleur de l’âge ! », se risquait-il à dire. Titan boursouflé et vaincu, il est mort d’épuisement en 1850, la cinquantaine passée, appelant à son chevet, selon la légende, Horace Bianchon, le grand médecin de La Comédie humaine. La vie rejoignait alors la fiction, ce qui faisait dire à Proust : « La vraie vie, c’est la littérature », dont Balzac fut le plus puissant des thaumaturges.
© Photo : Illusions perdues film de Xavier Giannoli (2021)