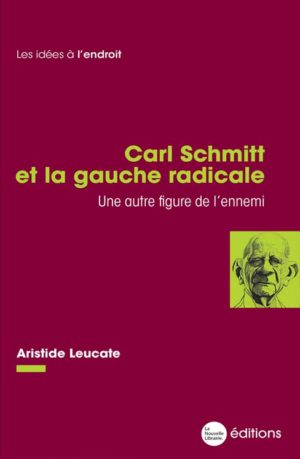Depuis un certain temps, il ne fait plus très bon vivre en « démocratie macronienne libérale avancée » (DMLA), dès l’instant que l’on professe, même mezzo voce, des opinions hétérodoxes, c’est-à-dire aussi peu conformes que possible à la doxa progressiste diversitaire. C’est ainsi que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé triomphalement la dissolution (décret du 4 octobre 2023) en Conseil des ministres de Civitas France, parti catholique nationaliste n’ayant, circonstance des plus aggravantes, jamais caché son hostilité à l’égard de notre sacro-sainte République et de ses « valeurs ».
Le moins que l’on puisse dire est que le ministre de l’Intérieur se montre particulièrement zélé dans la chasse aux idées supposément déviantes d’une « extrême droite » aussi fantasmée que son concept est creux, ductile et élastique. En 2021, il avait déjà eu la peau de Génération Identitaire. Notre « Fouché-Tinville », sans doute pour faire oublier qu’il s’était, naguère, encanaillé dans les rangs de cette droite aux irrésistibles relents méphitiques – dans le sillage, notamment, de Christian Vanneste qu’il trahira abondamment –, ne semble pas vouloir manquer une occasion de s’en prendre à elle, ainsi qu’en attestent les dernières mesures d’interdiction « préventive » des colloques de l’Action française et de l’Institut Iliade.
Sa conception des libertés publiques n’a, toutefois, rien de très originale et s’inscrit dans le droit fil de celle inaugurée, à l’occasion de l’affaire Dieudonné, par son prédécesseur à Beauvau, Manuel Valls qui, en 2014, avait trouvé dans le Conseil d’Etat – lequel s’est, d’ailleurs, déshonoré à jamais en renversant une jurisprudence ancienne sur laquelle reposait la crédibilité de l’institution – un complice inattendu de ses basses œuvres liberticides. Dans une circulaire datée du 9 mai 2023, toujours non publiée, envoyée à toutes les préfectures de France et de Navarre, le ministre a enjoint l’interdiction systématique et a priori de toute manifestation« d’extrême droite », de quelque nature qu’elle soit. S’abritant derrière le risque supposé de commission d’une infraction pénale – lire le non-respect, entre autres, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur les délits presse et sa jurisprudence subséquente –, il demande que les préfets se montrent attentifs à tous « slogans ou propos de nature à mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen », allant jusqu’à y inclure « l’amalgame entre immigration et islamisme ». Autant dire que l’État, circonscrivant le périmètre de ce qu’il importe de penser et d’exprimer, n’impose rien de moins qu’un dogme religieux dont les hérétiques seront pourchassés sans relâche – à défaut de pouvoir les attraire au bûcher.
Une stratégie cynique et efficace
La stratégie de Darmanin est, certes, moralement cynique, mais politiquement redoutable et juridiquement quasi imparable, sauf à obtenir, en référé – mission parfois impossible, compte tenu du très court délai laissé au justiciable pour organiser sa défense et saisir le juge, l’administration notifiant ses arrêtés seulement quelques heures avant la manifestation – la suspension de la mesure administrative. L’on remarquera, en revanche, hasard ou coïncidence, que les juridictions administratives paraissent se montrer plus libérales à l’égard des groupuscules d’extrême gauche. Cet été, le Conseil d’Etat n’a pas manqué de suspendre la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre, tandis qu’en mars 2022, le bien nommé Groupement antifasciste de Lyon et environs (GALE) avait bénéficié d’une mansuétude identique de la part des magistrats du Palais-Royal.
C’est dans ce contexte qu’un insignifiant dépôt de gerbe sur la tombe de Pierre Sidos, fondateur nationaliste de l’Œuvre française a pu être interdit en septembre dernier. Ce climat de chasse aux sorcières engendre même une forme inédite d’autocensure contraignant les structures estampillées comme « nationalistes », de « droite extrême » ou « d’ultra droite » par le régime, à déprogrammer rencontres, salons, colloques, de façon à ne pas exposer inutilement des finances souvent précaires en frais d’annulation de dernière minute.
Civitas vient donc grossir l’inventaire des mouvements figurant dans le collimateur de l’exécutif. Parolier égocentrique et marionnettiste de sa propre impuissance, surjouant sa nullité face aux problèmes cruciaux constituant le nœud régalien de ses attributions, à savoir le chaos migratoire et l’enfer insécuritaire, Matamore tente de donner le change, conscient que la macronie, à commencer par le Premier ministre, ne semble guère apprécier ses appétits présidentiels qu’elle juge, tout de même, très prématurés.
Au visa de l’article L.212-1 du Code de la sécurité intérieure – codification à quasi droit constant modifié de l’ancienne loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées –, le mouvement présidé par le Belge Alain Escada, voit s’abattre sur lui les habituels griefs idéologiques réunis en un faisceau excommunicatoire diabolisant – attendu que lorsqu’il s’agit de dénoncer l’« extrême droite », toute proportionnalité et toute rationalité sont considérées comme des concessions envers la « Bête immonde ». Le catalogue est aussi impressionnant que fantaisiste. On y trouve l’habituel procédé rhétorique d’empilements argumentatifs hasardeux, d’apparentements fallacieux, d’assemblages invraisemblables et d’extrapolations sophistiques, de noms (Brasillach, Maurras, Degrelle, Pétain) et de notions (« collaboration », « négationnisme », « haine »), en vue d’atteindre un effet de sidération absolue culminant au « point Godwin » de comparaison ou d’assimilation démonologiques avec Hitler et la Shoah. A la lecture édifiante du décret et de ses motifs, le premier d’entre eux a singulièrement retenu notre attention. Selon les juristes du ministères, « Civitas appelle[rait] à entrer en « guerre » contre la République afin de rétablir une monarchie, et incite[rait] à recourir à la force pour y parvenir » ; […] qu’au nom de la défense de ce que l’association « Civitas » présente comme ses valeurs, l’association organise des camps d’été […], afin d’entraîner ses militants au combat ».
L’État, voilà l’ennemi ?
Dans Légalité et légitimité (1932), le juriste Carl Schmitt pointait l’impuissance congénitale de l’État libéral parlementaire face aux partis politiques anti-démocratiques. Il existe, en effet, une contradiction entre le libéralisme positivo-kelsenien qui se refuse, par essence – sauf à s’anéantir lui-même – à recourir à l’ultima ratio de la dissolution de partis ouvertement antidémocratiques et la nécessité politique concrète et vitale de « désigner l’ennemi » corrodant de l’intérieur la démocratie parlementaire et attendant son heure pour retourner contre elle ses principes et la renverser.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États libéraux européens ont cru résoudre définitivement cette aporie par la médiatisation du droit : il s’agira moins de désigner politiquement tel ou tel groupement partisan comme étant un ennemi de la démocratie que de lui intenter le procès, formel et substantiel, de ne pas respecter les normes démocratiques générales et abstraites permettant, comme l’écrivait Schmitt de « laisser accessible l’égalité des chances à celui [lire « le parti politique »] dont on est certain qu’il la laisserait accessible à autrui [lire « ne pas faire obstruction au jeu démocratique de l’alternance »] » ; l’habileté suprême des « systèmes bourgeois de légalité » a donc consisté à se retrancher, en toute bonne conscience libérale, derrière l’impartialité du juge et la neutralité axiologique du droit pour abattre l’ennemi. C’est dire, qu’en une telle hypothèse, les récriminations en défense fondées sur les insoutenables atteintes aux libertés constitutionnelles d’expression et d’opinion sont tout simplement inopérantes, dès lors que la survie même de la majorité légale – même illégitime – est en jeu. Si celle-ci désigne politiquement l’ennemi, celui-ci s’épuisera en vain à lui faire ses plus belles protestations d’amitié et de repentir…
Le Conseil d’État, exécuteur des basses oeuvres du gouvernement
En l’espèce, l’État français se ridiculise à peu de frais en désignant Civitas comme objet de son ressentiment. Désigner l’ennemi est une opération politique qui suppose de hiérarchiser entre plusieurs hostis, donc de discriminer entre ceux qui présentent un danger réel, direct et certain et ceux qui, au-delà des mots, des postures et des apparences, ne méritent guère la qualification d’ennemi intérieur ou extérieur. Il ne s’agit nullement de s’en tenir à l’écume des choses mais de rechercher si l’hostis représente un péril de basse ou de haute intensité susceptible d’affecter les intérêts vitaux de l’État, son territoire, sa population et/ou son gouvernement.
Comptant environ un millier d’adhérents, manifestement dépourvu de tout arsenal permettant un passage à l’acte physique et logistique effectif, végétant à l’état groupusculaire depuis sa création en 1999, Civitas, dont l’influence électorale et l’audience médiatique restent faibles – se bornant à des happenings sans lendemains bien plus qu’à de véritables démonstrations de force –, ne représente aucun danger pour la République. Ainsi que le reconnaît le politologue Jean-Yves Camus : « Civitas revendique 1 000 adhérents, ce qui est plausible mais ne signifie pas autant de militants actifs. Nous sommes face à une culture politique de marge et les quelques candidats du mouvement aux législatives ont recueilli moins de 1 %. Dans la société, l’impact est très limité » (Le Figaro, 10 août 2023). Par la voix de son responsable, le mouvement a annoncé qu’il exercerait toutes les voies de recours contre le décret de dissolution. Si le Conseil d’État fait, pour une fois, preuve d’impartialité, le décret ne pourra être que suspendu puis annulé. Gageons, pourtant, que, sur la voie de sa jurisprudence Dieudonné, il le validera aux forceps.