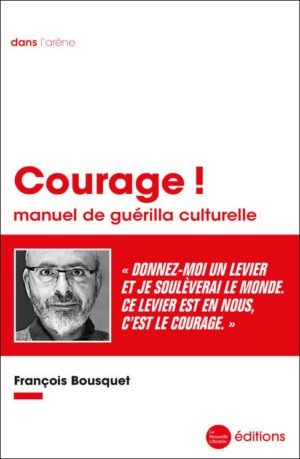Pareil à un personnage biblique, Alexandre Soljenitsyne a guidé son peuple dans la nuit historique du communisme. C’est un moment unique dans la littérature mondiale. Jamais écrivain n’aura exercé une telle influence. C’est le héros collectif du Goulag, son coryphée, comme s’il avait reçu procuration des bagnards et des déportés – les zeks. Grâce à lui, leur plainte est venue jusqu’à nous. Ses livres ont été comme un coup de tonnerre. Ils ont produit une onde de choc plus grande encore que le rapport Khrouchtchev au XXe congrès du Parti communiste de l’Union soviétique, marquant la déstalinisation.
Né en 1918 dans le Caucase, c’est un enfant de la Révolution d’Octobre. Rien ne le prédisposait à devenir le grand dissident qu’il fut, lui, le dérisoire pot de terre, numéro de matricule CH-232, auteur inconnu d’Une journée d’Ivan Denissovitch (1962), d’abord vox clamantis in deserto, comme tant d’autres, dont la parole muselée a fini pourtant par résonner sur tous les continents, après s’être gonflée d’affluents innombrables – ses compagnons de captivité.
Le grain tombé entre les meules
Si d’aventure l’on devait résumer le XXe siècle russe, deux noms se dégageraient comme la thèse et l’antithèse, le jour et la nuit : le sien et celui de Joseph Staline. Celui qui envoyait à la mort et celui qui en est revenu. L’inhumanité du bourreau mise au défi par l’humanité de la victime. À eux deux, ils offrent ce mélange sans pareil d’anarchie et d’autocratie, de foi et de nihilisme, de bien et de mal, de paganisme et de christianisme, de malédiction et de messianisme, qui, depuis le baptême de Vladimir, inonde de lumière ce pays-continent – un sixième des terres émergées.
Tout est surdimensionné chez Soljenitsyne. Les livres, la stature, l’audience, tout, sauf le refus qu’il adresse au Kremlin. Car sa dissidence est commune à tous les hommes. Elle se trouve en dépôt en chacun. Comme une graine. À charge pour les uns et les autres de la cultiver. C’est « le grain tombé entre les meules », pour reprendre le titre du second volet de ses mémoires (1998). Tout broyé qu’il soit, il germera.
Historien et prophète, Soljenitsyne a tracé son sillon comme le paysan son champ et le pèlerin son chemin. C’est l’homme de la voie droite (l’orthodoxie, étymologiquement « la voie droite »). « Toute ma vie, j’ai couru comme dans un marathon », confiera-t-il un jour à l’écrivain et diplomate Daniel Rondeau. Un lutteur magnifique, tour à tour moine et soldat, athlète et moujik, titan et fourmi, imposant comme Tolstoï, large comme la Russie, aussi vieux que la protestation d’Antigone, et dont la grandeur est sans égale – et pourtant humaine, rien qu’humaine. Face au crime sans nom, il a fait valoir une banalité du bien, tant il est vrai que la vraie résistance est têtue et sans manière.
Le Goulag en direct
Il a décrit le Goulag dans tant de livres qu’il est impossible de les mentionner tous. C’est L’Archipel du Goulag (1973) qui domine ce massif critique. Mille six cents pages, dont son auteur disait pourtant que ce n’était qu’une meurtrière. « Je n’ai réussi à percer qu’une meurtrière par où regarder l’archipel, ce n’est pas le panorama qu’on a du donjon. » L’Archipel restera comme le monument aux morts, la Croix plantée sur la Kolyma, dont il a été le récitant et le scribe. Mais ce monument est bien plus qu’un mausolée dressé au milieu des ruines. C’est un enfer et un paradis. Comme chez Dante, on traverse un à un les cercles de l’univers concentrationnaire, le monde des catacombes, pour finalement gagner la lumière. Car elle jaillit toujours des ténèbres. C’est ce qui distingue L’Archipel des témoignages sur l’horreur nue des camps, dont on sort comme brisé. Ici, on survit à la mort. L’histoire russe est peut-être un chemin de Croix, de peine et de douleur, une montée au Golgotha, mais c’est une montée en gloire, suivie d’une résurrection. Une ordalie (épreuve devant Dieu), comme l’écrit Georges Nivat.
De là, les deux tâches que Soljenitsyne s’est assigné dans sa retraite du Vermont, aux États-Unis, après son expulsion d’URSS en 1974, et qui se recoupaient comme la cause et l’effet. D’abord, témoigner du crime unique. Ensuite, l’expliquer. Ce sera l’objet de la seconde partie de l’œuvre, La Roue rouge. 6 600 pages, divisées en quatre grands « nœuds » : Août 14, Novembre 16, Mars 17, Avril 17, dont la publication s’échelonnera sur plus de trente-cinq ans. Dans cet écheveau foisonnant de petite histoire et de grande histoire, dans cette immense coulée qui emporte tout, dans cette roue de la fortune et de l’infortune, Soljenitsyne se hâte lentement, remonte le cours du temps, cherche un ordre au désordre du monde – pour accoucher une seconde fois de la Révolution.
Le chantre du peuple russe
Qu’est-ce qui a déraillé en Russie ? C’est la question qui hante cette œuvre. Mais pour l’auteur de La Russie sous l’avalanche (1998), le mal ne se résume finalement qu’à une seule chose : l’irruption de l’Occident, depuis la « fenêtre ouverte » par Pierre le Grand sur l’Europe, selon les mots de Pouchkine dans Le Cavalier d’airain, jusqu’au wagon blindé de Lénine. De toutes ses forces, Soljenitsyne a refusé la « russité » de la Révolution. Elle semble chez lui comme tombée d’un ciel vide. C’est tout au plus le Letton, l’Allemand, le Juif, qui en sont les messagers sinistres, mais inconscients et certainement pas diabolisés. Ce qui rend absurde la reductio ad antisemitum à laquelle on a livré son œuvre, d’autant plus absurde qu’au soir de sa vie, dans Deux siècles ensemble : Juifs et Russes (2002-2003), le vieil homme a renvoyé dos-à-dos l’antisémitisme russe et la russophobie juive, prêchant l’absolution des fautes, de part et d’autre.
C’est l’homme d’une seule curiosité, la terre russe, et d’un seul personnage : le peuple russe, qu’il investit de toutes les vertus. C’est la « glébophilie » chère à Dostoïevski. Le peuple pur, saint, non contaminé, seul dépositaire de l’âme de la nation, comme chez Péguy. Un monde dont Soljenitsyne a la nostalgie et qu’il a fait revivre jusque dans son vocabulaire, recourant aux archaïsmes de langage et aux expressions dialectales, puisant à la source de la sagesse populaire et aux recueils de proverbes. L’ethnographe du folklore russe se double ainsi d’un lexicologue, à la syntaxe savante et novatrice.
Dissident à l’Est, dissident à l’Ouest
Beaucoup se trompent en Occident à voir en lui un nostalgique de « l’Empire des tsars », lui qui recommande une démocratie des petits espaces, « à la Suisse », comme l’a un jour écrit, non sans malice, Claude Durand, qui fut l’agent Soljenitsyne. Tout au long de son œuvre, Soljénitsyne a exhorté les siens au repli sur la terre russe, préconisant le modèle du zemstvo (l’auto-administration locale) et la décroissance, qu’il appelait, avec des accents franciscains, « l’autosuffisance radieuse ».
Vingt ans et trois mois après son exil forcé, le 27 mai 1994, il revenait enfin chez lui (« Il me fallait arriver à temps pour mourir en Russie », écrivait-il dans ses Esquisses d’exil, parues en 2005, dernier volume de ses mémoires). Reprenant la critique chère aux slavophiles d’une élite libérale occidentalisée, il n’eut pas alors de mots assez durs pour dénoncer le déferlement de la culture marchande, dont il avait dressé par avance, trente ans plus tôt, le plus implacable des réquisitoires dans son si prophétique « discours d’Harvard » (Le Déclin du courage, 1978), dénonçant l’encerclement de la Russie par l’OTAN et la guerre contre la Serbie. Le vieux lutteur tirait ses dernières cartouches, avant de mourir le 3 août 2008 à Moscou.
Il avait la simplicité des âmes médiévales, le regard clair et la beauté des icônes. Georges Nivat le compare à l’archiprêtre Avvakoum, le chef religieux des Vieux-Croyants, schismatiques livrés à la persécution pour avoir refusé la modernisation de la liturgie sous Pierre le Grand – mélange de Vendéens et de puritains –, qui nous a laissé, avec son autobiographie, l’un des premiers grands textes de la littérature russe moderne, avant de mourir sur le bûcher. C’est la Russie séquestrée par le dragon, qui tient debout dans la tourmente. Ainsi de Soljenitsyne, lui, le vieil arbre noueux, qui démêlait les nœuds de la Révolution et tenait tête au Moloch totalitaire tout autant qu’à l’Occident. La source spirituelle qui animait son œuvre ne s’est jamais tarie, même aux pires moments de la persécution. Claude Durand dit de lui qu’« il a préservé pour la léguer à son pays, mieux que des tonnes d’or : sa mémoire. »