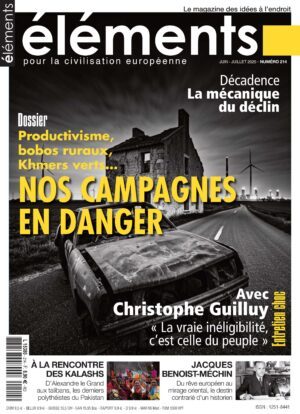Quant à Albert Caraco, loin de voir dans l’Histoire le lieu d’une vaste procession de l’Esprit Absolu, il y discerne de profondes allées de cimetière, aussi profondes que sont insensés les idéals des hommes qui la mettent en branle. Il prévient, au seuil de l’ouvrage, en prenant soin de nous avertir de l’âpreté du propos : « Je n’aime pas l’Histoire, ce fleuve impur ne réfléchit que par moment la lumière incréée, les raisons d’être de l’humain commencent où l’Histoire cesse, elle remet ses fondements en jeu. » Ainsi, le sens et l’Histoire, loin de se compénétrer comme chez Hegel, s’excluent mutuellement.
Il n’en demeure pas moins que porter un regard d’ensemble sur l’Histoire, comme sur un panorama qu’on dominerait, a quelque chose de grisant. Se situer en surplomb de l’Homme et de sa destinée, fût-elle tissée de bruit et de fureur, confère à l’observateur une stature quasi-divine. « L’Histoire a des beautés, écrit alors Caraco, quand nous la jugeons à distance et dans un lieu de sûreté nous mettant à couvert de ses orages. Il est très agréable de passer les siècles et les peuples en revue, cela nous donne un sentiment d’ivresse et nous nous figurons participer de la nature propre aux Immortels, encore un mouvement et nous nous jugeons les complices de la destinée. »
Cependant l’Histoire a souvent les mêmes couleurs, spectre étroit allant du pourpre au noir, en passant par le cramoisi, sang séché à l’ombre des morts sous une lumière blême. Le sang abonde et coagule, aussi compact que la glaise et noir comme l’enfer. De quoi nourrir les plus amères désillusions sur la condition humaine, interrogeant le sens de notre présence sur Terre. De quoi nous mener bien loin des sentiers hégéliens et des mirages à demi-consolateurs d’un chimérique Savoir Absolu. Caraco : « Nous sommes, philosophes, là pour nous pencher sur le scandale de ces immolations que rien ne légitime et de ces morts sans nombre qui nous ferons douter à jamais d’une Providence. »
Cette décrépitude de l’homme, ces idéaux engloutis sous l’Océan de la mort et de l’oubli, cette continuelle chute et perte des illusions, comme dirait Balzac, est-ce le mot de la fin pour Albert Caraco ? Non, le mot de la fin, c’est le mot race, pour reprendre le titre de ce fameux livre de Renaud Camus. Après que toute croyance a été abolie, « soleil cou coupé » ( Apollinaire ), il reste « les dures réalités à étreindre » évoquées par le Rimbaud de la Saison. Il reste l’élémentaire, le farouchement animal, le racial. Ce qui fait du racisme une passion exclusive : voyez comme certains tenants d’une internationale blanche prennent bien soin de liquider toute valeur supérieure, religieuse, spirituelle, philosophique. Il ne reste alors plus que la technique comme mystique, prolongement de la puissance, de la force brutale, procédé d’annihilation de toute transcendance. D’où l’alliance entre prométhéisme et racisme. Il ne s’agit pas là d’un jugement de valeur mais de la constatation d’un fait, d’une tendance lourde hautement révélatrice à la lumière de la pensée d’un Caraco.
Les fossoyeurs de la transcendance, fourriers de la Race ?
La race, pourrait-on dire avec Caraco – et selon le résumé percutant qu’en propose Olivier François – c’est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Ce qui nous met en face d’un paradoxe du monde moderne. Si Caraco a raison, si la question raciale devient cruciale à mesure de la mort de toutes les valeurs supérieures, le nihilisme et la déconstruction – qui ne font qu’un en régime de post-modernité – travaillent directement au déchaînement brutal du racisme. Ainsi, les modernes fossoyeurs de la transcendance, de toutes les hautes vertus de l’esprit et nobles principes qui ont présidé à la fondation de notre civilisation, sont des fournisseurs en gros, malgré eux, du racisme le plus débridé qui soit. Paradoxe suprême, insoutenable : leur nihilisme déconstructeur est parfaitement incompatible avec leur antiracisme obsessionnel, ce que les mouvements décoloniaux et indigénistes ont parfaitement compris… En bref, on ne peut pas vouloir la déconstruction de toutes les structures traditionnelles, la liquidation de toute transcendance et l’antiracisme à la fois. Le croisé avait pour ennemi l’infidèle et pour point de mire mystique le Saint Tombeau. Ce sont des représentations d’ordre spirituel. La question raciale reste lointaine et vous n’y trouverez pas la moindre esquisse dans une somme théologique médiévale. Notre époque désenchantée ira à plus élémentaire, plus bestial, délestée qu’elle est de toute foi, de tout surmoi, de tout garde-fou.
Libre aux ravis de la crèche du gauchisme de croire leur monde et leur idéologie éternels. Cette arrogance ne tiendra pas face au couperet de l’Histoire, car l’Histoire est un Tombeau et on y croise peu de saints. Rome se croyait éternelle, Virgile n’en doute pas une seconde. Elle est pourtant tombée. Le Moyen Âge chrétien et sacral se croyait éternel ; la guerre de cent ans et la grande crise du XIVe siècle l’ont détrompé. Jean-Pierre Torrell note, dans son livre Saint Thomas, maître spirituel : « Dès le début du XIVe siècle – et quel que soit par ailleurs l’intérêt de cette époque pour l’histoire de la pensée -, toute une série de facteurs […] ont contribué à ce que l’observateur est bien obligé d’appeler un émiettement du savoir théologique en diverses spécialisations, et même à son éclatement. On constate de nos jours – certains pour le déplorer, d’autres pour s’en réjouir – l’absence et même l’impossibilité d’une synthèse théologique. En réalité nous sommes les héritiers d’un processus de désagrégation qui a commencé il y a des siècles. » Et les modernes se croient à l’abri de la désagrégation ? Se croient-ils sincèrement plus solides et plus durables qu’une civilisation qui a bâti les cathédrales ?
Henry Montaigu a justement fait remarquer à ce propos : « On observe sans étonnement que le monde moderne, comme toutes les civilisations précédentes, pense avoir l’éternité devant lui. […] Le monde moderne sera renversé comme il a lui-même renversé le monde ancien. » Et Sophocle de trancher : « On peut s’attendre à tout, rien ne tient, ni le cœur décidé, ni le serment terrible. » Et ce n’est pas la mascarade grotesque d’une abstraite « lutte contre la haine » qui viendra empêcher la digue de se rompre. Car la haine est aussi tenace que la nature humaine ; elle y plonge ses racines. Libre aux bonnes âmes de décrier cet état de fait, ces récriminations n’ont aucun poids face aux permanences anthropologiques. Albert Caraco signale cette fatalité dans son essai intitulé Les races et les classes : « Rien ne se fera sans la haine, la haine est le moteur et nous n’avons communément d’autre raison de sortir de notre indolence, les humanistes ne sauraient toujours nous échauffer ni les spirituels nous émouvoir, l’homme a des besoins de fureur comme il a des besoins d’amour, la rage entre dans son économie. »
Ainsi l’Histoire est-elle pour Caraco une sorte d’antagoniste des forces élémentaires de la race qui couvent sous le vernis de la civilisation. L’Histoire, elle, forme des peuples distincts : « D’aucun voudront me démentir, mais ce que nos yeux voient emportent la balance : la façon d’être de l’Anglais n’est pas celle de l’Allemand, cet Anglais et cet Allemand se ressemblassent-ils physiquement une fois nus et morts, car plusieurs millions vers l’Allemand ne se distinguent de la masse des Anglais, hors par l’expression de leur visage. L’oeuvre de notre Histoire la voilà, l’Histoire nous créant des habitudes formant cet acquis irréversible aussi fort que le naturel. » La race, quant à elle, loin de distinguer, confond tout dans une même fureur…